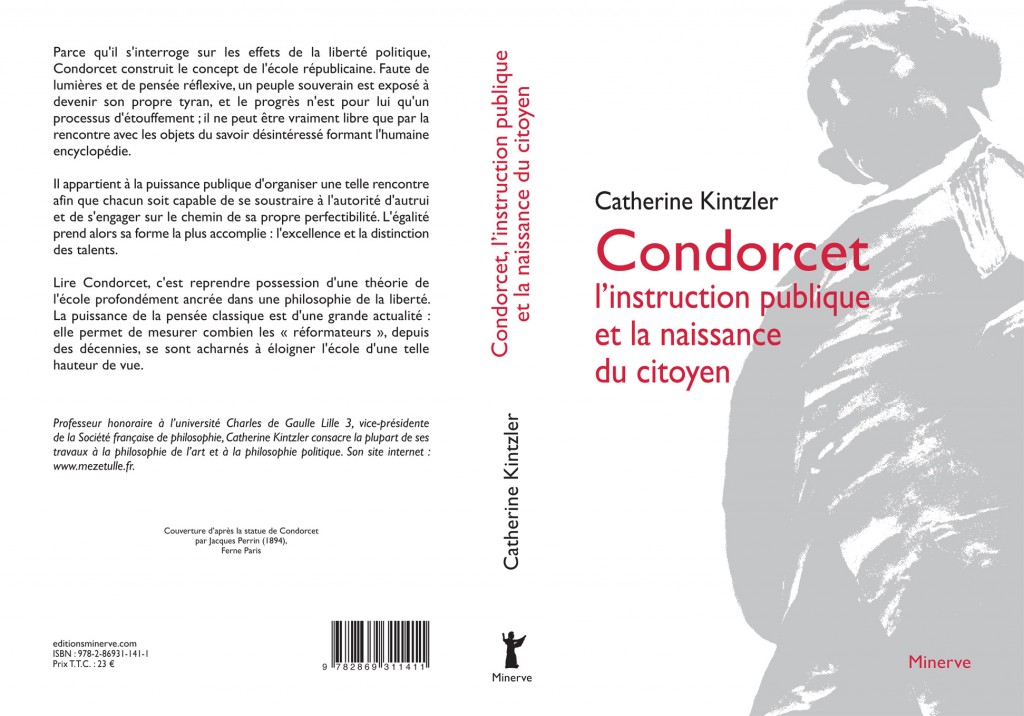À partir de l’examen d’une chronique de Frédéric Worms s’employant à critiquer l’expression « tyrannie des minorités », André Perrin propose une rigoureuse mise au point. Il se penche notamment sur deux questions. Que veut-on dire quand on invite à « respecter les minorités » ? S’agit-il de respecter leurs intérêts particuliers, ou bien de respecter les droits inaliénables de tout être humain ? Et pour « protéger les minorités », faut-il aller jusqu’à la promotion de privilèges ? Ce qui conduit à réfléchir sur la question de la volonté générale dans son rapport au concept de majorité et sur celle de la non-coïncidence entre majorité parlementaire et majorité populaire, entre loi électorale et légitimité.
Le 22 septembre 2016 le journal Libération publiait une chronique de Frédéric Worms intitulée « D’une tyrannie à l’autre ou le piège des éléments de langage »1. Partant d’une récente déclaration d’un ancien président de la République dans laquelle celui-ci fustigeait la « tyrannie des minorités », l’auteur nous invitait à critiquer cette expression dans laquelle il voit le détournement « habile » mais « inadmissible » de la célèbre formule de Tocqueville qui fait de la « tyrannie de la majorité » l’écueil le plus dangereux du régime démocratique :
« il peut dégénérer en abus de pouvoir et en «tyrannie», précisément s’il ne respecte pas les minorités (et d’abord, selon lui, les opinions minoritaires, l’opposition). Régime où seule la majorité peut être «tyrannique», et dont c’est l’un des dangers mortels.
Mais dès lors parler de tyrannie des «minorités», ce n’est pas seulement contradictoire avec la démocratie, c’est rechercher un double effet pervers pour la démocratie. Car c’est souhaiter implicitement deux choses, également graves et inadmissibles. C’est d’abord rendre implicitement souhaitable la tyrannie de la majorité, elle-même ! Et en outre, c’est le faire contre les minorités, en figeant ces dernières non plus dans des opinions mais dans des «identités», et en incitant contre elles non plus à la critique, mais à la discrimination. C’est refuser le principe central de la démocratie non tyrannique, qui consiste à protéger les minorités. […] La tyrannie des minorités n’est donc qu’un habile piège rhétorique de plus, pour redoubler le danger réel revenu, qui est celui d’une tyrannie aggravée de la majorité. […] Il faut donc plus de vigilance encore que jamais. Et dans cette vigilance, il faut exercer celle qui porte sur le langage, sans attendre qu’il soit trop tard ».
On peut résumer ainsi les thèses de l’auteur de ces lignes :
1 – Il n’est pas légitime de parler d’une tyrannie des minorités car dans une démocratie seule la majorité peut être tyrannique, ce qui se produit lorsqu’elle ne « respecte » pas les minorités et c’est, comme Tocqueville l’a bien vu, le principal danger qui menace ce régime politique.
2 – Ceux qui évoquent une possible tyrannie des minorités sont des rhéteurs qui souhaitent discriminer les minorités en imposant une tyrannie de la majorité.
La tyrannie des minorités et les pièges du langage
Peu importe ici que ce soit un homme politique, ancien président de la République et manifestement désireux de le redevenir, donc vraisemblablement animé par des préoccupations électorales, qui ait parlé de « tyrannie des minorités » car indépendamment de sa personne la question d’une possible tyrannie des minorités se pose bel et bien, et pas d’aujourd’hui. Ainsi Philippe Raynaud, qui n’a jamais été candidat à la magistrature suprême, pouvait-il conclure, il y a presque 25 ans, un article remarquablement instruit de l’histoire du droit constitutionnel américain de la façon suivante : « Il n’est donc pas abusif de dire que, aujourd’hui, la menace d’une « tyrannie des minorités » se substitue à celle, dénoncée par Tocqueville, d’une « tyrannie de la majorité »2. De même, s’appuyant sur les travaux de Roberto Michels et de Mancur Olson, Raymond Boudon pouvait affirmer beaucoup plus récemment que « ce qui menace les démocraties et la démocratie française plus que d’autres, c’est en fait la tyrannie des minorités plutôt que la tyrannie de la majorité »3. On ne se laissera donc pas impressionner par la formule dogmatique du chroniqueur de Libération selon laquelle « seule la majorité peut être tyrannique ». Cette formule permet tout au plus de donner un sens à son étrange assertion selon laquelle « parler de tyrannie des minorités » serait « contradictoire avec la démocratie ». En effet on ne voit pas bien, à proprement parler, où est la contradiction. En toute rigueur « parler » de quelque chose, que ce soit de la tyrannie des minorités ou de quoi que ce soit d’autre, n’est pas contradictoire avec la démocratie. Ou alors, si l’on veut dire que la tyrannie est contradictoire avec la démocratie, ou plus rigoureusement qu’elle lui est contraire, c’est vrai, mais c’est vrai quel que soit le sujet qui exerce cette tyrannie, la majorité ou une minorité. M. Worms veut manifestement dire autre chose que ce qu’il dit. Il veut sans doute dire qu’à partir du moment où l’on présuppose que seule la majorité peut être tyrannique, aucune minorité ne peut l’être, ce qui est incontestablement vrai, mais purement tautologique.
Ce n’est pas tout car Frédéric Worms poursuit sa démonstration en soutenant que parler de tyrannie des minorités, c’est « rendre implicitement souhaitable la tyrannie de la majorité ». Il suppose donc que les propositions « la tyrannie des minorités n’est pas souhaitable » et « la tyrannie de la majorité n’est pas souhaitable » sont des propositions contradictoires : on ne pourrait pas refuser à la fois la tyrannie de la majorité et la tyrannie des minorités. Mais s’il en est ainsi, celui qui, comme M. Worms lui-même, refuse avec la dernière énergie la tyrannie de la majorité doit alors confesser qu’il souhaite la tyrannie des minorités.
Pour sortir de la confusion et déjouer les pièges de la rhétorique, il faut, comme Frédéric Worms nous y invite, exercer la vigilance « qui porte sur le langage », et le faire avec un peu plus de vigilance qu’il ne le fait lui-même. La majorité devient tyrannique, nous dit M. Worms, si elle « ne respecte pas les minorités », si elle ne respecte pas « les opinions minoritaires » alors que « le principe central de la démocratie non tyrannique » consiste à « protéger les minorités ». Cependant il ne nous dit pas ce que signifie « protéger » » les minorités ni « respecter » leurs opinions, en sorte que les silences de son langage autorisent diverses interprétations. Puisque c’est à Tocqueville que Frédéric Worms se réfère, c’est d’abord auprès de cet auteur que nous chercherons une réponse à ces questions.
Tocqueville et la protection des minorités
Ce qui chez Tocqueville fonde la possibilité d’une tyrannie de la majorité c’est cette détestable maxime « qu’en matière de gouvernement la majorité d’un peuple a le droit de tout faire »4. Si donc la loi de la majorité fonde la légitimité de la décision prise conformément à la volonté qu’elle a exprimée dans le vote, cette légitimité n’est pas sans bornes : elle trouve sa limite dans une autre légitimité, plus élevée :
« Il existe une loi générale qui a été faite ou du moins adoptée, non pas seulement par la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, c’est la justice. La justice forme donc la borne du droit de chaque peuple […] Et quand je refuse d’obéir à une loi injuste, je ne dénie point à la majorité le droit de commander ; j’en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain »5.
On reconnaît sans difficulté dans cette loi générale de justice qui vaut pour le genre humain tout entier ce que l’on appelle communément le droit naturel. Et l’on comprend alors ce que signifie respecter les minorités : non pas respecter leurs intérêts particuliers, qui, en tant que tels, ne sont pas plus respectables que ceux de la majorité, mais respecter les droits inaliénables qu’elles tiennent de leur participation à la nature humaine ou au genre humain. Un exemple de Spencer permet d’en donner une illustration : « Supposez encore que de deux races vivant ensemble – Celtes et Saxons par exemple, – la plus nombreuse décidât de faire des individus de l’autre race ses esclaves. L’autorité du plus grand nombre, en un tel cas, serait-elle valide ? Sinon, il y a quelque chose à quoi son autorité doit être subordonnée »6. Il peut bien être conforme aux intérêts de la majorité de réduire en esclavage une minorité ethnique, mais si, arguant de la loi de la majorité, elle s’y employait, elle se comporterait précisément de façon tyrannique. À l’intention de ceux qui récusent le jusnaturalisme, on pourrait d’ailleurs s’amuser à donner de cette idée une version rousseauiste : la volonté générale qui n’a égard qu’à l’intérêt commun n’est pas l’intérêt de tous, simple addition de volontés particulières, qui « regarde à l’intérêt privé »7. Les intérêts particuliers des Celtes et des Saxons peuvent s’opposer entre eux, mais ils ne pourront s’accorder que sur la base de ce qui leur est commun : « c’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social […] c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée »8. Si les Saxons, plus nombreux que les Celtes, peuvent avoir intérêt à réduire ceux-ci en esclavage, cet intérêt ne peut être commun aux Celtes et aux Saxons, de telle sorte qu’une volonté majoritaire qui déciderait cette réduction en esclavage ne s’identifierait pas à la volonté générale, laquelle n’a d’autre objet que l’intérêt commun et naît quand les volontés particulières découvrent ce qu’elles ont en commun.
Toujours est-il que la référence tocquevillienne au droit naturel permet de comprendre ce que signifie « protéger les minorités », d’autant plus que Tocqueville indique lui-même comment cette protection trouve sa traduction concrète : « Le pouvoir accordé aux tribunaux de se prononcer sur l’inconstitutionnalité des lois forme encore une des plus puissantes barrières qu’on ait jamais élevée contre la tyrannie des assemblées politiques »9. Dès lors que le droit naturel s’inscrit dans le droit positif à travers une constitution ou une déclaration des droits de l’homme intégrée à son préambule, il revient à une cour suprême de rejeter comme inconstitutionnelles les lois à travers lesquelles une majorité opprimerait une minorité en violant ses droits fondamentaux. Il est en revanche plus difficile de comprendre ce que signifie respecter les opinions minoritaires. En effet les opinions minoritaires ne sont, en toute rigueur, ni plus ni moins respectables que les opinions majoritaires : elles ne le sont pas du tout. Le respect, comme Kant l’a mis en évidence dans des analyses célèbres, ne peut, à tout le moins, porter que sur ce qui est plus haut que nous, sur ce qui nous dépasse infiniment. Les opinions, qu’elles soient majoritaires ou minoritaires, vraies ou fausses, en tant qu’elles sont des opinions c’est-à-dire des croyances subjectives, incertaines et infondées, ne méritent aucun respect. Là encore en disant que toutes les opinions doivent être respectées, on dit autre chose que ce que l’on veut dire. On veut dire que l’homme a le droit d’exprimer librement ses opinions et que ce droit est un droit fondamental de l’homme et du citoyen, ce qui est effectivement garanti aussi bien par le premier amendement de la constitution américaine que par l’article 11 de la Déclaration du 26 août 1789, intégrée au préambule de la constitution de la Ve République en France.
La tyrannie des minorités aujourd’hui
En France comme aux États-Unis, la protection des minorités et la libre expression de leurs opinions sont garanties par la constitution. On voit donc mal ce qui permet à M. Worms de tirer la sonnette d’alarme en évoquant « le danger réel revenu, qui est celui d’une tyrannie aggravée de la majorité », d’autant qu’il ne donne aucun exemple d’un tel danger. On n’ose croire que Frédéric Worms porte au crédit de la tyrannie de la majorité la promulgation de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe en dépit de l’opposition d’une minorité qui considérait ce bouleversement comme contraire au droit naturel et dont l’opinion n’a pas été « respectée » par la majorité… Mais supposons que les manifestations, d’une ampleur considérable, organisées par cette minorité agissante aient donné lieu à des débordements violents – vitrines brisées, véhicules incendiés, permanences politiques saccagées, plusieurs centaines de policiers et gendarmes blessés – et que le gouvernement, tétanisé par le syndrome Malik Oussekine, ait renoncé à promulguer la loi, ou à l’appliquer après qu’elle eut été promulguée : est-ce la tyrannie de la majorité qui aurait été mise en échec ou la souveraineté populaire ? Et si l’on répond que c’est la souveraineté populaire, ne convient-on pas du même coup qu’elle aurait été vaincue par la violence tyrannique d’une minorité ?
Cette expérience de pensée n’est pas sans lien avec la réalité puisque le cas de figure qu’elle évoque s’est produit à plusieurs reprises dans les dernières décennies. Le 8 décembre 1986, au terme de deux semaines de manifestations et deux jours après la mort de Malik Oussekine, la majorité avait retiré le projet de loi Devaquet sur la réforme de l’université. Le 15 décembre 1995, après trois semaines de grèves et de manifestations, c’est le gouvernement Juppé qui cédait aux manifestants en renonçant à son projet de réforme des retraites. Et au mois d’avril 2006, dans des conditions analogues, le gouvernement renonçait à appliquer la loi instituant le contrat première embauche, loi qui avait été votée le 9 février par le Parlement, validée le 30 mars par le Conseil constitutionnel et publiée le 2 avril au Journal Officiel. Aujourd’hui on ne sait pas si la loi El Khomri sera davantage appliquée ni si l’aéroport de Notre-Dame des Landes verra le jour, même si la majorité issue des urnes l’a décidé depuis longtemps et même si une majorité de plus de 55% s’est prononcée en faveur de sa construction lors de la consultation populaire du 26 juin 2016.
Raymond Boudon voyait le fondement théorique de la tyrannie des minorités dans la fameuse « loi d’airain de l’oligarchie » de Roberto Michels selon laquelle les gouvernements des nations démocratiques tendent à céder à l’action des groupes de pression plutôt qu’à l’opinion publique, parfois désignée sous le vocable de majorité silencieuse. Dans la communication citée plus haut, il portait au crédit de Mancur Olson d’en avoir identifié la logique et le fonctionnement :
« lorsqu’un petit groupe organisé cherche à imposer ses intérêts ou ses idées à un grand groupe non organisé, il a de bonnes chances d’y parvenir. En effet, les membres du grand groupe, étant non organisés, ont alors tendance à espérer qu’il se trouvera bien des candidats désireux d’organiser la résistance au petit groupe organisé, et prêts à assumer les coûts que cela comporte. Chacun espère en d’autres termes pouvoir tirer bénéfice d’une action collective qu’il appelle de ses vœux, mais répugne à en assumer les coûts. Comme la plupart tendent à se tenir le même raisonnement, il arrivera bien souvent que le petit groupe organisé ne rencontre guère de résistance et que par suite il se trouve dans la position de pouvoir imposer ses intérêts et ses idées au grand groupe non organisé, en d’autres termes : au public »10.
Boudon ajoutait que cette logique se déployait avec une puissance accrue dans un pays centralisé marqué par la domination du pouvoir exécutif comme la France, car dans ce cas de figure, « la vie politique tend à être surtout ponctuée par un face-à-face entre l’exécutif et les groupes d’influence »11.
Soutenir qu’il n’y a aucun sens à parler d’une possible tyrannie des minorités et que le principal danger aujourd’hui est celui d’une « tyrannie aggravée de la majorité » est donc doublement opposé à la vérité. C’est à proprement parler une « conscience du monde renversée » qui a pour effet, sinon pour but, d’occulter les problèmes qui se posent aujourd’hui à la démocratie. Il ne saurait être question ici de résoudre ces problèmes, mais, en nous limitant à deux d’entre eux, de montrer qu’ils se posent et comment ils se posent.
Souveraineté populaire ou pouvoir des juges ?
Le premier problème est celui du conflit entre la souveraineté populaire et la protection des droits des minorités dès lors qu’elle est confiée au pouvoir judiciaire. Le gouvernement des juges ne risque-t-il pas alors de se substituer au gouvernement du peuple par lui-même ? Aux États-Unis la Cour suprême a joué un rôle décisif dans la lutte contre la ségrégation raciale dont la minorité noire était victime en dépit du Quinzième amendement de la Constitution. Celui-ci dispose que « le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera dénié ou limité par les États-Unis, ou par aucun État, pour des raisons de race, couleur, ou de condition antérieure de servitude ». Cependant nombre d’États du Sud s’étaient employés à contourner cette disposition au moyen de divers subterfuges, par exemple en subordonnant la possibilité de voter au paiement d’un impôt électoral ou à la réussite de tests d’alphabétisation (Literacy tests) qui en excluaient de facto la population noire, majoritairement pauvre et illettrée. L’évolution de la jurisprudence de la Cour suprême imposa l’égalité électorale et rendit donc effectif le Quinzième amendement en restreignant les pouvoirs des États et en les homogénéisant politiquement12.
S’agissant d’un principe aussi fondamental que celui de l’égalité de tous les citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau, devant le droit de vote, la légitimité de la jurisprudence de la Cour ne pouvait guère être mise en doute. Cependant, comme l’écrit Philippe Raynaud, « le poids du judiciaire dans le « gouvernement » des États-Unis produit aussi des effets assez contestables du point de vue de la légitimité démocratique et de l’efficacité »13. Pour s’en tenir à un seul exemple, la discrimination positive (affirmative action), qui était au point de départ un simple moyen, provisoire, transitoire et exceptionnel pour atteindre des objectifs politiques définis, a acquis la valeur d’un principe constitutionnel. Dès lors elle « est devenue le moyen général de promotion des « minorités » les plus improbables, très au-delà de ce que nécessitait leur défense contre la « discrimination », et elle a conduit à négliger les aspects proprement « sociaux » (et « sécuritaires » …) de la question noire. […] de la même manière, l’absence ou le sous-développement de ce qui, sous d’autres cieux, améliore la condition féminine, rend de fait la carrière des femmes plus difficile, ce qui se traduit à la fois par des rapports très tendus entre les deux sexes et par la revendication de ce qu’il est impossible d’appeler autrement que des privilèges légaux pour les personnes de sexe féminin »14.
Aujourd’hui l’opposition des libéraux (aux États-Unis ce terme désigne les « progressistes ») et des conservateurs correspond au conflit de ceux qui préconisent une extension du pouvoir interprétatif de la Cour Suprême, le judicial activism, afin de promouvoir, plutôt que le développement des droits « sociaux », celui des droits « sociétaux » de multiples minorités et de ceux qui préconisent au contraire le judicial restraint, c’est-à-dire une interprétation minimaliste des amendements de la constitution, conforme à l’intention originaire des constituants et limitée par elle, qui préserve le pouvoir de légiférer des différents États. Ainsi en prolongeant le mouvement antiségrégationniste de conquête des droits politiques et sociaux, le mouvement féministe d’une part, celui des diverses minorités sexuelles d’autre part, ont donné à cette lutte appuyée sur le droit et le pouvoir des juges une coloration différente qui, écrivait Philippe Raynaud en 1992, « mène de l’individualisme le plus radical à l’auto-enfermement des individus dans leur groupe de référence » de telle sorte que « la quête de l’universalité démocratique aboutit à nier l’existence d’un monde commun entre les différentes composantes de la société »15.
Cette évolution n’est évidemment pas propre à la civilisation américaine. Elle correspond à un mouvement que Pierre Manent a mis en évidence à propos de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « on pourrait dire que les droits du citoyen l’avaient emporté sur ceux de l’homme, qu’au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, on s’intéressa davantage à l’inscription politique des droits humains dans le cadre d’un État national qu’à l’affirmation générale des droits en tant que tels. Les droits de l’homme étaient politiquement ou socialement spécifiés : droit de vote, droit au travail, droit des nationalités »16. On voit que le combat contre la ségrégation raciale aux États-Unis, appuyé sur le pouvoir du tribunal de se prononcer sur l’inconstitutionnalité des lois, conformément à ce qui était préconisé par Tocqueville, s’inscrivait dans cette séquence. Cependant, poursuit Pierre Manent, « l’insistance mise sur les droits de l’homme aujourd’hui a incontestablement un accent antipolitique, une saveur an-archiste au sens étymologique du terme : on préfère l’homme au citoyen, on tend à rejeter les contraintes collectives liées à la citoyenneté »17. Ainsi la critique marxienne des droits de l’homme n’était pas totalement infondée, qui n’avait pas été aveugle à leur logique individualiste, donc à leur puissance de déliaison. Le développement de cette logique, qui est celle de la modernité démocratique, conduit à privilégier non plus le droit du citoyen à participer à la vie civique et à la décision collective, mais le droit privé de l’individu à faire reconnaître par la collectivité la singularité de sa nature et de ses choix, c’est-à-dire sa différence. La souveraineté du « c’est mon choix ! » s’est substituée à celle du « c’est notre choix. ». Marcel Gauchet a parfaitement décrit ce processus revendicatif en vertu duquel « c’est au titre de son identité privée qu’on entend compter dans l’espace public »18, ce qui conduit à une reconfiguration des rapports de la société civile et de l’État dans laquelle c’est à l’infinie diversité de celle-là qu’il revient de déterminer les fins de l’activité humaine tandis que c’est de celui-ci qu’on attend qu’il en reconnaisse la légitimité et qu’il leur donne les moyens de se réaliser : « on en est venu peu à peu à s’intéresser moins aux instruments du pouvoir des majorités qu’aux moyens de protéger les minorités »19. Dès lors le juridique tend à l’emporter sur le politique, puisque c’est au droit qu’il appartient de protéger les minorités : « davantage que des façons les plus directes et les plus sûres d’atteindre les buts définis par la volonté générale, on s’est mis à se tracasser des façons de contrôler la légalité, voire la légitimité constitutionnelle des décisions du législateur. La régularité des procédures en est venue à prendre le pas sur l’objet de la délibération ou de l’action publique. Nous avons glissé insensiblement dans une démocratie du droit et du juge »20. Ce glissement est corrélatif d’une évolution de la démocratie libérale selon laquelle le versant libéral, appuyé sur la primauté de la société civile, tend à prévaloir sur le versant démocratique, appuyé sur la primauté de l’État.
Volonté majoritaire et volonté générale
Le second problème est celui du rapport de la volonté générale et de la majorité : à quelles conditions la volonté de la majorité peut-elle s’identifier à la volonté générale et quelles sont les procédures qui permettent de produire une majorité qui puisse revendiquer cette légitimité ? On l’a vu, la volonté générale n’est pas la somme des volontés particulières, mais la volonté qui n’a d’autre objet que l’intérêt commun, qui découle de ce que les volontés particulières ont en commun, non pas les particularités qui peuvent les diviser et les opposer, mais la raison qui leur est commune : elle est donc volonté du raisonnable ou de l’universel. Or une majorité peut être une faction réunie autour d’intérêts particuliers dont la satisfaction pourrait être voulue par le plus grand nombre, mais non pas par tous : c’était le sens de l’exemple de Spencer donné plus haut. Il en résulte donc que seule l’unanimité peut garantir l’universalité de la volonté générale. Ainsi que l’écrit Rousseau : « plus les avis approchent de l’unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante »21. Cependant l’unanimité est de facto très difficile à obtenir et ne pourra donc être qu’approchée, comme le suggère la formule de Rousseau et comme le dira Sieyès : « L’unanimité étant une chose très difficile à obtenir dans une collection d’hommes tant soit peu nombreux, elle devient impossible dans une société de plusieurs millions d’individus. […] Il faut donc se contenter de la pluralité »22. Même dans une communauté assez restreinte pour que l’obtention de l’unanimité soit envisageable, il serait contestable d’en faire le critère et la garantie de la volonté générale car le veto d’une seule voix suffirait à invalider la volonté de toutes les autres, de sorte que c’est la tyrannie de la minorité sous sa forme la plus radicale qui serait ainsi instaurée. Dans une communauté plus vaste, le problème ne se pose pas et c’est la majorité qui devient le substitut de l’impossible unanimité, ce que Rousseau admet puisque pour lui seul le pacte social exige un consentement unanime, tandis que pour le reste « la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres »23.
Il n’en demeure pas moins que la volonté générale n’est pas telle par le nombre, mais par l’intérêt commun qu’elle vise. Il faut donc qu’elle ne soit pas aveuglée par l’intérêt particulier, il faut qu’elle se détermine en faisant taire les passions, il faut qu’elle puisse se soustraire à l’influence des démagogues qui flattent et entretiennent celles-ci. Le danger de l’aveuglement populaire a été perçu dès la naissance de la démocratie dans l’Athènes du Ve siècle, bien avant Platon. Hérodote déjà montre, au livre V des Histoires, qu’il est aisé de tromper le peuple et Thucydide, pour qui son manque de clairvoyance est une évidence24, crédite Périclès d’avoir régulièrement combattu les emportements populaires, allant jusqu’à renoncer à réunir ses concitoyens lorsqu’il avait une raison de redouter qu’ils ne prissent, sous l’effet des passions, une décision malencontreuse : « Périclès, convaincu qu’il avait raison de s’opposer à toute sortie, évitait de convoquer soit l’Assemblée, soit une réunion quelconque. Il craignait qu’une décision fâcheuse ne fût prise à la suite de délibérations au cours desquelles les Athéniens se laisseraient guider par la passion plus que par leur jugement »25. Si la volonté générale doit naître d’une délibération sereine où les entendements s’éclairent mutuellement dans le silence des passions, elle peut malaisément jaillir des mouvements impétueux d’une foule impatiente et mal informée. Elle suppose fondamentalement l’instruction et conjoncturellement une lente élaboration que la réunion du grand nombre ne permet guère. Comme le dira Durkheim : « De là ces conseils, ces assemblées, ces discours, ces règlements, qui obligent ces représentations à ne s’élaborer qu’avec une certaine lenteur. Nous pouvons donc dire en résumé : l’État est un organe spécial chargé d’élaborer certaines représentations qui valent pour la collectivité. Ces représentations se distinguent des autres représentations collectives par leur plus haut degré de conscience et de réflexion »26. Cette élaboration est donc davantage compatible avec le principe de la représentation et avec les médiations de la démocratie parlementaire. Cependant cette solution est elle-même source d’un nouveau problème, celui de la coïncidence de la majorité populaire et de la majorité parlementaire. Deux exemples permettront d’en prendre la mesure.
Majorité populaire et majorité parlementaire. Loi électorale et légitimité
À la fin des années 70, il y avait à l’Assemblée nationale une majorité en faveur de l’abolition de la peine de mort. En même temps, selon un sondage Figaro-Sofres du 23 juin 1978, 58% des Français étaient favorables au maintien de la peine capitale. À l’automne 1978 un groupe de députés UDF conduit par Pierre Bas ainsi que le groupe socialiste tentèrent de la faire abolir indirectement en votant des amendements contre les crédits destinés à l’entretien de la guillotine et à la rémunération du bourreau, mais le gouvernement imposa un vote bloqué pour s’opposer à ces amendements. Le 15 juin 1979, la commission des lois de l’Assemblée vota l’abolition, mais là encore le gouvernement, soucieux de l’état de l’opinion publique, œuvra pour empêcher que la proposition de loi inscrite à l’ordre du jour fît l’objet d’un vote. C’est seulement le 18 septembre 1981 que l’abolition fut votée à une écrasante majorité (363 voix contre 117) et promulguée le 10 octobre. Cependant le 9 octobre, un sondage Figaro-Sofres indiquait que 63% des Français étaient favorables au maintien de la peine capitale. On peut conjecturer avec vraisemblance que si le peuple avait été consulté par la voie référendaire, il aurait refusé l’abolition. Dans ces conditions, faut-il considérer que la volonté générale émane de la majorité parlementaire ou de la majorité populaire ? Le même problème s’est posé plus récemment avec le referendum de mai 2005 où la majorité populaire rejeta le projet de traité constitutionnel européen alors que la majorité parlementaire l’eût adopté, comme en témoigna trois ans plus tard la ratification par le Congrès de sa reformulation dans le traité de Lisbonne.
Il n’est pas facile non plus de s’accorder sur les mécanismes électoraux susceptibles de dégager une majorité qui pourra revendiquer légitimement l’identité de sa volonté et de la volonté générale. Là encore, deux exemples permettront de s’en assurer. En novembre 2016, Donald Trump était élu président des États-Unis d’Amérique avec trois millions de voix de moins que sa concurrente, ce que certains, en particulier en France, considérèrent comme un déni de démocratie. Ce phénomène, qui ne s’était produit que quatre fois depuis l’élection de George Washington en 1789, est possible parce que l’élection américaine se fait au suffrage universel indirect : les citoyens n’élisent pas un président, mais des grands électeurs et ce sont ces derniers qui élisent un président dont le rôle est de former l’exécutif d’une fédération d’États. Or dans un État fédéral, le nombre de représentants n’est pas exactement proportionnel à la population afin que même les États les moins peuplés puissent avoir voix au chapitre. Il en va de même d’ailleurs au Parlement européen : dès les années 50 les petits États, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, avaient obtenu un nombre de sièges supérieur à celui que leur aurait assuré une représentation proportionnelle. Toujours est-il que dans le cas américain la question peut se poser de savoir si c’est la majorité des électeurs ou celle des grands électeurs qui est dépositaire de la volonté générale.
Qu’on se remémore maintenant les conditions dans lesquelles Salvador Allende a été porté à la présidence du Chili en 1970. La droite s’étant présentée divisée à l’élection présidentielle, il avait obtenu 36,2% des voix contre 34,9% qui étaient allées au candidat conservateur et 27,8% à celui de la démocratie chrétienne. Or la constitution chilienne ne prévoit pas de second tour : lorsqu’aucun candidat n’obtient la majorité absolue, c’est le congrès qui départage par un vote les deux candidats arrivés en tête. Le congrès, qui était majoritairement à droite, aurait donc pu désigner le candidat arrivé en seconde position et il aurait eu d’autant plus de raisons de le faire que celui-ci avait davantage de chances de constituer une majorité cohérente en s’alliant avec le parti démocrate-chrétien dont il s’était détaché. Il fit pourtant le choix inverse et désigna le candidat qui avait obtenu une majorité relative. Là aussi on peut se demander si la majorité dont la volonté est supposée s’identifier à la volonté générale était celle des 36,2% qui avaient voté pour le candidat de l’Unité populaire ou celle des 62,7% qui avaient voté contre lui.
Ce dernier exemple n’est pas sans intérêt pour penser notre actualité politique. En effet, le président de la République qui vient d’être élu avec 66,06% des suffrages exprimés se voit opposer que cette majorité n’en est pas une. On fait valoir que 25,38% des électeurs s’étant abstenus et 11,49% de ceux qui ont participé au vote ayant déposé dans l’urne un bulletin blanc ou nul, ce ne sont en fin de compte que 43,63% des électeurs inscrits qui se sont prononcés pour lui, autrement dit qu’une nette majorité n’a pas voulu de lui. On ajoute à cela qu’une enquête d’OpinionWay montre que 45% des électeurs d’Emmanuel Macron ont voté pour lui non pas parce qu’ils adhéraient à son programme, mais parce qu’ils attendaient de lui qu’il batte la candidate qui lui serait opposée au second tour et on en conclut que son élection ne lui donne aucune légitimité pour appliquer un programme sur lequel il n’a été élu qu’en apparence. Or ce dernier argument est parfaitement analogue à celui qui a été opposé jadis à Salvador Allende : certes, son élection était légitime puisque conforme aux institutions, mais elle ne lui donnait aucun mandat pour appliquer un programme révolutionnaire qui avait été explicitement rejeté par près des deux tiers des votants. On ne discutera pas ici la valeur de cet argument, mais on se bornera à souligner qu’on ne peut le réputer valide dans un cas et pas dans l’autre.
Peut-être faut-il se résoudre à admettre que si la loi de la majorité est coextensive à la démocratie, il n’est pour autant pas possible d’en fournir une conception qui fasse l’accord universel des esprits et qui convienne à toutes les situations historiques, autrement dit que c’est toujours en fin de compte en vertu d’une convention, par définition contingente, qu’on détermine ce qui est la majorité dans une démocratie. En ce cas, la question de la légitimité renvoie à l’acceptation de la convention, au sens où Alain écrivait : « Ce qui est juste, c’est d’accepter d’avance l’arbitrage ; non pas l’arbitrage juste, mais l’arbitrage »27. Il reste aussi que l’assurance qu’a le gouvernant élu d’être le représentant légitime de la majorité ne le dispense pas de la vertu de prudence.
Notes
1– En ligne http://www.liberation.fr/debats/2016/09/22/d-une-tyrannie-a-l-autre-ou-le-piege-des-elements-de-langage_1506626
2 – Philippe Raynaud « De la tyrannie de la majorité à la tyrannie des minorités » Le Débat n°69 mars-avril 1992 p.59.
3 – Raymond Boudon « Que signifie donner le pouvoir au peuple ? » Communication à l’Académie des sciences morales et politiques 27 septembre 2010, sur le site de l’ASMP https://www.asmp.fr/travaux/communications/2010_09_27_boudon.htm
4 – Tocqueville De la démocratie en Amérique Livre I, 2e partie, Flammarion 1981, p. 348.
5 – Ibid.
6 – Spencer Le droit d’ignorer l’État § 4.
7 – Rousseau Du contrat social II, 3.
8 – Ibid. II, 1.
9 – Tocqueville op. cit., Flammarion 1981 T.1 p. 172.
10 – Raymond Boudon art. cit.
11 – Ibid.
12 – Ce conflit n’est cependant pas terminé puisque le Texas avait adopté en 2011 une disposition (Senate bill 14), subordonnant l’exercice du droit de vote à la présentation de pièces d’identité que les Afro-Américains et Hispano-Américains étaient plus nombreux que les autres à ne pas posséder. Cette disposition a été censurée comme discriminatoire en 2014, censure confirmée en appel en 2016.
13 – Philippe Raynaud art. cit. p.51.
14 – Ibid. p.54.
15 – Ibid. p.55.
16 – Pierre Manent Cours familier de philosophie politique Ch. IX Déclarer les droits de l’homme Fayard, 2001, p.165.
17 – Ibid.
18 – Marcel Gauchet La religion dans la démocratie, Gallimard 1998 Folio Essais p. 134.
19 – Ibid. p. 96.
20 – Ibid.
21 – Rousseau Du contrat social, IV, 2.
22 – Sieyès Préliminaires de la constitution française Paris, 1789, p. 38.
23 – Rousseau Du contrat social, IV, 2.
24 – Jacqueline de Romilly Problèmes de la démocratie grecque, Hermann 1975 Agora p. 59-60.
25 – Thucydide La guerre du Péloponnèse Livre II, chapitre 1, 22.
26 – Durkheim Leçons de sociologie PUF 1990, p. 86-87.
27 – Alain Propos 18 avril 1923.
© André Perrin, Mezetulle 2017.