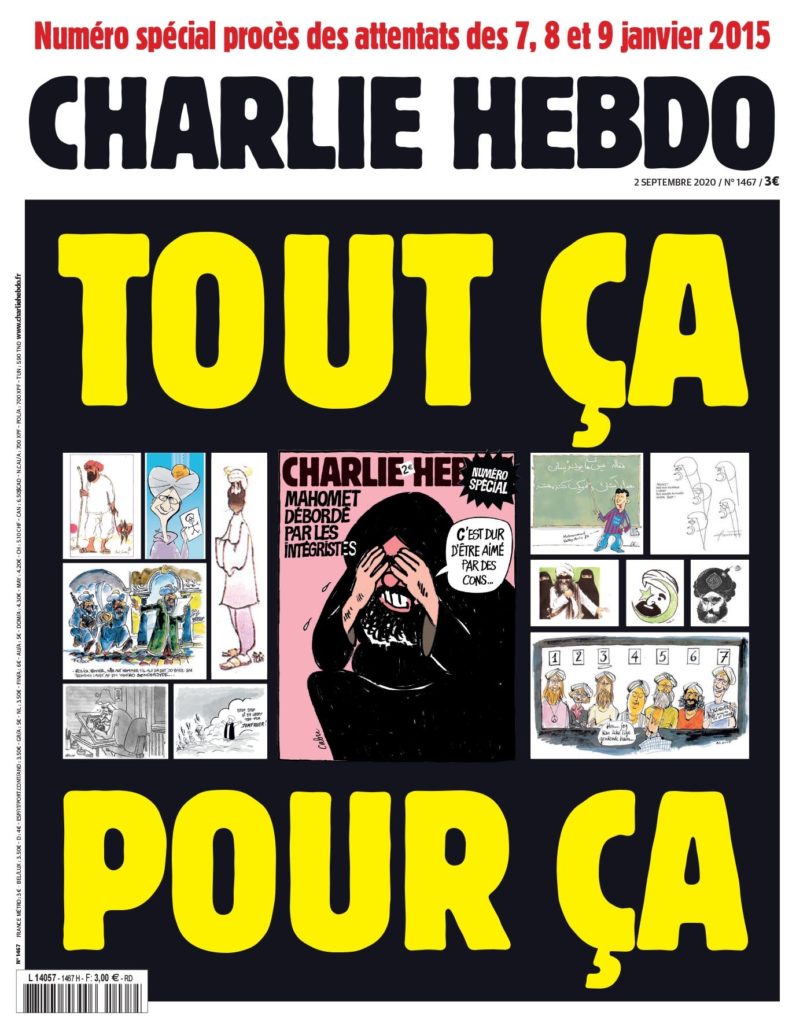Gildas Richard1 propose une réflexion de haut niveau qui nourrit un débat sur le rapport des religions monothéistes à la violence – débat inauguré par André Perrin ici même 2. La force de ce texte est qu’il examine le Coran, non en scrutant son contenu ni en le rapportant à son histoire, mais sous l’angle du statut du discours qui s’y déroule. Si Dieu doit être considéré comme l’auteur du texte, alors un certain nombre de questions et de conséquences en découlent, relativement à la nature du texte et à sa portée. L’ensemble, placé sous les catégories philosophiques de l’extériorité et de la clôture, conduit à une autorité absolue du texte, appelle à l’obéissance et fait de Dieu une entité entièrement tournée vers son bien propre qu’il s’agit de servir. Ce tableau sévère est construit déductivement avec un grand détail, et analysé indirectement par la lumière latérale qu’apportent des comparaisons systématiques et contrastées avec le christianisme. La pensée se déroule impeccablement et implacablement tout au long d’un texte-fleuve qui tient le lecteur en haleine.
Loin d’être conquise par sa conclusion plus que pessimiste s’agissant d’une possible réforme de l’islam – conclusion qui diffère très sensiblement de celle du texte d’André Perrin – , m’interrogeant parfois sur ses prémisses et ses non-dits3, j’ai été sensible à la puissance du texte, à sa poignante rigueur argumentative, à son élégance, à la hauteur de ses vues et, s’il ne fallait en retenir qu’une propriété, à son caractère résolument et magnifiquement spéculatif.
Et certes, on ne peut subir aucun dommage en prenant au sérieux des questions aussi profondes que le statut de la vérité, celui du discours et de la parole, celui du sujet et de la substance, de l’autorité et de l’obéissance ; et il n’est pas nécessaire d’être croyant pour s’interroger sur le rapport que le dieu du monothéisme entretient avec les hommes mais aussi avec lui-même. On ne peut sortir de là que revigoré, y compris dans les dissonances qu’on est alors invité à travailler. Parcourir un chemin, ce n’est pas le suivre aveuglément : on peut y découvrir des aspects de soi-même qu’on ignorait, des pensées qu’on ne savait pas qu’on pensait, outre que c’est toujours un plaisir d’être conduit par une main dont la fermeté s’autorise du rude exercice de la raison commune. C’est dans cette perspective que je convie les lecteurs à emprunter l’itinéraire d’altitude que trace l’auteur, et en souhaitant que la discussion qu’il devrait susciter en respecte et en conserve la hauteur.
1 – La question et la méthode
Nous partons d’un fait : des hommes exercent des actes de violence au nom de l’islam, affirmant que ces actes sont légitimés et même exigés par cette religion. Un tel constat, à lui seul, ne permet pas de répondre à la question de savoir si, en lui-même, l’islam est une religion qui appelle, favorise ou tolère la violence, et à cet égard il faut se garder de toute conclusion hâtive. Mais tout aussi clairement, ce constat oblige à poser cette question, en se gardant d’écarter hâtivement aucune conclusion par avance. Par suite, pour quiconque cherche loyalement à comprendre, un double écueil est ici à éviter : conclure immédiatement que l’islam est violent par nature, exclure tout aussi immédiatement la possibilité qu’il le soit. Dans le premier cas on se fierait aveuglément aux apparences, accordant aux terroristes que leurs actes sont bien justifiés par leur religion, au simple motif qu’ils le prétendent ; dans le second cas, on se fierait aveuglément à une opinion a priori, stipulant qu’il faut penser que l’islam ne promeut pas la violence ; dans un cas comme dans l’autre l’on affirmerait la réponse avant d’avoir examiné la question, et à vrai dire, avant de l’avoir seulement posée.
Or la vérité est bien que nous sommes, ou que nous devons nous mettre devant une question, qui a la forme d’une alternative simple : la violence des terroristes se réclamant de l’islam a-t-elle son origine véritable ailleurs que dans l’islam, dans des motivations et/ou des causes économiques, politiques, psychologiques, etc., de sorte que l’islam serait soit utilisé comme un prétexte, soit incompris, déformé et trahi, par ceux qui s’en recommandent de cette manière ? Ou bien y a-t-il dans l’islam, intrinsèquement et constitutivement, quelque chose qui favorise ou même implique la violence, de sorte que le recours à cette dernière ne résulterait pas d’une manipulation ou d’une trahison de cette doctrine religieuse, mais serait plutôt quelque chose comme une (des) manifestation(s) authentique(s) de son essence ?
Pour aborder cette question avec quelque chance de parvenir à un résultat solide, il faut commencer par repérer les lieux où la réponse, en toute rigueur, ne peut pas être trouvée. Ainsi l’histoire, qu’elle soit ancienne ou contemporaine, ne peut-elle nous être ici d’aucun secours. Elle n’a à nous offrir que des faits, et ces derniers, outre qu’ils peuvent toujours faire l’objet de contestation ou de déni, ne nous disent pas s’ils sont, ou non, les conséquences authentiques d’une certaine doctrine : or telle est précisément la question. Que l’islam se soit répandu principalement par la conquête militaire n’implique pas immédiatement que c’était là un mode de propagation qui lui fût consubstantiel. Que le monde musulman ait pratiqué l’esclavage sur une échelle spatiale et temporelle inégalée, sans que nulle voix ne s’élevât publiquement en son sein pour s’en offusquer, cela ne prouve pas immédiatement qu’une telle pratique est compatible avec la doctrine islamique. Qu’enfin de multiples violences aient été et continuent d’être commises en son nom – y compris en réaction à de supposées accusations de violence, comme dans l’affaire du Discours de Ratisbonne4 –, cela pourrait être imputable à la stupidité des hommes (surtout lorsqu’ils confirment le bien-fondé de l’accusation par la manière même dont ils y répondent) plutôt qu’à la religion elle-même.
Il faut donc se tourner vers la doctrine et elle seule, pour décider si les violences empiriques que l’on constate trouvent en elle leur véritable source. Et comme la doctrine est, ici, censée être contenue dans un livre (le Coran), examiner la doctrine de l’islam signifie nécessairement examiner ce livre. Mais encore cet examen peut-il prendre deux formes, qui ne s’excluent d’ailleurs pas, mais dont le sens et les résultats seront de natures différentes.
Premièrement, examiner la parole exposée dans le livre peut signifier : scruter son contenu matériel explicite, autrement dit ce qui y est effectivement formulé ou non ; il s’agit alors de voir si le texte contient des prescriptions, commandements, conseils, etc., qui encouragent ou promeuvent la violence. Nous n’emprunterons pas cette voie pour une double raison. D’une part, parce qu’elle a déjà été abondamment explorée, de manière telle qu’il n’y a guère à y ajouter. D’autre part et surtout, parce qu’un tel mode d’examen ne saurait échapper de façon décisive aux interminables querelles d’interprétation, ni aux discussions infinies à propos de la règle des versets « abrogeants », de sa légitimité intrinsèque – particulièrement sous le rapport de sa compatibilité avec le caractère censément incréé de la parole coranique – comme de ses modalités d’application.
Deuxièmement, examiner la parole coranique peut signifier : chercher à saisir son statut fondamental, autrement dit la nature même de la relation entretenue par cette parole avec celui qui la tient (censément Dieu lui-même), d’une part, et avec ceux à qui elle s’adresse (les hommes), d’autre part. Ce double point détermine directement le cadre, le sens et la nature profonde des relations pouvant et devant exister entre Dieu et l’homme – et, indirectement, entre les hommes eux-mêmes. À son tour la nature de l’horizon des relations possibles entre Dieu et l’homme décide de la place de la violence dans ces relations : sa présence ou son absence, sa présence accidentelle ou nécessaire, accessoire ou constitutive, momentanée ou indépassable. Enfin la nature de cet horizon détermine la place de la violence au sein des relations inter-humaines, dans la mesure où l’homme se comportera envers son semblable et envers lui-même en fonction de la considération et du genre d’attente que, selon lui, Dieu a envers l’homme.
Or la saisie de ce statut fondamental de la parole ne requiert pas de se plonger dans l’exploration du contenu matériel de cette dernière – ou plus exactement, cela requiert de ne s’y plonger que pour en extraire la forme, non pas bien sûr au sens littéraire, mais au sens logique et structurel de ce terme. Si, par exemple, l’on considère un instant ce mode de manifestation de la parole qu’est la dictée, on comprend que cette dernière instaure par nature un certain type de rapport entre celui qui l’énonce et celui qui la reçoit, et cela quelles que soient les choses dictées prises dans leur contenu déterminé. C’est ce genre de rapport qu’il s’agira pour nous de dégager du discours coranique, en une entreprise qui ne relève donc pas de l’interprétation au sens courant de ce terme, mais plutôt d’une herméneutique visant à manifester le genre de relation à l’autre qui anime et gouverne le texte dans sa totalité, et de manière nécessaire.
Il faut pour cela partir d’un peu loin, c’est-à-dire aborder des points qui paraissent à première vue sans rapport avec la question de la violence entre les hommes, mais qui, nous espérons le montrer, constituent en réalité les conditions d’intelligibilité de cette question.
2 – Dieu et sa parole
La parole réduite au discours
Puisqu’il est question d’envisager la parole coranique dans son principe d’unité et dans sa nature, la première question qui demande à être examinée est celle de la divinité de cette parole, autrement dit : la question du rapport fondamental existant entre Dieu et sa parole, tel qu’il peut être déduit de cette parole même. Dans l’islam en effet, la manière dont Dieu entre en relation avec l’homme consiste à lui communiquer sa parole. Le degré et la nature de la relation ainsi établie entre Dieu et l’homme dépend alors directement du genre de lien existant, selon cette religion, entre cette parole et Dieu lui-même : plus ce lien sera étroit, plus la communication de la parole s’apparentera, de la part de Celui qui la profère, à une communication de Soi, et plus la relation avec celui qui la reçoit sera alors elle-même intime et réelle.
Dans l’islam comme dans le judaïsme et dans le christianisme, Dieu adresse à l’homme une parole qui a la forme d’un discours, c’est-à-dire d’un ensemble de mots et de phrases ; dans l’islam ce discours est le Coran. Dès l’abord intervient un élément doctrinal qui distingue l’islam des deux autres monothéismes, à savoir que celui-là voit en Dieu l’auteur, au sens strict, du discours, tandis que ceux-ci voient en Lui son inspirateur. La différence est considérable, puisque, dans un cas (le Dieu inspirateur) l’homme est partie prenante dans l’élaboration du discours, alors que dans l’autre (le Dieu auteur) l’homme est pur réceptacle d’un discours qui a sa source entièrement hors de lui et uniquement en Dieu. De multiples conséquences en découlent, en particulier celle-ci : résultant d’une sorte de collaboration entre Dieu et l’homme, le discours inspiré est dès le principe le lieu et le début d’une rencontre entre Dieu et l’homme, alors que le discours dicté, étant l’œuvre de Dieu seul, maintient dès le principe une extériorité radicale entre Dieu et l’homme lors même que le premier entre en relation avec le second. Mais surtout, faire de Dieu l’auteur du discours coranique impose à l’islam d’affronter des difficultés qui lui sont propres, qui touchent à la conception de Dieu Lui-même, et plus particulièrement au rapport qu’Il entretient avec sa parole. Ces difficultés ont pour enjeu le redoutable écueil de l’anthropomorphisme. En effet, le discours fait de mots et de phrases est anthropomorphe, en ce sens que c’est précisément ainsi que l’homme parle ; faire de Dieu son auteur risque donc d’estomper ou même d’abolir la différence de nature qui existe entre Dieu et l’homme. Entre alors en jeu la question de savoir quel est le statut du discours de Dieu par rapport à Dieu Lui-même ; ce qui est clair, c’est qu’il provient de Lui, mais la nature de cette provenance demande, elle, à être éclaircie. Or lorsqu’on tente de le faire, on se heurte rapidement à une alternative qui a toutes les apparences d’une impasse.
Plus en effet cette provenance s’apparentera à une expression de soi, plus le discours aura pour contenu la pensée et la volonté mêmes de Dieu, mais plus il faudra en conclure que Dieu pense et veut comme un homme – puisque le discours, qui est humain, est apte à offrir une manifestation pleinement adéquate de cette pensée et de cette volonté. En sens inverse, plus le mode de provenance du discours s’apparentera à une création, c’est-à-dire à la position hors de soi de quelque chose d’autre que soi, « détaché » de soi, plus Dieu Lui-même sera préservé du caractère anthropomorphe qui affecte le discours, mais moins ce discours aura pour contenu ce que Dieu veut et pense – puisque cette pensée et cette volonté ne restent proprement divines qu’en n’entrant pas dans la forme du discours, qui est humaine. En bref : le discours étant anthropomorphe par nature, on voit mal comment il pourrait être divin sans que, du même coup, Dieu ne soit humanisé, ni comment on pourrait éviter d’humaniser Dieu autrement qu’en dédivinisant le discours.
Pour tenter de briser ce cercle, il faut considérer que le discours n’est ni la seule ni la meilleure forme que puisse prendre l’expression de la pensée et de la volonté de Dieu. Il faut, autrement dit, envisager l’existence d’une différence entre le discours de Dieu et la parole de Dieu, en définissant cette dernière comme expression non-discursive de la pensée et de la volonté de Dieu, expression totale et parfaite puisque exempte des limites constitutives du discours, et demeurant en Dieu Lui-même plutôt que lancée à l’extérieur de Lui. Le discours coranique serait alors comme une « traduction », destinée à l’homme, de la pensée et de la volonté de Dieu, ou du moins de ce que Dieu décide d’en communiquer à l’homme, et l’anthropomorphisme serait évité.
Mais ce sont alors d’autres difficultés qui surgissent, et qui conduisent à douter que l’islam puisse établir une véritable différence entre discours et parole divins. Tout d’abord cette tentative de différenciation pose problème dans la mesure où le texte coranique semble la contredire, lorsqu’il suggère une stricte identité entre le discours que Dieu adresse à l’homme, et la parole éternelle de Dieu5. L’affirmation de cette identité est à rapprocher de la thèse, devenue orthodoxe dans l’islam, du Coran incréé6. Ensuite, même si l’on préserve l’existence d’une parole divine distincte du discours divin, celle-ci ne pourra qu’être fondamentalement de même nature que ce dernier : en effet quel que soit son contenu, et bien que celui-ci demeure inconnu et inconnaissable pour l’homme (puisque non traduit, ou non traduisible en mots et en phrases), ce qui est bien certain c’est qu’il ne peut être précisément qu’un contenu, quelque chose, un ensemble de pensées et de volontés, et donc autre chose que Dieu Lui-même, qui, pour sa part, est la source de ce contenu, un sujet – non pas quelque chose mais Quelqu’un. Cette appartenance de la parole à la catégorie du « quelque chose » relativise de manière essentielle la différence pouvant exister entre elle et le discours, puisque celui-ci, aussi bien, relève de cette même catégorie : un discours si beau et si vrai soit-il est toujours tout autre chose que le sujet qui en est l’auteur, et l’altérité qui l’en sépare est précisément celle qui se tient entre quelque chose et quelqu’un.
Ainsi donc, dans l’islam, soit il n’y pas du tout de parole de Dieu demeurant distincte du discours de Dieu, soit il y en a une mais elle n’est pas fondamentalement d’une autre nature que lui. Et Dieu, quant à Lui, demeure nécessairement distinct de l’une comme de l’autre, car Il n’est évidemment pas un ensemble de mots et de phrases, ni même un ensemble de pensées et de volontés ; inversement, selon l’islam la parole de Dieu n’est pas de même nature que Lui (un sujet, une personne, quelqu’un) mais seulement choses dites ou choses pensées, choses voulues – ou, comme l’on pourrait encore dire, non pas une parole parlante mais une parole seulement parlée. En elle la nature de sa source, qui est précisément celle d’une source ou d’un sujet, ne s’est pas communiquée ni introduite, mais elle lui reste extérieure : la parole est « divine » non pas en ce sens qu’elle aurait Dieu pour substance et contenu, encore moins en ce sens qu’elle serait elle-même Dieu, mais seulement en ce sens qu’elle a Dieu pour auteur, qu’elle est « sa » parole.
Ce point ressort avec netteté si l’on établit une rapide comparaison avec ce qu’il en est dans le christianisme. Dans cette religion en effet, le Verbe éternel de Dieu est vu comme étant tout autre chose qu’un discours, adéquatement traduisible en mots et en phrases, qui aurait seulement comme caractère distinctif d’être « celui de Dieu » : ce Verbe est lui-même sujet vivant et agissant – et à vrai dire, d’une vie et d’une volonté qui ne sont autres que celles de Dieu même. Parce qu’en lui Dieu se « dit », et qu’en lui par conséquent il est Lui-même effectivement présent, ce n’est justement pas d’un simple « dire » qu’il s’agit là, mais bien d’une absolue expression ou d’un engendrement, dont le fruit est de même nature que la source. Le christianisme affirme ainsi une différence principielle et essentielle entre parole et discours : dans le second est absente la dimension de l’expression de soi et de la communication de soi, qui caractérise la première ; aussi le discours est-il vu comme ne pouvant être qu’une lointaine image, une première et imparfaite apparition de ce qui, en soi, est d’un tout autre ordre : il est d’emblée envisagé par rapport à un au-delà de lui-même, en lequel il est appelé à s’accomplir7. – Mais dans l’islam il en va tout autrement : il y a d’une part un sujet de parole, et d’autre part une parole seulement parlée – un ensemble de choses dites ou pensées, voulues ; d’une part ce que Dieu dit, pense et veut, et d’autre part ce que Dieu est ; et la différence entre les deux est posée comme première, définitive et indépassable, comme l’atteste l’aptitude reconnue au discours (et donc au livre) d’être l’expression pleinement adéquate de la parole de Dieu – au moins pour la part de celle-ci que Dieu décide de communiquer à l’homme.
Force est d’en conclure que la parole de Dieu telle que la conçoit l’islam ne diffère pas fondamentalement de la parole humaine, qui, tout aussi bien, consiste en mots et en phrases, ne présente pas le caractère de sujet vivant qui est celui de son auteur, et ne peut donc être que quelque chose alors que ce dernier est quelqu’un. – C’est la crainte de briser l’unité de Dieu en le « dédoublant », en faisant surgir un « deuxième Dieu », qui conduit l’islam à refuser le statut de personne à la parole divine. Mais il court ainsi le risque de tomber d’un faux Charybde en un vrai Scylla, et de n’éviter un polythéisme peut-être tout apparent que pour chuter dans un anthropomorphisme bien réel.
Un discours doublement clos
La seconde caractéristique essentielle de la parole divine telle que la conçoit l’islam est qu’elle se présente comme un discours clos, complet et définitif, et cela en un double sens.
D’une part, c’est un discours qui ne sera désormais suivi d’aucun autre discours venant de Dieu8. La parole coranique est l’ultime rappel de ce que Dieu a dit précédemment, qui énonce de façon complète la pensée et la volonté de Dieu concernant l’homme – ou du moins, celles que Dieu veut communiquer à l’homme par ce moyen – et qui est donc sans « après ». Le « sans après » dans le temps est ici la traduction d’un « sans après » en soi, le Coran étant alors, pour ainsi dire, ce en quoi le sens chronologique et le sens ontologique du « sans après » se rejoignent. Il en va de même dans la direction opposée : non seulement sans après, le discours coranique est aussi sans avant. Créée ou incréée, la parole de Dieu n’a que Dieu en amont d’elle-même ; pas plus qu’elle n’a à être prolongée ou complétée, elle n’est elle-même le complément ou le prolongement de rien. C’est la fameuse thèse islamique selon laquelle les discours divins précédant le Coran (la Bible, juive ou chrétienne) étaient, en leur contenu, identiques à celui-ci, mais ont été déformés par leurs récepteurs9. Le Coran ne fait que rétablir dans son intégrité un discours déjà tenu ; ce qui semble l’avoir précédé n’était en fait rien d’autre que lui, de sorte que rien ne l’a réellement précédé. – Le discours coranique occupe ainsi intégralement et à lui seul l’espace, ou plutôt le temps, du discours divin, ne laissant place à aucun autre.
Mais d’autre part et surtout, le discours coranique est clos et définitif en ce sens qu’il ne laisse aucune possibilité à la parole divine de prendre une meilleure forme que celle du discours. Non seulement il ne sera suivi d’aucun autre discours, mais il ne sera suivi de rien d’autre qu’un discours : clôture pleinement ontologique cette fois. En aucune façon le texte coranique ne s’avoue ni ne se montre comme ce que l’on pourrait nommer une contestation textuelle de la textualité, ou une auto-négation du discours comme forme ultime de la parole, autrement dit : la manifestation ou l’indication, par des mots, que la parole de Dieu ne consiste finalement pas en des mots, le renvoi, de l’intérieur du discours lui-même, à un au-delà du discours, et donc l’aveu que le discours n’est là que pour annoncer et servir une tout autre modalité de la parole. – Ici encore la comparaison avec le christianisme peut jeter une lumière vive sur la particularité de la position islamique. Si l’on considère en effet le statut fondamental de l’Évangile dans l’économie globale de la doctrine chrétienne, on ne peut manquer de voir que le discours fait de mots s’y nie lui-même comme mode d’être véritable de la parole. Annonçant et affirmant que le Verbe de Dieu est quelqu’un, une personne, et non pas un ensemble de pensées ou de volontés exprimables au moyens d’éléments sonores ou graphiques, et effectuant cette annonce précisément au travers de tels signes, l’Évangile se donne par là comme le discours qui dit que la parole de Dieu n’est pas discours. C’est le livre qui affirme l’impuissance radicale et définitive de tout livre à délivrer vraiment la parole divine. L’on a pu dire qu’il est en cela « le dernier de tous les livres », non pas au sens (qui sera celui de l’islam) où il serait l’expression ultime de la parole, mais au sens où s’y donne à voir définitivement la disproportion infinie entre parole et discours – et cela au moyen du discours lui-même, qui atteint ainsi son comble. C’est, si l’on ose le dire ainsi, le livre en lequel s’accomplit et se dépasse la « librité » elle-même – livre qui délivre du livre.
Ce dépassement du livre est rejeté par l’islam et interprété par lui comme une détérioration du livre. Le discours prétendant se nier lui-même comme mode ultime de la parole ne peut être à ses yeux qu’un discours faussé, mal compris ou sciemment déformé, cette négation étant sentie par lui comme un préjudice fait au discours, qu’il s’agirait alors de réparer. C’est le Coran qui est censé constituer cette réparation, en tant qu’il rétablirait le discours divin dans son intégrité. En croyant ainsi que toute l’affaire est de revenir à un discours intact, l’islam ignore et exclut la possibilité de passer du discours à autre chose. Il referme la brèche en et par laquelle le discours s’ouvrait sur ce qui l’outrepasse infiniment, suturant ainsi ce qu’il croit être une plaie.
Aux yeux du christianisme, ce soi-disant remède est en réalité le véritable préjudice, et l’islam porte atteinte au discours précisément là où il croit lui porter secours. Car si la destination la plus authentique du discours est de faire signe vers une parole que lui-même n’est pas, qui est personne et non chose, alors le refermer sur lui-même n’est pas le guérir mais le blesser ; il serait même plus juste de dire qu’en un sens, il y a bien guérison, mais que c’est alors la guérison qui est elle-même et en tant que telle la blessure. Inversement, ne se tourner vers le discours que pour s’en détourner au profit de ce que lui-même indique comme son au-delà, ce n’est pas le fausser mais le garder intègre ; ou pour mieux dire là encore, c’est le blesser en effet, mais d’une blessure qui précisément le sauve10. – Là donc où l’islam s’évertue à mettre en avant le livre parfait, le christianisme veut mettre en lumière ce qui est plus parfait que tout livre. Du même mouvement, là où l’islam pense honorer Dieu en faisant de Lui le meilleur des écrivains, c’est-à-dire en le plaçant au premier rang à l’intérieur d’un registre qui demeure humain – celui du discours11 –, le christianisme ne voit en cela qu’un très insuffisant hommage, et reconnaît bien plutôt la divinité de Dieu dans son aptitude à dépasser absolument un tel registre12.
Un indépassable principe d’autorité
La double clôture qui vient d’être indiquée entraîne à son tour une conséquence capitale, appelée à affecter (ou manifester) directement le genre de considération que Dieu a pour l’homme, et indirectement – mais nécessairement – le genre de considération que les hommes peuvent et doivent avoir les uns pour les autres.
Tout comme il en va pour l’homme, la parole de Dieu comme discours est autre, en nature et en contenu, que celui qui la profère. Mais alors que le discours humain peut être, ou s’efforcer d’être l’expression d’un vrai ou d’un bien universels, distincts du locuteur, ayant leur sens et leur consistance en eux-mêmes, il ne peut en aller de même pour le Dieu de l’islam. Le discours de ce dernier ne saurait en effet tenir sa valeur de sa conformité à un référent autre que Lui-même : cela placerait Dieu en position de subordination à l’égard d’un Vrai (ou d’un Bien) que Lui-même ne serait pas – un peu comme il en va du démiurge platonicien à l’égard des Idées. C’est là, on le comprend, un point qui vaut pour le monothéisme en général.
Mais il en est un second, qui tient à la spécificité du Dieu de l’islam. Car le discours de celui-ci ne saurait non plus tenir sa valeur du fait qu’en lui Dieu, ne faisant qu’un avec le Vrai, se dirait, de sorte que provenir de Lui et être vrai coïncideraient absolument par identité médiate de l’universel et du singulier en Dieu – un peu comme si, cette fois, l’Idée platonicienne du Bien se mettait à parler, non pas fictivement et sur le mode de la prosopopée, mais effectivement en tant qu’agent de sa propre expression : son discours étant alors aussi bien celui d’un sujet nécessairement singulier, que constitué d’un contenu pleinement universel.
Cela supposerait, en effet, que Dieu soit à la fois l’universel qui est dit et le singulier qui dit, à la fois le contenu et l’auteur, le sujet singulier ne se distinguant pas du contenu universel, dans la mesure où il ne serait que le soi de celui-ci, et s’en distinguant cependant dans la mesure où serait ainsi exprimé, par lui, autre chose que sa singularité pure, idiosyncrasique et arbitraire. Il y faudrait donc l’existence en Dieu d’une distance et d’une altérité intérieures qui, loin de briser l’unité du Soi, l’accomplissent en une vivante union avec Soi-même. Une telle constitution intime, faisant pour ainsi dire de Dieu comme universel son propre référent comme sujet singulier, suppose d’une part que le singulier sorte de son statut de source pure et immédiate – de sujet pensant mais non lui-même pensé – pour devenir substance intelligible, puisqu’il est lui-même le contenu exprimé ; et d’autre part que l’universel sorte de son statut de simple Idée – de chose seulement pensée mais non elle-même pensante – pour devenir sujet, puisqu’il est lui-même l’agent de l’expression. Le premier point contient et implique la substantialité du sujet, le second la subjectivité de la substance ; et ce dernier, pris en lui-même, signifie précisément que c’est ce qui est dit qui parle, ou que la parole est non seulement quelque chose mais encore quelqu’un. Mais le Dieu de l’islam, on l’a vu, est seulement parlant (ou pensant), c’est-à-dire sujet, et sa parole est seulement parlée (ou pensée), c’est-à-dire idée, quelque chose. La parole divine ne peut alors tenir son universalité ni de son Auteur, car il faudrait qu’elle soit expression de Soi de Celui-ci, et donc elle-même sujet : ce que l’islam refuse ; ni d’autre chose que Lui, car cela signifierait qu’existe un Vrai autre que Dieu et indépendant de Lui : ce qui ne se peut.
Il en ressort que le discours du Dieu de l’islam doit être tenu pour vrai parce que c’est le sien, sans que cette provenance ne puisse signifier une auto-expression du Vrai lui-même ; c’est uniquement par sa singularité que l’auteur, ici, garantit le discours. C’est la définition même du « principe d’autorité », porté ici à l’absolu. Selon le sens bien connu de ce « principe », l’autorité dont il s’agit là ne réside pas dans l’aptitude à voir, comprendre et exposer un contenu universel, vrai en soi, mais dans le fait de se poser soi-même, en tant que ce singulier-ci, comme source et gage de vérité. Et une telle manière d’être auteur ne saurait, ici, être provisoire, mais elle se présente au contraire comme indépassable et définitive, dès lors qu’il ne peut être fait appel à aucune universalité qui serait soit extérieurement soit intérieurement distincte de Celui qui parle. Le discours coranique est ainsi fondamentalement autoritaire non seulement pour nous, mais en soi. – Il y eut un temps dans l’histoire du monde islamique où cette question fut discutée : le discours divin (coranique) est-il vrai en vertu de son contenu, par conformité parfaite à un « Vrai en soi » ? Ou bien l’est-il en vertu de son Auteur, et donc uniquement parce que c’est Lui qui le dit ?13 Mais premièrement, le fait même que l’on ait pu voir là les termes d’une alternative entre lesquels il fallait trancher montre que, dès le principe, l’idée d’une expression de soi du Vrai, d’une identité médiate de l’universel et du singulier était exclue. Deuxièmement, il apparaît à la lumière des analyses qui précèdent que, si c’est la deuxième branche de l’alternative qui s’est finalement imposée14, on ne doit pas y voir seulement un fait historique contingent mais l’issue nécessaire du débat, étant donnée la conception de Dieu posée au départ15.
Il est permis de remarquer qu’en cela, le discours « divin » se montre inférieur au discours humain, ce dernier ayant du moins la possibilité de chercher à se conformer à un universel, si bien que pour lui le principe d’autorité reste, en droit, toujours dépassable. Mais pour notre propos, l’essentiel est d’en déduire le genre de rapport à l’autre impliqué par ce rapport entre le sujet et sa parole. La forme première et fondamentale du rapport à l’autre est ici celle du rapport entre Dieu et l’homme.
3 – Dieu et l’homme
La réception de la parole divine
Le mode de réception de la parole découle directement de la nature de cette dernière. Réduite au discours, et au discours indépassablement autoritaire, la parole divine islamique demande à être reçue immédiatement, et cela en deux sens conjoints.
L’immédiateté de la réception est d’abord à entendre de manière temporelle, en ce sens que, idéalement, le contenu doit être apporté et reçu de façon instantanée, comme en un éclair. Ensemble clos ayant pour source un sujet sans épaisseur, son entrée dans le temps doit s’effectuer autant que possible en un point de celui-ci, lui-même sans épaisseur – et si l’islam doit bien admettre que la réception de la « parole divine » par son prophète a pris un certain temps, il a toujours eu soin de donner à cette durée la plus grande brièveté possible, et mis en avant cette brièveté comme un gage d’authenticité du message lui-même. La raison le plus souvent avancée est que ce non-étalement dans le temps met le message à l’abri des erreurs dans sa transmission et sa notation ; mais peut-être faut-il voir, plus fondamentalement, dans cette brièveté temporelle, comme une manifestation et une confirmation du caractère éternel du message et de la singularité absolument ponctuelle de sa source. Cette façon d’entrer dans le temps est une manière de ne pas y entrer – ou d’en ressortir aussitôt sans avoir à séjourner en lui –, de réduire au minimum tout commerce avec lui, et par là d’exclure que le rapport entre Dieu et l’homme puisse prendre la forme et le sens d’une rencontre au sein d’une histoire : nous y reviendrons.
C’est donc encore et surtout en un sens conceptuel et spirituel qu’il faut entendre l’immédiateté de la réception de la parole coranique. Cette parole est à réceptionner sur le mode du constat et de l’enregistrement, comme le donne à entendre le fameux dogme de la « dictée » divine : dogme logique et cohérent, qui énonce simplement le mode de transmission appelé par la nature du contenu. Celui qui tient un discours exprimant sa volonté singulière et arbitraire ne peut que le dicter, c’est-à-dire attendre de ceux à qui Il l’adresse qu’ils l’apprennent et, lorsque ce discours est prescripteur d’actes, qu’ils l’appliquent. Sous ces deux formes, l’extériorité entre auteur et discours se répercute et se maintient en extériorité entre discours et auditeur.
L’« apprentissage », consistant alors essentiellement en une inscription dans la mémoire (appelant par suite la pratique de la récitation) est une intériorisation qui, conservant la radicale extériorité de ce qui est reçu, n’en est pas une – pas davantage, et pour cause, que la profération du discours ne signifiait l’extériorisation de Soi d’un universel en droit intelligible. L’« application » de son côté consiste en la mise en œuvre d’actes et de gestes valant immédiatement par leur conformité avec le discours, ne nécessitant ni le bouleversement ni l’engagement de l’intériorité – pas davantage, et pour cause, que l’Auteur Lui-même n’avait engagé la sienne dans l’acte de profération de son discours.
Cette extériorité de l’Auteur par rapport à son discours, la non-insertion ou le non-engagement de son être en celui-ci, est la raison profonde pour laquelle l’islam est un légalisme, offrant un code de conduite dont le respect ou le non-respect sont offerts à la visibilité extérieure, empiriquement constatables, et donnent matière à jugement juridique. La tentative d’instaurer, avec le contenu prescriptif, un rapport plus intérieur, et donc de dépasser la simple application pour accéder à une reconnaissance du bien-fondé en soi des prescriptions, doit nécessairement se heurter à l’absence de dimension universelle du discours divin, signalée plus haut. Dans le courant soufiste, particulièrement chez Ghazali, se trouve bien une telle tentative, un souci de surmonter l’extériorité dans le rapport au discours divin et à Dieu Lui-même16 ; mais l’adhésion intérieure, à la fois morale et mystique, qui est ainsi cherchée, ne peut finalement signifier que la reconnaissance de l’autorité, non son dépassement ; l’admission de sa réalité de fait, non de sa légitimité fondamentale – sauf à définir la légitimité comme conformité à un ordre naturel des choses, dans lequel c’est la volonté du plus puissant qui prévaut. Davantage même, si le discours ne trouve sa justification ultime que dans la singularité et donc dans « l’autorité » de son auteur, la tentative d’adhésion intérieure prend au fond le sens d’une impiété, car elle implique de détacher le contenu de la pure singularité de l’auteur et d’apprécier sa consistance sub specie uniuersalitatis, autrement dit à l’aune d’autre chose que Dieu Lui-même. Inversement la « vraie » piété doit nécessairement consister à admettre que la prescription est bonne avant tout, et même uniquement, parce que c’est ce Singulier-ci qui l’énonce ; ce qui bloque toute intériorisation véritable. – C’est sans doute pourquoi, historiquement, le courant soufiste est resté marginal, voire regardé comme plus ou moins hérétique par l’islam orthodoxe. Cette issue est logique, s’il est vrai qu’un authentique dépassement du légalisme requiert des conditions que la doctrine islamique ne permet pas de remplir : en dernière analyse, comme nous le verrons, le primat de l’amour.
Le mode de réception de la parole divine impliqué par l’islam diffère de celui qu’implique le christianisme, autant que la réception d’un dépôt diffère de l’absorption d’une nourriture. Le premier de ces modes consiste à installer en soi quelque chose qui laisse fondamentalement intact – et donc séparé – le soi qui accueille, le contenu restant aussi distinct du donataire qu’il l’est originellement du donateur, ne pouvant pas plus être assimilé par celui-là qu’il n’avait pu être engendré par Celui-ci. Le second mode de réception consiste pour le donataire à laisser sa substance même être pénétrée par un contenu qui lui communique la sienne, et donc à faire communier le donataire avec la source de cet apport, dans l’exacte mesure où, dans ce dernier, cette source est elle-même présente : ainsi le contenu prend-il la consistance de la parole (et non du simple discours), et la source le visage du Père (et non d’un simple Auteur ou, si l’on ose jouer sur le terme de « dictée », d’un Dictateur). – La « digestion » en quoi consiste alors la réception est assurément bien différente de la digestion organique, déjà par le fait qu’elle ne détruit pas mais conserve ou même engendre à nouveau le contenu sur lequel elle s’exerce. Elle s’en distingue encore par ceci, qu’elle a pour but de transformer la substance de ce qui reçoit en celle de ce qui est reçu, et non l’inverse : l’aliment, loin d’être soumis au jugement de l’organisme qui l’absorbe – par mise au rebut de ce qu’il comporte d’inassimilable pour ce dernier – invite au contraire l’organisme à se réformer, pour évacuer de lui-même tout ce qui est inhospitalier au contenu accueilli. Mais elle s’y apparente bien sur ce point essentiel, qu’est niée l’extériorité réciproque de ce qui est reçu et de ce qui reçoit, que le contenu est effectivement fait sien par le destinataire, s’insère dans la constitution la plus intime de celui-ci, qui en est alors nourri17. Tel est manifestement le sens que confère le christianisme à son sacrement de l’eucharistie, moment essentiel de la réception de la parole de Dieu selon cette religion, et pour cela logiquement considéré par elle comme un aspect central de la vie religieuse du croyant18.
À l’arrière-plan de cette différence se laisse entrevoir un trait de la réception propre à l’islam, qui en confirme et en clarifie encore la nature. Comme le souligne à juste titre R. Brague, il n’existe rien dans l’islam qui s’apparenterait aux sacrements du christianisme, c’est-à-dire rien qui aurait pour sens et pour fonction d’aider l’homme à recevoir, en lui apportant non seulement un certain contenu mais encore tout ou partie de la réceptivité elle-même19. Le Dieu de l’islam laisse l’homme livré à lui-même devant l’apport qu’Il lui délivre, comme si, en énonçant son discours, Il avait fait le maximum de ce qu’Il veut ou peut faire pour l’homme. Apprendre et appliquer un discours ne requièrent rien d’autre que ce dont l’homme est capable par lui-même. – Dans le christianisme, Dieu est pour l’homme source d’un apport qui excède radicalement les capacités de réception naturelles de ce dernier ; ce qu’Il donne est infiniment plus que ce qui est possible pour l’homme, et même que ce qui est souhaitable par lui – à savoir, en dernière analyse, Lui-même. C’est donc à être exhaussé au-dessus de lui-même, à être affranchi des limites constitutives de son être, que l’homme est ici convié : Dieu ne se contente pas de combler le désir humain, Il veut l’amplifier infiniment pour le hisser à Sa divine (dé)mesure. Aussi l’homme ne recevra-t-il pas ce dont il s’agit, si l’on se contente de placer devant lui une offre comme si celle-ci était proportionnée à son horizon d’accueil.
Cette différence est évidemment liée à la différence des contenus apportés : discours d’un côté, parole de l’autre. La spécificité de cette dernière est que, comme engagement de soi dans l’extériorité, vers l’autre et pour lui, elle est non seulement offre de nourriture mais, d’emblée et conjointement, promesse de visite et de rencontre – et constitue déjà un début d’accomplissement de cette promesse. Or de façon générale, ce n’est déjà pas une même chose de recevoir quelque chose et d’accueillir quelqu’un – tout comme, du côté de la source, il y a bien de la différence entre envoyer un message à quelqu’un et venir le voir. Mais lorsque la personne à accueillir est l’absolu en personne, la différence prend une ampleur infinie : il ne suffira pas, pour recevoir, de ranger et d’apprêter la maison, mais il faudra laisser l’arrivant la rebâtir Lui-même de fond en comble afin qu’elle devienne pour Lui un séjour. Et il faut supposer pour cela qu’en Lui le désir de la rencontre est bien grand.
Le bien de Dieu et le bien de l’homme
Or précisément, ce qu’impliquent et révèlent la nature de la parole divine et le mode de transmission correspondant, tels que les envisage l’islam, c’est que, dans cette religion, la rencontre entre Dieu et l’homme n’est ni possible ni souhaitable. Rencontrer, en effet, ne prend son véritable sens que si, au-delà de la simple vision ou contemplation – qui demeurent unilatérales – est réalisée une communion, le partage d’une même vie et d’un même principe d’animation, comme le suggèrent les images chrétiennes de l’habitat et du repas en commun. La vraie rencontre, en somme, ne se fait que dans et par l’amour mutuel. Mais comme le laisse voir le mode de réception qui vient d’être examiné, il demeure et il doit demeurer, dans l’islam, un abîme infranchissable entre Dieu et l’homme alors même que l’un établit une relation avec l’autre. Discours, livre et dictée sont les moyens adéquats pour qui veut entrer en relation mais non entrer en contact, établir un lien fondamentalement unilatéral (l’homme étant lié à Dieu mais non l’inverse) qui lui permette de demeurer, au sens premier du mot, intact.
Précisément, l’incapacité du Dieu de l’islam à être touché, tactus – et ici cela signifie aussi et surtout ému (« mis en mouvement »), affecté – apparaît comme le corrélat logique de son incapacité à se communiquer, à se donner. Passage de soi en une extériorité, réception d’une extériorité en soi : dans les deux cas cela suppose rupture avec l’unité absolument immédiate du point géométrique, dont rien ne sort et où rien n’entre ; et à l’inverse, nécessairement, présence d’un rapport médiat de soi à soi, manière d’être un qui est unification plutôt que plate unité, souplesse infinie plutôt que minéralité inentamable. C’est seulement l’existence d’une telle vitalité interne qui rend possible, dans le même mouvement, la sortie hors de soi sans dissolution de soi, en direction d’un autre que soi, et l’accueil en soi de cet autre sans dénaturation de soi.
Certes il faut bien admettre, pour le Dieu de l’islam, la possibilité d’un certain affectus ou tactus, d’une certaine forme d’é-motion ; car en dictant à l’homme un discours, Il est nécessairement animé d’une certaine intention ou volonté, et par l’attente d’une certaine réponse. Il s’expose ainsi à la possibilité que son discours soit reçu ou non, appris et appliqué ou non, plus ou moins rapidement et plus ou moins complètement ; partant, la réponse de l’homme peut, si l’on ose dire, ne pas le laisser « de marbre », éventuellement le contrarier. Mais, premièrement, cette simple possibilité suppose bien une certaine plasticité intérieure, aucun sentir d’aucune sorte n’étant possible pour un être qui adhère absolument à soi-même sans écart : ce qui paraît déjà malaisément compatible avec la manière dont l’islam conçoit l’unité de Dieu. Deuxièmement, à supposer même qu’il soit possible, un tel affectus résulterait seulement d’un souci de Dieu pour la réalisation de sa volonté, ce qui n’équivaut pas du tout immédiatement à un souci de Dieu pour la réalisation du bien de l’homme, autrement dit à un affectus véritable, consistant à être touché non seulement par l’autre, mais pour lui.
Les deux termes, réalisation de la volonté de Dieu et réalisation du bien de l’homme, peuvent certes coïncider ; mais cette coïncidence peut être conçue de deux manières, qu’il importe fort de distinguer. Une première manière de les faire coïncider est de considérer que le bien de l’homme consiste dans la réalisation de la volonté de Dieu, celle-ci n’ayant pas pour autant nécessairement le bien de l’homme pour but : Dieu aurait une volonté, définie dans son contenu et dans son orientation purement à partir de Lui-même, et il n’y aurait rien de mieux pour l’homme que de s’y conformer. Une seconde manière de faire coïncider les deux termes consiste à croire que le bien de l’homme est lui-même un but pour la volonté de Dieu, et non simplement l’un de ses effets : Dieu voudrait le bien de l’homme pour l’homme lui-même, ce qui signifierait alors qu’Il ferait consister tout ou partie de son propre bien dans la réalisation du bien de l’homme. Si s’ajoute à cela l’idée que Dieu est Lui-même le Bien – l’universel en personne, et non un pur singulier – vouloir le plus grand bien de l’homme signifierait pour Dieu : vouloir que l’homme L’atteigne, Le rencontre et partage sa vie.
Or la première manière d’identifier les deux termes est conforme à la conception islamique de Dieu, de son rapport à son discours, et du rapport qu’Il entend établir avec ceux à qui Il l’adresse. Le discours qui énonce une volonté reflétant seulement la singularité de son auteur est et ne peut être que dicté. Le but d’une dictée qui se présente alors comme forme indépassable de la parole est l’obéissance comme forme indépassable de la réponse. L’obéissance dès lors qu’elle est indépassable est simple soumission, et loin d’être la forme première et provisoire de l’accès du soumis à son bien, elle constitue elle-même le bien de celui-ci, n’y ayant pour lui rien à attendre ni à atteindre au-delà de celle-ci en guise de mode de relation avec Dieu. Quant au bien de Celui qui soumet, dans la mesure où la direction qu’Il exerce est la forme ultime et indépassable de son rapport à ce qui n’est pas Lui, il se confond symétriquement avec l’obtention de cette soumission, c’est-à-dire avec l’instauration d’un rapport conforme à ce qu’Il est : une singularité reposant immédiatement en et sur elle-même, absolument au-delà de tout ce qui n’est pas elle, qui n’attend et ne peut attendre que la reconnaissance de cet être-au-delà lui-même.
Aussi, si le bien de Dieu et celui de l’homme consistent tous deux dans la soumission de l’homme à la volonté divine, il n’y a là qu’une coïncidence extérieure et apparente des deux biens – un « bien commun » qui n’en est pas un puisqu’il exclut toute communion. Ce qui le confirme, c’est la nature de la félicité promise à l’homme dans l’au-delà, autrement dit du plus grand bien auquel l’homme puisse aspirer et atteindre. Dans l’au-delà tel que l’islam le conçoit, l’homme et Dieu seront tous deux « satisfaits »20, mais sans que cela signifie, du côté de Dieu, que sa satisfaction résulte de celle de l’homme, comme s’il avait souci de ce dernier pour lui-même : rien ne s’oppose ici à ce que Dieu soit « satisfait » de l’homme, comme un maître peut l’être d’un esclave obéissant. La satisfaction de l’esclave n’est pas elle-même le but du maître, ni la cause de sa satisfaction à lui. Peu importe ici que la suprême félicité humaine ait une forme grossière, comme le texte du Coran peut le laisser croire (lait, miel et vierges21), ou qu’elle soit en vérité bien plus raffinée et plus spirituelle, allant jusqu’à la contemplation de la Face divine ; railler le texte coranique sur ce point serait facile mais passerait aussi à côté de l’essentiel. L’essentiel tient en ceci que, dans l’au-delà coranique, l’homme ne découvre pas à quel point le bien de l’homme est essentiel aux yeux de Dieu, et donc à quel point Dieu, qui est Lui-même le bien absolu, veut se donner à l’homme, faisant ainsi éclater les limites du désir humain, mais seulement comment Dieu peut remplir ces limites, en se montrant à lui autant qu’elles le permettent. Ce n’est pas l’amplification infinie du désir humain qui a lieu, la libération complète de l’homme à l’égard de l’étroitesse de son désir (si spirituel soit-il), mais seulement la satis-faction complète de ce désir – son remplissement maximal et, par là-même, sa clôture définitive. En ne donnant à l’homme que le maximum de ce qu’il est capable d’espérer et de recevoir par lui-même, Dieu ne brise pas l’insuffisance de l’homme mais la confirme, tout comme il confirme son refus de renoncer à sa propre auto-suffisance et à l’indépendance de son bien par rapport à celui de l’homme. Même dans l’au-delà le Dieu de l’islam ne se donne pas, ne laisse pas l’homme s’introduire en sa vie ; sa vie et celle de l’homme restent radicalement distinctes. – Il n’est pas excessif de dire qu’en cela, le paradis musulman a pour véritable sens la confirmation ultime de la non-rencontre, l’enfermement éternel de l’homme en lui-même et hors de Dieu, le maintien de Dieu au-delà de l’ « au-delà » promis à l’homme.
En sens inverse – et c’est la seconde façon d’identifier réalisation de la volonté de Dieu et réalisation du bien de l’homme – faire de l’accession de l’homme à son bien, Son bien à Soi ; Se savoir et Se vouloir comme étant Soi-même le bien de l’homme, et par suite, ne pas vouloir rester Soi-même intact si l’homme reste étranger à son bien, c’est-à-dire à Soi-même : c’est précisément ainsi que le Dieu du christianisme regarde l’homme, et c’est précisément ainsi que le Dieu de l’islam ne peut le regarder. Le regard sur l’homme du premier diffère de celui du second autant que le regard d’un père sur son enfant, ou celui d’un ami sur son ami, diffère du regard d’un chef sur son subordonné, ou d’un juge sur son justiciable. Cette différence consiste très simplement en ceci que le père souffre de la souffrance de son enfant, que l’ami est vulnérable aux blessures de son ami, le bien de l’enfant étant constitutif du bien du père comme le bien de l’ami constitue celui de son ami. Alors ce qui arrive à l’homme, et plus encore, ce que l’homme se fait à lui-même, cela arrive et est fait aussi bien à Dieu lui-même, qui s’en trouve atteint. Les plaies de l’homme deviennent les siennes, particulièrement celles qui ont pour sens et pour source les manquements de l’homme à son propre bien, que Dieu ne dissocie point du Sien : Il est non seulement offensé mais blessé chaque fois que l’homme se manque à lui-même22.
Mais qu’à Dieu l’homme puisse manquer, non seulement en ne lui accordant pas l’obéissance qui Lui est due, mais encore en étant cause, par là, d’un vide douloureux en Lui – de sorte que Dieu serait en manque de l’homme –, cela ne se peut dans l’islam. Son Dieu ne peut ni ne veut être pour l’homme un ami, et il ressemble en cela au dieu dont Aristote disait que nulle amitié ne peut exister entre l’homme et lui23 ; pas davantage un père, si ce n’est encore au sens où les Grecs anciens entendaient ce terme, lorsqu’ils en faisaient un qualificatif de Zeus, à savoir le détenteur de la puissance (il faut se rappeler ici ce qu’était un père dans l’esprit et dans le droit des Grecs anciens). Pour l’islam comme pour le paganisme antique, l’invulnérabilité reste un des attributs essentiels de l’Absolu. Les errements de l’homme peuvent à la limite irriter ou décevoir Celui-ci, mais non lui faire mal – et tel est le sens de sa « patience » : non la disposition à endurer la souffrance, mais l’assurance de n’y être jamais exposé.
Ce que l’homme vaut
Un mot résume ce qui est ainsi exclu par l’islam, comme mode de rapport entre Dieu et l’homme : l’amour. Mot qui peut bien être présent dans le texte coranique, sentiment qui peut bien être invoqué et revendiqué dans l’islam, surtout dans ses courants mystiques, mais à peu près exclusivement dans le sens d’un « amour » de l’homme pour Dieu ; et, lorsque par exception c’est l’amour de Dieu pour l’homme qui est évoqué, le terme reste sans réel contenu24. Or si aimer signifie vouloir le bien de l’autre pour lui-même, voir et traiter l’autre comme ayant une importance infinie en lui-même, appelant et justifiant un dévouement inconditionnel, et impliquant l’acceptation de souffrir par et pour l’autre, alors le Dieu de l’islam n’aime pas l’homme. La logique interne de l’islam implique même davantage que la simple absence d’amour. Loin que Dieu vise l’homme – chaque homme – comme une fin en soi, objet d’une sollicitude première et inconditionnelle, c’est en sens inverse l’obéissance de l’homme qui est fondamentalement la condition de la bienveillance de Dieu pour lui. L’homme n’aura d’importance et de valeur aux yeux de Dieu que pour autant qu’il recevra son discours, selon la double immédiateté indiquée plus haut.
Le Dieu de l’islam, en effet, ne se règle pas sur le bien de l’homme en et pour lui-même, mais sur l’accomplissement de Sa volonté. Par suite, le statut et la valeur que l’homme aura aux yeux de Dieu dépendent de la position que l’homme adopte par rapport à la volonté divine. Si l’homme refusant de se soumettre à cette volonté s’éloigne par là de son bien, ce n’est pas cet éloignement-là qui déterminera la réponse de Dieu à une telle conduite, mais bien plutôt l’éloignement, qui en résultera pour Dieu, de la réalisation de Son vouloir. Aussi la réponse de Dieu à l’insoumission n’aura-t-elle pas pour principe de tout faire pour que l’homme revienne vers son propre bien, comme si cela était important en soi (ainsi qu’il en va pour celui qui aime), mais de tout faire pour que Lui-même accomplisse sa volonté en dépit de ce qui y fait obstacle. Dans une telle logique, Dieu ne peut se montrer bienveillant pour l’homme ni lui reconnaître une valeur malgré son insoumission – et encore moins faire de ce manquement un motif de sollicitude accrue pour lui. Là où le Dieu du christianisme, berger paternel et aimant, se soucie d’autant plus de l’homme que celui-ci, brebis égarée, se détourne davantage de Lui25, le Dieu de l’islam se détourne de celui qui se détourne de Lui, faisant du détournement de celui-ci la cause et la mesure du sien26; tout au plus peut-Il se montrer « clément » ou « aimant » à l’égard de celui qui s’est engagé dans la voie de l’obéissance comme rapport le plus parfait à Lui, autrement dit à l’égard du musulman et de lui seul27.
Quant à celui qui se refuse à cet engagement, Dieu ne peut que se désintéresser de lui, et ce désintérêt peut se marquer de plusieurs façons. La plus radicale sans doute consiste à exclure le récalcitrant de l’ensemble des êtres susceptibles de soumission volontaire, autrement dit à ne plus voir en lui un être vraiment humain. Dans l’islam en effet, le propre et la grandeur de l’homme ne consistent pas dans la capacité de cet être à dépasser la simple soumission comme mode de rapport à Dieu, mais dans sa capacité à adopter volontairement ce mode de rapport, qui vaut pour les autres créatures aussi bien. Ce rapport est à la fois indépassable et nécessaire, car directement impliqué par la nature même du Dieu islamique ; la question n’est pas de savoir si la soumission de l’homme aura lieu ou non, mais seulement de savoir si elle sera volontairement accordée ou involontairement subie. Dans le premier cas l’homme se sera comporté en homme, accomplissant la fonction qui le définit en propre ; dans le second il aura refusé d’exercer cette fonction et se sera mis ainsi, à l’égard de Dieu, dans le même rapport que les êtres dépourvus de volonté. C’est pourquoi, selon une traduction possible d’un verset du Coran, l’homme réfractaire à la conversion islamique devient par là-même aux yeux de Dieu comme « le pire des animaux » 28 – idée qui n’est manifestement pas sans lien avec la pratique intensive de l’esclavage par le monde islamique : nous y reviendrons. Plus modérément et en jouant sur le double sens du mot « bête » en français, l’insoumis peut être vu comme un imbécile agissant contre son propre intérêt, se rendant indigne, par son endurcissement, que l’on continue de se soucier de lui. Mais dans un cas comme dans l’autre, son attitude fait injure et même obstacle à Dieu, dont le souci suprême et même unique est l’accomplissement de Sa volonté.
Aussi l’insoumis ne peut-il être plaint (il faudrait pour cela que son bien ait quelque importance en soi), ni même seulement ignoré, mais conformément à son statut d’obstacle il doit être finalement supprimé, et en tant qu’obstacle volontaire, puni. La punition consistera pour lui à être dévoré d’une éternelle souffrance qui ne sera point, comme dans le christianisme, l’accomplissement intérieur du tort qu’il se fait à lui-même, mais le prix de celui qu’il aura de facto prétendu infliger à Dieu – moyennant quoi cette punition aura fondamentalement le sens d’une vengeance. L’attitude « divine » à l’égard de l’homme est ici celle d’un maître qui énonce sa volonté, avertit, prévient, menace, et qui, ayant rappelé une bonne et dernière fois sa volonté, détruit ceux qui s’acharnent à ne pas s’y plier, en un « que puis-je faire de plus ? » et un « tant pis pour vous » exempts de douleur, suivis d’un châtiment appliqué sans tristesse29.
Sens et place de la violence dans l’horizon fondamental de la relation
Si nous considérons enfin l’ensemble de ces éléments afin d’en dégager l’horizon global des relations possibles entre Dieu et l’homme selon l’islam, nous voyons que cet horizon a pour clef de voûte, ou principe d’unité, l’accomplissement de la volonté de Dieu, celle-ci étant indépassablement singulière et ne visant qu’elle-même comme but. Par rapport à ce vouloir divin, l’homme a le statut fondamental de créature elle-même douée de volonté, cette dernière étant entendue toutefois comme simple pouvoir d’accepter ou de refuser : devant l’arbitraire de la volonté divine se tient la volonté humaine comme libre-arbitre – faculté qui n’engendre rien mais élit ou rejette des contenus extérieurement rencontrés. Le rapport spécifiquement humain à la volonté divine consiste alors en ce que cette dernière, dictée au moyen d’un discours, est placée devant l’homme comme contenu à élire, et par rapport à cette volonté, les possibilités de positionnement de l’homme se déploient entre les deux pôles de l‘instrument et de l’obstacle. Corrélativement, les possibilités de positionnement de Dieu par rapport à l’homme sont comprises entre la figure du maître qui accorde la jouissance et celle de la puissance qui détruit – récompense et destruction ayant en commun d’arriver à l’homme là aussi de l’extérieur, et pour résultat soit d’enfermer l’homme définitivement en lui-même en comblant le désir humain (« paradis »), soit de l’arracher à lui-même sans fin (« enfer »).
C’est, pensons-nous, ce cadre structurel qui constitue le « noyau dur » de la doctrine, sa colonne vertébrale, son centre de gravité, son esprit directeur, et c’est lui qui permet de discerner, parmi les éléments souvent divergents et parfois contradictoires du discours coranique, ceux qui tiennent à l’essence profonde de la religion islamique, et ceux qui, par rapport à cette essence, doivent être tenus pour contingents. Or dans un tel cadre la violence, comme non-respect de la libre intériorité de l’autre, occupe une place significative, à titre de possibilité légitime et suffisante. – Tandis en effet que l’amour, par nature, ne peut être que librement donné et n’existe que comme mouvement intérieur spontané, l’obéissance comme soumission admet par nature la contrainte et peut être obtenue de cette façon. Aucune force, pas même (et à vrai dire surtout pas) celle de Dieu, ne peut forcer à aimer. L’amour ne peut être qu’offert et demandé. Aussi le Dieu qui aime l’homme, et qui, parce qu’Il l’aime, veut être aimé de lui (en tant qu’Il est Lui-même le plus grand bien possible pour l’homme), ne peut fondamentalement adresser à l’homme qu’une invitation, lui faire une avance, le prier de bien vouloir accepter son offre. La formulation de cette avance pourrait être :
« Laisse-moi te rendre capable de Me recevoir, et de recevoir ainsi infiniment plus que ce que tu es capable de désirer. Cela n’est possible que si tu y consens, ma volonté ne peut s’accomplir ni contre la tienne ni sans elle, et c’est précisément ma volonté que ma volonté dépende ainsi de la tienne ».
Mais le Dieu qui veut seulement être obéi peut, quant à Lui, passer outre à l’adhésion intérieure de l’homme, car ce qu’Il attend de lui est d’une nature telle que cela peut être imposé. Certes, on l’a vu, il dépendra de l’homme que sa soumission à Dieu soit volontaire – mais non pas que son rapport à Dieu soit autre chose qu’une soumission. Or si un amour contraint n’est pas un amour, une soumission contrainte est une soumission. Et si la soumission volontaire est « meilleure » que la soumission contrainte, elle ne l’est que dans la mesure où il y aura de toute façon soumission, celle-ci constituant l’horizon indépassable de la relation. Ainsi ce Dieu-là n’adresse-t-il pas à l’homme une avance mais un avertissement, qui pourrait être :
« Que tu le veuilles ou non ma volonté s’imposera à toi. Ton assentiment n’est pas indispensable pour qu’elle se réalise, et c’est précisément ma volonté que ma volonté ne dépende que d’elle-même et pas de la tienne. Autant donc y consentir : tu obtiendras ainsi le maximum de ce que tu peux espérer, la totale satisfaction des désirs que tu es capable d’avoir par toi-même ».
Dans cette perspective en effet, l’esprit et le ton ne peuvent être ceux d’une invitation à établir une collaboration en vue de faire naître ensemble quelque chose (la plénitude de la rencontre), mais sont nécessairement ceux d’un appel ou d’un rappel à l’ordre, en vue de la réalisation d’une décision unilatérale (le maintien de l’abîme). Il ne s’agit pas d’exhausser l’homme mais de le (re)mettre à sa place, qui est celle d’un serviteur et non d’un ami30. La menace de violence, lors même qu’elle n’est pas explicite, se laisse entendre – ou « entr’entendre », comme l’on dit « entrevoir » – immédiatement sous la surface du discours, rumeur sourde qui accompagne comme son ombre la promesse de clémence, nullement incompatible avec cette dernière. Car la clémence n’a pas pour contraire la violence mais l’intransigeance, comme refus de tout écart et de tout délai entre ce qui doit être et ce qui est. Le contraire de la violence n’est pas la clémence, mais l’amour – et la violence reste, avec la clémence, l’une des modalités au moins possibles de l’exercice de l’autorité telle que celle-ci a été définie plus haut. Aussi ce qui a lieu ici n’est point l’exclusion fondamentale, radicale et définitive de la violence, mais l’affirmation au moins implicite de sa légitimité constitutive. Et ce qui autorise à l’affirmer, ce n’est pas le nombre et la fréquence des passages coraniques incitant à la violence, mais l’essence même de Dieu, celle de l’homme et celle de leur rapport, telles qu’elles se laissent déduire du statut fondamental de ce discours.
Ce regard du Dieu de l’islam sur l’homme va logiquement déterminer le regard que les hommes peuvent et doivent avoir les uns sur les autres.
4 – L’homme et l’homme
Être homme, être musulman
On l’a vu, selon l’islam, être un homme au sens plein du terme signifie : accepter d’être un instrument de la volonté de Dieu. Cette acceptation doit se traduire dans l’existence concrète d’une manière qui, formellement, peut être considérée comme double.
Le premier aspect, que l’on peut caractériser comme « positif », consiste pour l’homme à faire ce qui lui est présenté comme bon par le discours divin, et à s’abstenir de ce que ce même discours présente comme mauvais. Il s’agit d’une part d’accomplir certains actes déterminés, tels que la prière et les rites qui l’entourent, le pèlerinage, etc., de s’abstenir de certaines nourritures et certaines pratiques (l’usure par exemple), etc. ; d’autre part et de manière plus intérieure, de croire en Dieu tel que le Coran le montre, c’est-à-dire une singularité absolue qui ne vise que soi et sa propre volonté comme fin en soi. Quant à ce dernier point, il s’agit pour l’homme d’adopter le positionnement correct par rapport à Dieu, de « se tenir » devant Lui d’une manière conforme à Son essence, et cette manière consiste, en amont même de la décision d’être un instrument du vouloir divin, dans l’acceptation de l’alternative entre être instrument et être obstacle, dans la reconnaissance de ce que c’est devant ce choix que l’homme est fondamentalement placé – ou encore, comme l’on pourrait dire : dans la soumission à l’alternative entre soumission et insoumission.
Le second aspect, qui peut être caractérisé comme « négatif » et qui est directement corrélatif du précédent, consiste pour l’homme à supprimer ce qui fait obstacle à la volonté de Dieu, aussi bien en lui-même (combat intérieur) qu’en-dehors de lui (combat extérieur). Or de même qu’être un instrument du vouloir divin consiste d’abord à admettre que l’alternative décisive est celle de l’instrument et de l’obstacle, de même l’obstacle radical à la volonté divine sera constitué, non par celui qui optera pour la seconde branche de l’alternative, mais par celui qui refusera l’alternative dans son entier, et se tiendra tout à fait en-dehors de celle-ci – soit en croyant qu’un tout autre rapport à Dieu est possible (voire souhaitable), soit en ne croyant tout simplement pas en un Dieu unique, ou de quelque autre manière encore. Car la « simple » adoption du statut d’obstacle, par exemple en négligeant ou en refusant l’accomplissement de certaines prescriptions divines, ne remet pas directement ni nécessairement en cause l’essentiel, à savoir que l’homme est l’être qui doit choisir entre soumission et insoumission. Inversement, ne pas se soumettre à l’alternative entre soumission et insoumission constitue une contestation du dispositif doctrinal en son entier, une négation de la nature de l’homme, de Dieu lui-même, et de leurs rapports tels que l’islam les envisage.
Or l’acceptation de cette alternative définit, en même temps que l’homme véritable, le musulman comme tel ; sa méconnaissance, son ignorance ou son refus définissent symétriquement le non-musulman comme tel. Si donc l’islam implique que l’homme doit, en tant qu’instrument de Dieu, écarter tout obstacle à l’accomplissement de la volonté de Dieu, et d’abord l’obstacle le plus radical, cela signifie que les rapports entre musulmans et non-musulmans présenteront trois caractéristiques fondamentales : le non-musulman ne peut être vu comme un homme au sens plein du terme ; il doit être supprimé comme obstacle et/ou transformé en instrument ; et cela non d’abord pour son bien à lui mais pour celui de Dieu. – C’est le second de ces points qui dessine la tâche ou la « mission » du musulman à l’égard du non-musulman, tâche dont il faut, pour finir, préciser l’esprit et les modalités.
Sens et formes des rapports entre musulmans et non-musulmans selon l’esprit de l’islam
La suppression de l’autre comme obstacle à la volonté de Dieu et/ou sa transformation en instrument de cette volonté, formant les deux faces de l’attitude fondamentale envers l’autre, constituent aussi le principe à partir duquel se laissent déduire les formes concrètes essentielles que cette attitude peut prendre. Ces formes correspondent aux différentes possibilités de positionnement fondamental de l’homme devant la volonté divine, à savoir : l’obstacle involontaire, l’obstacle volontaire, l’instrument involontaire et l’instrument volontaire. Il en découle trois possibilités fondamentales de traitement d’autrui : en tant qu’il est à supprimer comme obstacle volontaire ou involontaire à la volonté de Dieu, le non-musulman est à éliminer ou à convertir (et il est, dans ce dernier cas, transformé du même coup en instrument volontaire de cette volonté) ; en tant qu’il est à conserver comme instrument involontaire de la volonté de Dieu, le non-musulman est à asservir.
a. Conversion. La forme la plus parfaite du rapport à l’autre, et celle qui réclame l’examen le plus étendu, est la tentative de conversion puisque c’est elle qui permet d’atteindre le but dans sa forme la plus parfaite : donner à Dieu de nouveaux instruments volontaires. Elle est du même coup la forme la plus parfaite de l’élimination. Elle consiste, positivement, à favoriser la soumission volontaire à la volonté de Dieu, et négativement, à éliminer non pas les personnes, mais ce qui, en elles, résiste à cette soumission. Cela du reste, aussi bien en soi-même qu’en autrui : car le musulman qui lutte contre ses penchants intérieurs allant à l’encontre de la volonté divine vise, au fond, à faire disparaître ce qu’il y a encore de non-musulman en lui.
En ce sens, le prosélytisme comme tentative de conversion est impliqué par la doctrine islamique elle-même, en son fondement, et non par quelque tendance psychologique ou sociologique à la « domination » ou à « l’affirmation de soi ». En visant comme but la conversion de l’humanité à l’islam, le musulman est fidèle à l’esprit fondamental de sa religion, et inversement il y dérogerait s’il n’œuvrait pas directement ou indirectement à ce but. À cet égard, nul appel à la « tolérance » ne peut avoir sérieusement de sens ni d’efficacité, si bien intentionné soit-il, et quand bien même il émanerait de certains musulmans, si tolérer veut dire (conformément au sens faux, mais désormais courant de ce terme) : reconnaître les autres religions, ou l’absence de religion, comme ayant même valeur et même « droit à exister » que l’islam. La seule tolérance qui puisse ici être envisagée, et qui est d’ailleurs la tolérance en son sens véritable, est celle qui consiste à supporter qu’existe ce qui, en soi, ne devrait pas exister ; acceptation, donc, par essence conditionnelle et provisoire, ou définitive seulement par défaut, si l’éradication de ce qui ne devrait pas être apparaît comme excédant les forces humaines. – Considéré ainsi formellement, le prosélytisme islamique paraît être inhérent au monothéisme comme tel plutôt qu’à la version particulière qu’en offre l’islam ; et il semble qu’il ne diffère pas en cela du christianisme, dont on peut dire qu’il vise lui aussi, constitutivement, à la conversion universelle. Mais en réalité, les raisons déjà indiquées qui déterminent l’islam au prosélytisme confèrent à ce dernier un sens bien spécifique, fort différent de celui qui caractérise le prosélytisme chrétien.
Ici se fait sentir en effet toute la différence, vue précédemment, entre le regard du Dieu islamique et celui du Dieu chrétien sur l’homme. Tout comme le chrétien, le musulman prosélyte peut et doit être animé de la sincère conviction qu’il œuvre pour le bien de l’humanité, qu’il apporte à autrui sinon son salut, du moins les conditions de son salut, et qu’il agit ainsi généreusement envers lui. Mais tandis que le salut selon le christianisme consiste pour l’homme à laisser Dieu le rendre capable de devenir pour Lui un fils et un ami, le salut selon l’islam consiste pour l’homme à se reconnaître comme étant pour Dieu un serviteur et un instrument. Ce dernier statut, selon l’islam et ainsi qu’on l’a vu, est de toute façon celui de l’homme ; aussi s’agit-il, dans le prosélytisme islamique, d’amener l’autre à reconnaître et à assumer ce fait, qu’il est soumis à la volonté de Dieu, et que son bien consiste à l’être volontairement. Deux conséquences essentielles en résultent.
Premièrement, ce n’est pas d’abord et essentiellement le bien de l’homme qui est ici visé par la conversion, mais celui de Dieu, qui en est fondamentalement distinct et qui le restera éternellement. La volonté du Dieu de l’islam, en effet, n’a point le bien de l’homme pour fin en soi, mais seulement pour effet conditionnel. Par suite, si le non-musulman se convertit, ce sera un bien pour lui, mais ce n’est pas ce bien-là qui peut et doit être la raison déterminante de l’opération ; car de ce bien-là, Dieu Lui-même ne se soucie pas comme d’une chose essentielle à ses yeux. – C’est pourquoi il ne peut exister, dans l’islam, rien d’équivalent à l’esprit missionnaire chrétien ; celui-ci en effet, qui consiste dans la tentative de proposer à l’autre l’amour de Dieu (au double sens du génitif), suppose que le bien d’autrui soit visé comme une fin en soi, c’est-à-dire de la manière dont Dieu Lui-même le vise. Envoyer au loin, en territoire inconnu ou hostile, des hommes isolés et désarmés, pour prêcher la parole de Dieu : cela ne se peut que par amour. Ici également le prosélytisme invite bien à l’acceptation d’un fait : non pas toutefois celui de la petitesse de l’homme devant la puissance de Dieu, mais celui de l’amour de Dieu malgré l’indignité de l’homme. D’autre part la conversion chrétienne vise certes le bien de Dieu mais tout aussi essentiellement le bien de l’homme, puisque le bien de l’homme est une fin en soi aux yeux de Dieu Lui-même ; non seulement viser autrui comme une fin en soi n’est pas incompatible avec la volonté de Dieu, mais c’en est l’exact accomplissement. L’islam, en lequel il ne s’agit pas d’aimer autrui par amour de Dieu, mais d’obéir à Dieu et d’amener autrui à donner à Dieu l’obéissance qu’Il réclame, n’envisage certes pas ainsi l’entreprise de conversion, et ce n’est pas non plus dans le don de sa vie pour une telle fin qu’il fait consister le martyre. Ce dernier se définira bien plutôt comme perte de la vie au cours d’une tentative, soit de détruire l’autre, soit de le dominer ; sacrifice qui réalise jusqu’au bout le statut d’instrument – non pas toutefois d’instrument d’un amour à proposer, mais d’une volonté à imposer.
Deuxièmement et par conséquent, s’agissant de sa modalité, la conversion selon l’islam peut être obtenue par la menace sans que cela ne contredise radicalement son sens. Sans doute est-il impossible de forcer quelqu’un à adhérer intérieurement à une doctrine ou à une croyance ; et sans doute la conversion demeure-t-elle imparfaite, qui consiste en l’adoption extérieure de certaines pratiques alors que persiste, dans le secret de la conscience, une indifférence ou même une hostilité à l’égard du contenu de foi en lui-même. Mais dans l’islam ce contenu consiste précisément dans l’affirmation d’un pur rapport d’autorité entre Dieu et l’homme, c’est-à-dire d’un rapport fondamentalement et définitivement extérieur. De ce fait l’adhésion intérieure, tout en étant préférable, se trouve frappée de contingence, et ne peut apparaître comme absolument indispensable à la réalité de la conversion. La volonté de l’homme ainsi converti peut bien rester, en son intimité, extérieure ou même hostile, il n’en reste pas moins que dans les faits cet homme se comportera exactement comme un bel et bon instrument de la volonté de Dieu (sans compter que, dès la génération suivante, l’éventuelle résistance intérieure aura toutes les chances de disparaître).
b. Élimination. La suppression physique du non-musulman, en cas de refus obstiné de toute forme de conversion à l’islam, ne peut certes être appliquée à la légère, ni considérée comme le meilleur des rapports à avoir avec le non-musulman ; mais elle ne peut pas non plus être tenue pour absolument incompatible avec l’esprit de l’islam, et l’on ne peut rien trouver en cet esprit qui s’y oppose radicalement. Vaut-il mieux laisser en vie le récalcitrant, soit en comptant sur une évolution ultérieure de ses dispositions, soit en estimant que son attitude est suffisamment résiduelle pour que l’on puisse sans inconvénient la laisser s’éteindre naturellement, soit, enfin, en considérant que son asservissement contribuera mieux à l’accomplissement de la volonté de Dieu ? Vaut-il mieux le supprimer purement et simplement ? C’est là fondamentalement affaire de circonstances, voire d’arbitraire personnel, et il n’y a entre ces différentes « solutions » qu’une différence de degré. Dans tous les cas, en effet, sera obtenu le résultat nécessairement exigé par le cœur de la doctrine : que soit écarté un obstacle à la volonté de Dieu, médiatement ou immédiatement.
Ici se retrouve la possibilité de la clémence et de la tolérance, mais précisément (on l’a vu plus haut) comme simples suspensions d’une violence qui, en droit, demeure possible et légitime. En refusant de devenir (ou de rester : cas de l’apostasie) un instrument volontaire de la volonté de Dieu, l’homme renonce du même coup à ce qui peut donner à son existence un caractère sacré ou même simplement précieux aux yeux de Dieu Lui-même. Il fait de lui-même un être à la valeur contingente et relative, dont l’estimation est légitimement livrée à la fluctuation des conditions extérieures. – On a souvent fait remarquer que, dans le Coran, les variations dans les prescriptions concernant les non-musulmans, allant de l’appel au meurtre à l’injonction de bienveillance, étaient liées de manière troublante avec les fluctuations de la situation de Mohammed, au moment de leur promulgation. Mais au lieu de n’y voir qu’un indice de l’origine purement humaine du discours coranique, il faut souligner ici que ce lien entre circonstances contingentes et nature des injonctions n’est pas lui-même contingent, et découle avec nécessité de la doctrine plutôt que de la subjectivité particulière de son messager. Si le traitement à infliger au non-musulman dépend de facteurs circonstanciels, et si l’élimination physique figure au nombre des traitements possibles, ce n’est pas essentiellement dû aux aléas de la vie de Mohammed, mais au fait que l’homme – tout homme – n’a pas de valeur absolue et inconditionnelle aux yeux du Dieu de l’islam.
c. Asservissement. Pour cette même raison, l’esclavage n’est ni ne peut être fondamentalement exclu par l’esprit de la doctrine islamique, trouvant au contraire une place naturelle et légitime dans l’horizon des rapports entre les hommes, qui est constitutif de l’islam. L’essentiel à cet égard a été vu plus haut, et ne demande qu’à être brièvement précisé.
Refuser de devenir (ou de rester) musulman, c’est s’exclure soi-même de la communauté des hommes au sens plein du terme, c’est-à-dire des êtres destinés à se soumettre volontairement à la volonté de Dieu ; c’est du même coup se rapprocher des êtres non-humains qui, pour leur part, se caractérisent par leur soumission de fait et involontaire à la volonté de Dieu. Il est donc contradictoire et illégitime d’asservir un musulman, c’est-à-dire de le réduire par force au rang d’instrument, car en tant que musulman il en est déjà un, qui plus est à l’égard de Dieu Lui-même – de sorte qu’en faire un instrument pour soi reviendrait à spolier Dieu. Mais à l’inverse il est légitime et cohérent d’infliger ce sort au non-musulman, car cela revient alors, au contraire, à offrir à Dieu un instrument de plus – non pas immédiatement comme il en va dans le cas de la conversion volontaire, mais médiatement, en tant que le non-musulman asservi devient instrument (involontaire) des instruments (volontaires) de Dieu. Il devient ainsi par force, pour le musulman, ce que l’être non-humain est par nature pour Dieu : un objet auquel s’impose une volonté extérieure. Comme la volonté qui s’impose à lui est elle-même soumise à la volonté de Dieu, il devient indirectement un instrument de la volonté de Dieu – se rapprochant ainsi du statut d’homme véritable, loin de s’en trouver dépouillé. Telle est en effet la conséquence étonnante de cette logique, que la réduction en esclavage, dès lors qu’elle est réservée au non-musulman, peut y être regardée comme une sorte de promotion ontologique ; car sans doute vaut-il mieux être, par rapport à la volonté de Dieu, un instrument involontaire et indirect qu’un obstacle direct et volontaire.
Il faut souligner ici aussi que la réduction en esclavage du non-musulman n’est pas la seule forme que puisse prendre son élévation au rang d’instrument (!). Le statut de dhimmi peut être considéré comme un état de sujétion doux, partiel et provisoire qui tient le milieu entre l’asservissement proprement dit et la liberté. Vaut-il mieux attendre avec « patience » l’extinction ou la conversion du non-musulman, et le laisser ainsi « paisiblement » soit disparaître comme obstacle soit se transformer en instrument volontaire ? Ou bien vaut-il mieux lui procurer la promotion moins parfaite mais plus rapide que constitue l’accès au rang d’instrument involontaire, c’est-à-dire en faire un esclave ? Et dans ce dernier cas, faut-il lui imposer une servitude sévère et définitive, ou clémente et révocable ? Ici encore les réponses relèvent du circonstanciel et de l’arbitraire, car il n’y a à l’égard du non-musulman aucun devoir inconditionnel. C’est précisément en cela que se tient l’essentiel : rien, dans l’islam, ne s’oppose radicalement et par principe à la pratique de l’esclavage (exclusivement envers les non-musulmans) ; cette pratique est fondée en droit, le droit en question étant bien moins, ici encore, celui qui est explicitement promulgué par le discours coranique, que celui qui découle de l’esprit fondamental de la doctrine. Et s’il n’y est pas fait recours, c’est seulement en vertu d’une décision contingente de ne pas appliquer ce droit dans toute sa rigueur : en quoi l’on retrouve la « clémence » comme abstention seulement circonstancielle ou arbitraire de violence – c’est-à-dire, dans ce dernier cas, comme abstention elle-même violente de violence.
Il est clair, en vertu de tout ce qui précède, qu’il en va tout autrement dans le christianisme, l’asservissement d’autrui allant radicalement à l’encontre de la volonté de Dieu, loin d’être l’un des modes possibles de son accomplissement. Plutôt que de répéter sur ce point les raisons déjà exposées, qui tiennent à la nature du Dieu chrétien et de son regard sur l’homme, on se bornera à remarquer que si, dans le passé, le « monde chrétien » a bien pratiqué l’esclavage – et peu importe que ce soit moins longtemps et sur moins de personnes que ne le fit l’islam31–, cette pratique a été condamnée, de manière toujours plus explicite et radicale au fil des siècles, par les autorités religieuses (la Papauté), comme contraire à la doctrine chrétienne32. On chercherait en vain l’équivalent de la part des différentes autorités religieuses islamiques, à l’égard de l’esclavage pratiqué par le monde musulman ; considération historique qui, certes, ne vaut pas preuve, mais prend rang de fait significatif lorsqu’on s’avise à quel point elle est conforme aux implications logiques de la doctrine.
À l’encontre de ce qui est fréquemment affirmé comme une évidence, voire comme un dogme de la doxa contemporaine, nous tenons donc que les violences commises au nom de l’islam ne sont pas, au regard de l’esprit de cette religion, des aberrations qui n’auraient « rien à voir » avec celui-ci ; que leurs motivations ne sont pas à chercher exclusivement en-dehors de la doctrine islamique elle-même ; que cette dernière fait l’objet, de la part des auteurs de ces actes, d’une interprétation particulièrement dure mais néanmoins légitime de son sens profond, et non d’une trahison ; que, sauf à définir la paix comme une domination dans le calme, l’islam n’est pas une « religion de paix », encore moins une « religion d’amour », si l’amour est autre chose que la mansuétude dans l’exercice de la domination – pas davantage que le christianisme, de son côté, n’est une « religion du livre ».
Quant à la possibilité d’une réforme de la religion islamique, qui viserait à épurer celle-ci de toute tendance à la violence, elle peut et doit être regardée comme radicalement problématique. Une réforme, en effet, a pour sens de corriger la manière dont une doctrine ou une institution s’expose ou fonctionne, en vue de la rendre plus adéquate à son esprit ; elle est, par définition et comme son nom l’indique, passage d’une forme à une autre (jugée meilleure) de la même chose. Que si c’est l’esprit même de la chose qui est en cause, il ne peut plus être question de réforme mais d’un changement de nature, autrement dit du passage de cette chose à une autre. Or précisément si, dans l’islam, la violence n’existe pas seulement sous forme de fragments de discours, que l’on pourrait supprimer ou modifier, mais se trouve logée dans l’âme même de sa doctrine, à laquelle on ne saurait toucher sans altérer son essence, alors vouloir extirper de l’islam toute tendance à la violence revient à demander à cette religion de devenir autre chose que ce qu’elle est.
Notes