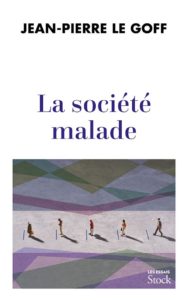Fabrice Ravelle1 réfléchit sur la construction et l’usage du concept de transclasse – « ces personnes qui migrent d’une classe sociale à l’autre dans un mimétisme qui se sent parfois coupable ». Parti d’une expérience personnelle, nourri par la lecture de récits contemporains (Didier Eribon, Edouard Louis, Annie Ernaux), éclairé par des travaux de recherche (Chantal Jaquet, Gérald Bronner, Frédéric Martel), il soulève la question d’une « pensée victimaire », d’une assignation qui, au nom d’une identité contraire à la singularité, récuse le principe d’émancipation.
Les transfuges de classe ou les transclasses sont ces personnes qui migrent d’une classe sociale à l’autre en intégrant ses codes, dans un mimétisme qui se sent parfois coupable. Difficile de préciser l’origine exacte de l’expression : à partir des années 90 « transfuge de classe » est une expression journalistique à la mode, elle semble suivre le concept de « névrose de classe2 » du sociologue Vincent de Gaulejac (1987) dans son approche clinique du sujet. En 2014, la philosophe Chantal Jaquet3 introduit le concept de transclasse, une contraction permettant d’évacuer le mot transfuge tout en introduisant le principe de la non-reproduction sociale.
La littérature du XIXe siècle nous a fourni bon nombre d’archétypes transclasses. Nos héros transclasses s’appellent Julien Sorel (Le Rouge et le noir / Stendhal), Lucien de Rubempré dans la Comédie humaine (Balzac) ou Frédéric Moreau pour l’Éducation sentimentale (Flaubert)… Chantal Jaquet s’appuie en bonne part sur la destinée de Julien Sorel, mais j’ai le sentiment qu’une grande partie des romans du XIXe, en écho au formidable essor de la bourgeoisie, s’articule autour de ce type de personnage. Ce sont ces grandes figures qui, par volonté ou accident, bifurquent vers un monde qui ne leur appartient pas, introduisant un décalage, une étrangeté dans le récit.
Suis-je moi-même transclasse ? Il est certain qu’au regard de ce petit détour d’entre les classes, chacun se découvrira plus ou moins dans cette position inconfortable. Avec son lot de culpabilité, de honte, de trahison (?) ou s’agira-t-il peut-être de venger quelque chose ? Nous y reviendrons.
Autobiographie d’un « déplacé »
D’évidence, les récits transclasses sont autobiographiques. Aussi, je vais me plier à ce rituel, brièvement.
Mes parents, employés de restauration, serveuse et chef de cuisine ont connu la précarité des petits boulots. La faillite de leur premier petit restaurant de campagne à la fin des années 60 entraînera les dettes puis les saisons et les emplois pour se refaire, je m’en souviens bien. Plus tard, au milieu des années 80, à mon adolescence ils trouveront leur place en ouvrant un restaurant avec un certain succès. Nous avons vécu en HLM, notamment dans la zup de Montbéliard, puis dans un pavillon Phénix, gage d’accession à la propriété de la petite classe moyenne. Ma scolarité s’arrête à Bac+2. Une passion très jeune pour la musique et l’expression artistique mais un apprentissage très tardif et peu académique. Je dois mon parcours artistique à une soif de connaissance compulsive qui m’a fait fréquenter très assidûment les bibliothèques municipales pour tout dévorer. Je pense avoir vu tous les spectacles de la maison de la culture de Montbéliard pendant plusieurs années, grâce aux places gratuites qu’une amie de lycée nous fournissait. Disons, un parcours en bonne part autodidacte, sérieusement nourri tout de même des enseignements de l’école publique, bibliothèques, musée municipaux, centre d’art MJC et de cours de musique. Puis un certain culot de se prétendre artiste à 18 ans m’a fait frapper à la porte de toutes les salles de concert et festivals, une bonne occasion pour moi de fuir la province pour Paris.
Après des rencontres décisives, un travail de fond, laborieux, 35 ans de carrière et quelque cinquante albums de musique réalisés, je pense avoir trouvé ma place de compositeur et directeur musical auprès de grands artistes. Et pourtant, toujours ce sentiment de ne pas être tout à fait à ma place, le syndrome de l’imposteur, parfois, comme si j’avais volé ma place. À l’évidence, je n’étais pas prédisposé à ce genre de trajectoire.
Être déplacé : C’est le terme que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron4 emploient lorsqu’ils recueillent les sentiments des étudiants en 1964 dans Les Héritiers. Certains se trouvent à leur place, disons les enfants de la bourgeoisie. Les autres, très minoritaires en 64, fils et filles de paysans ou d’ouvriers, se sentent « déplacés ». Le vocabulaire est saisissant. Le principe pointé par Bourdieu est maintenant un classique : les enfants de la classe bourgeoise héritent de tous les codes. Nul besoin de fréquenter le ciné-club, d’emprunter les disques de jazz, de découvrir les symphonies ou les concertos… les classiques sont intégrés, presque innés. Ainsi pour les héritiers, la culture peut s’aborder de façon dilettante (c’est le terme consacré). Un dilettantisme comme mode de vie, sans effort apparent, tout est « naturel » puisque hérité. Pour l’étudiant « déplacé », par-contre, le monde de la culture, le monde intellectuel demande un apprentissage quotidien, laborieux. Une mise à niveau, rien ne va de soi.
J’ai souvent été confronté à ce dilettantisme de bon teint. Connaître les codes suppose une légèreté dans les relations, on se reconnaît, on se rassure. Nombre de fois j’ai trop laissé transparaître mon enthousiasme pour un projet ou pour un poste. Cela m’aura valu méfiance et suspicion. Comment ? Il aurait besoin de ce travail pour vivre ? Presque indécent ! Cette mécanique des héritiers est particulièrement à l’œuvre dans le milieu du cinéma et dans une certaine mesure dans la production musicale.
Dolorisme
Je pense avoir découvert la question des transfuges de classe avec l’ouvrage de Didier Eribon5, Retour à Reims il y a une bonne dizaine d’années, le livre date de 2009. Cet essai, pour moi, c’est d’abord une révélation qui laissera place plus tard à un désamour. Il faut reconnaître que ce traité de sociologie a quelque chose de particulièrement émouvant par sa manière d’autobiographie : bien installé dans sa situation, l’auteur se rend aux obsèques de son père dans sa région natale – occasion d’une introspection sur sa bifurcation. Lui, l’enfant d’ouvrier deviendra l’intellectuel « homosexuel de gauche » en vogue des années 80. Je n’ai pas le même parcours mais quelque chose résonne en moi dans son récit. Je comprends dans son texte que son homosexualité aura agi comme une transgression de classe. « Je me suis décrit » dit-il « comme un miraculé ; il se pourrait bien qu’en ce qui me concerne, le ressort de ce ‘’ miracle‘’ soit l’homosexualité » (Chantal Jaquet fait aussi référence à cet extrait dans Les Transclasses). L’homosexualité comme transgression sociale, j’en ai connu quelques traces à la fin des années 80, avec le grand brassage d’une communauté (Eribon décrit les lieux de drague ainsi). Faits, réels ou fantasmés, je pense moi aussi avoir découvert un autre monde, en fuyant la province, en côtoyant des personnes d’une autre classe (dirais-je dominante ?). Un monde que je ne m’imaginais même pas.
Il est question de place, il est question de classe. Il sera question de Marx. J’aurai cependant du mal à me glisser intégralement dans la mécanique de Marx, tant je trouve que la « lutte des classes » peine à analyser notre société. Et puis on trouvera toujours plus dominant ou plus dominé. Même le prolétariat a son sous prolétariat, le Lumpenprolétariat6. Une classe de mendiants, de voleurs et de petits métiers, une classe que même les prolétaires se doivent de déconsidérer par peur de contamination sociale. Le Lumpen (le prolétaire en haillons) transgresse, se retourne et se vend au plus offrant. C’est le scandale antirévolutionnaire par excellence. Voyons la description du parti du 10 décembre par Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte7 : « des forçats sortis du bagne, des filous, des souteneurs » […] mais aussi « des chiffonniers, des rémouleurs, des rétameurs, des mendiants » encore : « bref, toute cette masse confuse, décomposée, flottante, que les Français appellent la ‘’ bohème ‘’. » Marx dans le texte ! L’épouvantail, si je puis dire, est large lorsqu’il s’agit de déconsidérer une classe par rapport à une autre, on est loin de la rédemption d’un Jean Valjean. Point de salut, en haillons pour la vie. « Pour la vie » c’est une question clé, la question d’un déterminisme social.
Le sociologue Gérald Bronner dans Les Origines8 (lui aussi authentique transclasse), regroupe bon nombre de récits contemporains dans un même cœur narratif : le dolorisme. Didier Eribon, Annie Ernaux, Edouard Louis ont à cœur de renforcer le caractère inéluctable et définitif d’assignation sociale. Portant en eux la souffrance de la classe qu’ils ont quittée. Leur « transclassisme » se mue en souffrance christique, gage de salut de l’ensemble des classes laborieuses. Quel besoin a-t-on de porter sa douleur en bandoulière lorsqu’on devient par la force des choses le symbole d’une certaine réussite sociale ?
En quoi consiste cette réussite ? La reconnaissance de ses pairs, la maîtrise de codes, d’un langage, les honneurs, l’enrichissement aussi. D’aucuns résumeront cela à l’embourgeoisement. Le mot sonne comme embonpoint, avec la réussite vient la mauvaise graisse. De là à penser que le dolorisme agirait comme un talisman contre l’accusation d’embourgeoisement…Devenu grand intellectuel, traduit dans toutes les langues, riche et célèbre oui ! Mais le transclasse portera à jamais toute la douleur de sa classe !
Pensée victimaire et assignation
Dans son expression « j’écrirai pour venger ma race9 » Annie Ernaux pousse le principe d’assignation de classe au-delà de toutes limites (extrait de son discours au prix Nobel). Même si « Je vengerai ma race » est issu de ses carnets écrits à l’âge de 22 ans, une telle démesure est difficilement compréhensible, sauf à penser qu’il lui fallait prouver fidélité à sa classe/race dans une alternative : vengeance ou trahison. « Lever le front pour laver l’affront » comme le résume à ce sujet Chantal Jaquet. Toujours est-il que le fait d’assimiler la classe à la race est glaçant dans une provocation ultime. Il entérine le principe de déterminisme. À nouveau, point de salut.
Néanmoins, les récits d’Annie Ernaux sont d’ordinaire tout à fait mesurés dans un travail de description d’une grande sobriété. Pour mémoire, le récit transclasse par excellence d’Annie Ernaux s’intitule judicieusement la place10 – ou comment résumer en un mot toute la complexité du phénomène. Je trouve ce minimalisme particulièrement saisissant. La place, c’est bien le mot de Bourdieu. La Place est le portrait de son père, ouvrier puis patron d’un café-épicerie de quartier, on y comprend l’attachement puis l’éloignement de l’auteur jusqu’à la honte de son propre milieu – La Honte, autre récit transclasse de Annie Ernaux.
Autre auteur, autre récit : que penser alors d’une famille décrite comme un sous-quart monde dans un délire d’exagération d’un Édouard Louis au comble de l’auto-fiction ? Pour cet auteur, le trait est systématiquement forcé, que ce soient les détails sur son père buvant le sang frais d’un porc égorgé dans En finir avec Eddy Bellegueule11 ou le déroulé d’un supposé viol relaté par la sœur du narrateur avec force tics de langage pour faire plus peuple dans Histoire de la violence12. La caricature n’est jamais loin. À se demander si forcer le trait ne devient pas un système en soi, une sorte de justification de ses origines modestes dans un monde intellectuel et bourgeois que l’on peine à assumer publiquement. Caricaturales aussi les prises de positions de plus en plus provocatrices du trio Eribon, Louis et Lagasnerie, comme s’il leur fallait depuis quelques années prouver le caractère authentique de leur engagement dans une sociologie postmarxiste.
Gérald Bronner explique malicieusement que la tendance est aux origines modestes pour l’intellectuel de 2020, si bien que si nécessaire on fera remonter son pedigree de modestie à deux ou trois générations. Si par malchance, vous avez été élevé dans une certaine aisance, faites remonter vos véritables origines au grand père ouvrier ou à vos arrière-grands-parents paysans, on en tirera grand bénéfice.
L’artiste transclasse aurait la bourgeoisie honteuse. Oubli volontaire : sans bourgeoisie, pas d’artiste, pas de galeries, pas de concert, pas de cabaret. Quelles traces la littérature et la musique françaises auraient-elles laissées dans nos esprits sans les grandes salonnières du tournant du siècle ? Qui a fait le succès des ballets Russes, des Picasso d’hier et d’aujourd’hui ? Le légendaire mauvais goût petit-bourgeois aura même fait le miel des grands créateurs, de Brecht à Warhol en passant par Otto Dix…Brecht qui avec Kurt Weill aura si magnifiquement mis en scène notre fameux Lumpenprolétariat… Aujourd’hui L’Opéra de quatre sous ou Mahagonny13 se jouent dans nos très bourgeois opéras.
L’écrivain et sociologue Frédéric Martel, transclasse aussi, s’était reconnu tout comme moi dans le Retour à Reims de Didier Eribon. Seulement, dans son recueil sur la culture gay Fiertés et préjugés14 il pointe lui aussi la pensée victimaire entretenue par Didier Eribon et ses comparses. Ce dolorisme finit par désactiver le contenu même de cet ouvrage au fil du temps. À noter que Didier Eribon, dans l’épilogue de Retour à Reims ébauche la visée intersectionnelle de son combat au-delà du marxisme : « […] la disparition du marxisme, ou du moins son effacement du discours hégémonique à gauche, aura été la condition nécessaire pour qu’il devienne possible de penser politiquement les mécanismes de l’assujettissement sexuel, racial etc. » 15. D’ailleurs, Eribon, dans ce même épilogue, reprend à son compte le « je vengerai ma race » exhumé des carnets d’Annie Ernaux. Petit à petit, Retour à Reims se transforme en manifeste militant où le transclasse, quels que soient sa vie, ses choix, restera à jamais lié aux instincts (habitus ?) de sa classe d’origine, ainsi, forcément soumis à la classe dominante, quoi qu’il advienne. C’est d’ailleurs le thème récurrent des auto-fictions d’ Édouard Louis. Il est certes compréhensible que le transclasse puisse servir d’alibi à une classe dominante à la recherche du contre-exemple miraculeux permettant d’attester le bon fonctionnement de notre méritocratie. Mais « Venger sa race » ou trahir sa classe : nous voilà plongés une fois de plus dans cette alternative, que je refuse. Je la trouve totalement déprimante, aliénante et insultante. Une manière de dissoudre l’individu résumé à une classe sociale. En toute indifférenciation, sans espoir d’émancipation. C’est donc cela une assignation.
Dans son analyse, Chantal Jaquet propose en quelque sorte un remède à ce principe d’assignation en se penchant sur l’individu16 et l’idée de passage, de passager, de « passe-classe ». « Lorsque la lutte pour la reconnaissance échoue, cette identité apposée à l’individu apparaît comme la forme suprême de l’aliénation puisqu’il est à jamais enserré dans des caractéristiques immuables, son sexe, sa race, son statut social. » À l’identité, elle oppose le principe de complexion de l’individu (en référence à Spinoza) et nous incite à prendre en considération « les différences fines, la particularité des êtres… ». À mon sens, un remède à l’intersectionnalité et à l’obsession de l’identité en vogue de nos jours.
Pourtant, la toute dernière phrase de « transclasses » de Chantal Jaquet me laisse perplexe :
« Bien qu’il puisse incarner une figure d’émancipation par rapport à une condition stigmatisée, le transclasse n’est pas l’avenir de la femme, de l’homosexuel(le) ou du Noir ; il n’est pas davantage l’avenir de l’homme car l’objectif n’est pas de passer solitairement les barrières de classe, mais de les abolir pour tous. »
Pourquoi élaborer sur 230 pages un concept subtil aux vertus émancipatrices, pour finalement, s’assujettir dans un schéma rebattu qui ressemble sérieusement à l’abolition des classes ? Que signifie au juste cette candeur soudaine après avoir soutenu le caractère autonome et mouvant des transclasses ? S’attacher à la toute dernière minute à l’avènement d’une société sans classe comme idéal, m’interroge. À cet élan révolutionnaire, je préfère m’en tenir à d’autres considérations : pouvons-nous reproduire ce petit miracle social dans nos nouvelles rencontres professionnelles ou autres ? Même s’il y a malgré tout un entre-soi dans nos relations, faut-il s’acharner à voir dans les ‘places’ que nous y occupons l’effet exclusif d’un déterminisme social au point d’en exclure toute liberté, toute circulation ?
Notes
1 – Compositeur et producteur de musique.
2 – Vincent de Gaulejac, La Névrose de classe, Paris, Payot, 2016 (1987).
3 – Chantal Jaquet, Les Transclasses ou la non-reproduction, Paris, PUF., 2014.
4 – Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers Les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1966.
5 – Didier Eribon, Retour à Reims, Paris, Champs Flammarion, 2018 (2009).
6 – Voir Jean-Claude Bourdin « Marx et le Lumpenprolétariat » dans Actuel Marx, N° 54, Paris, PUF, 2013, p. 39-55.
7 – Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Chapitre V.
8 – Gérald Bronner – Les Origines, pourquoi devient-on qui l’on est ?, Paris, Champs Autrement, 2025 (2023).
9 – Discours à l’académie suédoise de Annie Ernaux, dans Le Monde 7 décembre 2022. https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/07/annie-ernaux-j-ecrirai-pour-venger-ma-race-le-discours-dela-prix-nobel-de-litterature_6153401_3232.html
10 – Annie Ernaux, La Place, Paris, Folio, 2021 (1983).
11 – Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Paris, Points, 2015 (2014).
12 – Edouard Louis, Histoire de la violence, Paris, Seuil, 2016.
13 – Opéra de quat’sous, Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (B. Brecht / K. Weill).
14 – Frédéric Martel, Fierté et préjugés, la révolution gay, Paris, Bouquins, 2022. « La pensée victimaire: Edouard Louis, Didier Eribon et Geoffroy de Lagasnerie » texte en libre accès https://fredericmartel.com/la-pensee-victimaire-edouard-louis-didier-eribon-et-geoffroy-de-lagasnerie/
15 – Retour à Reims, p. 244.
16 – Chantal Jaquet : voir notions d’ingenium et de complexion en référence à Spinoza et Pascal.