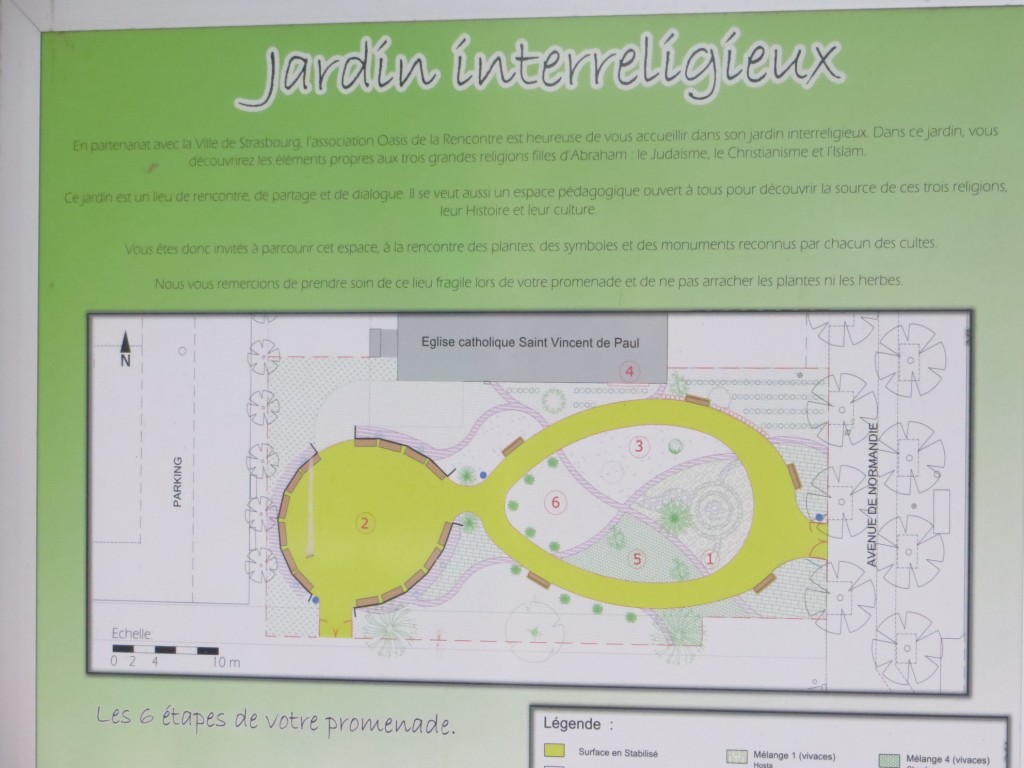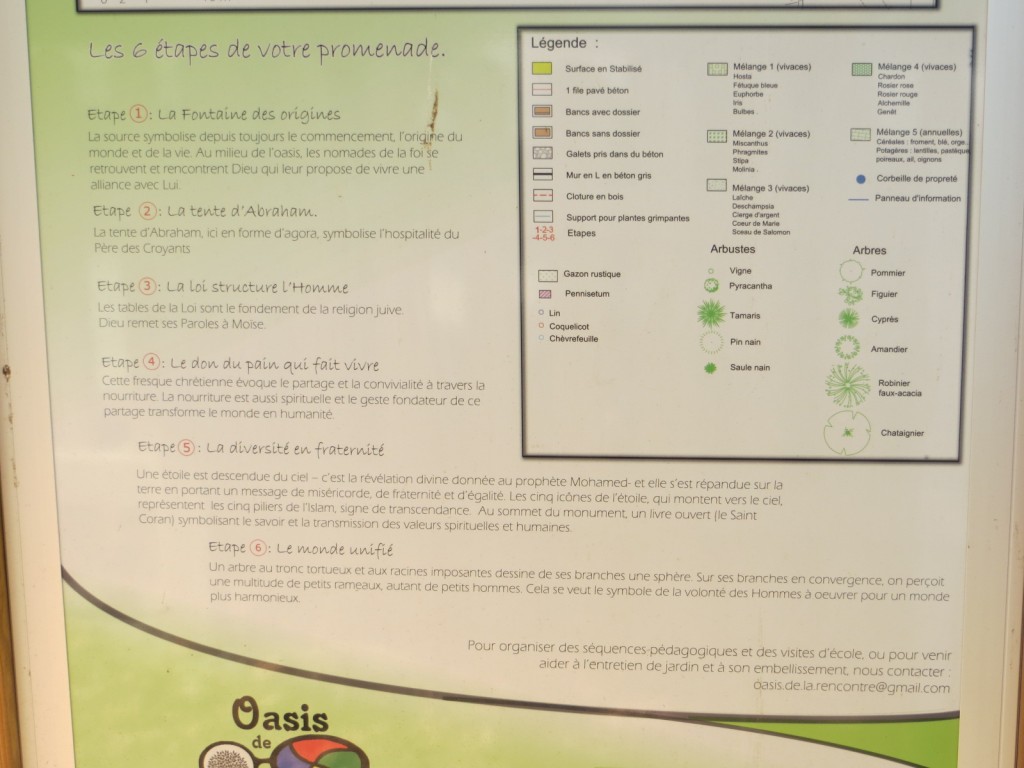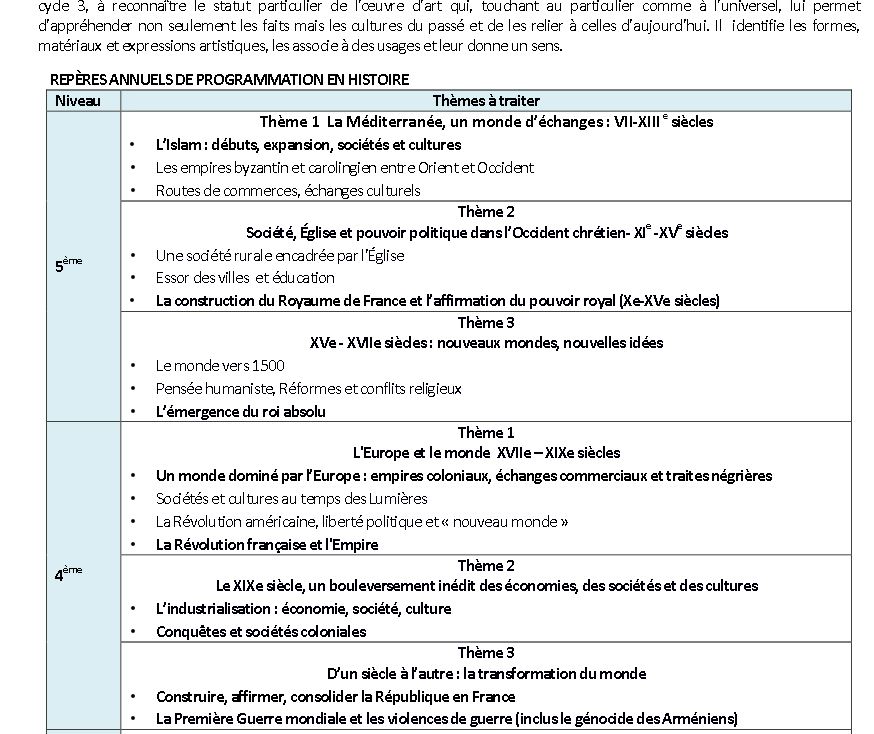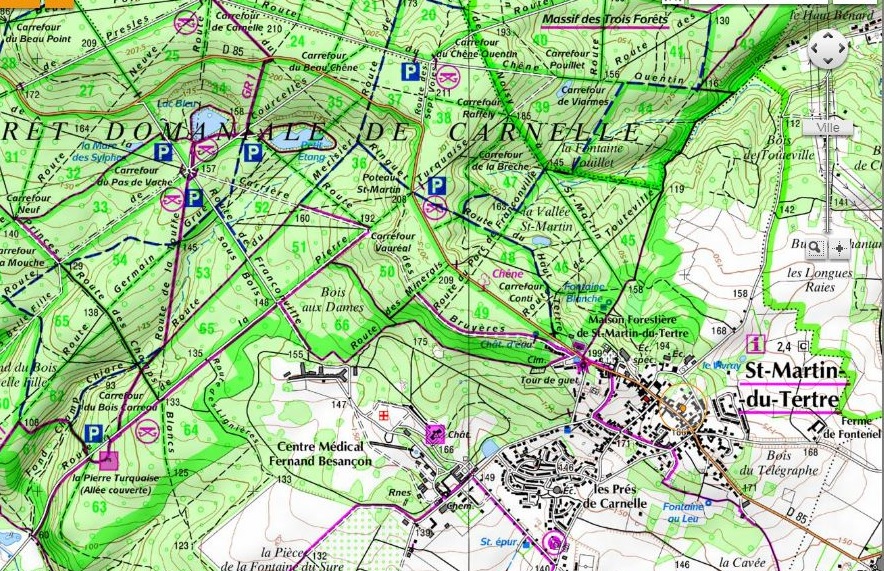La finalité de l’école est l’instruction : tel est le point de départ de l’auteur. Que se produit-il quand cette finalité cesse d’être le principe de l’école ? Quelles conséquences nécessaires résultent du seul fait que cette finalité se trouve subordonnée à d’autres ? L’examen de ces questions permet de voir ce qu’est l’école, c’est-à-dire ce qu’elle a toujours été là où il y a des maîtres ou des professeurs ayant la volonté d’instruire. Et pourtant, elle l’a rarement été – il n’y a qu’à lire par exemple Vallès ou Rabelais, ou, plus proches de nous, Alain et Bachelard – parce que, depuis fort longtemps, on renvoie l’école à son extérieur : on la met hors d’elle.
Ce texte a été mis en ligne sur l’ancien Mezetulle en juin 2013.
Jean-Michel Muglioni tient à remercier Frédéric Dupin
qui lui a permis par ses remarques d’enrichir son propos.
La finalité de l’école est l’instruction : tel est mon point de départ. Je vais montrer ce qui arrive inévitablement quand cette finalité cesse d’être le principe de l’école : quelles conséquences nécessaires résultent du seul fait que cette finalité se trouve subordonnée à d’autres ? Et peut-être verrons-nous du même coup ce qu’est l’école, c’est-à-dire ce qu’elle a toujours été là où il y a des maîtres ou des professeurs ayant la volonté d’instruire. Pour savoir qu’elle l’a rarement été, il n’y a qu’à lire par exemple Vallès ou Rabelais, ou, plus proches de nous, Alain et Bachelard.
1 – La pédagogie fondée sur le savoir
Dans une école visant sa fin propre qui est d’instruire, l’enseignement est fondé sur le savoir. Il n’y a de savoir que par le rapport du contenu du savoir à l’esprit, et par conséquent le rapport du contenu du savoir à l’esprit de l’élève est le même que le rapport du contenu du savoir à l’esprit du maître : un enfant qui comprend une vérité d’arithmétique élémentaire, comme 2+2 font 4, est, en tant qu’il la comprend, l’égal du maître. Ainsi, en français apprendre se dit aussi bien de celui qui s’instruit, l’élève, que de celui qui l’instruit, le maître. La relation du maître à l’élève, quand elle a pour principe le savoir, n’est donc pas une relation de pouvoir. Cette affirmation est fondée sur l’idée qu’il y a une intelligibilité du savoir, un intérêt du savoir pour lui-même ; un intérêt qui tient à sa nature de savoir et à l’affinité essentielle de l’esprit et du savoir. Il en résulte que le rapport de l’esprit au contenu du savoir détermine la manière d’exposer le savoir de telle façon qu’il puisse être compris par celui qui le découvre ; dans une véritable école, le maître est pédagogue parce qu’il maîtrise son savoir, parce qu’il sait vraiment ce qu’il enseigne, même si sa science est limitée. Une telle idée de l’enseignement repose sur une foi en l’homme, en la capacité de l’homme en tant qu’homme à comprendre, pourvu qu’on le mette en face de la vérité. Ce qui vaut pour les vérités mathématiques vaut aussi pour la beauté d’un poème.
2 – Le pédagogisme : dérive toujours possible de l’enseignement
Je ne supposerai pas maintenant une pédagogie délibérément oublieuse du savoir, mais une école où l’intérêt intrinsèque du savoir est subordonné à la relation d’un homme avec un autre ou avec une classe : alors l’enseignement est fondé sur des éléments étrangers au contenu enseigné, essentiellement sur des considérations psychologiques et sociologiques. Voyons quelles conséquences en résultent, qui découlent de la nature des choses et non de la bonne ou de la mauvaise volonté des hommes.
Le métier de professeur a sa rhétorique. Un bon professeur sait tirer parti de l’art d’agréer – ne serait-ce qu’en faisant quelques astuces : Alain lui-même écrit qu’il ne reculait pas devant les blagues douteuses. Mais on doit se garder de tomber dans la démagogie : il faut subordonner la rhétorique aux normes qui font du savoir un savoir. User de ruses pédagogiques ou rhétoriques est dangereux : on croit devoir faire régner la terreur pour asseoir son autorité ou pire, parce que plus insidieux, on joue au séducteur au lieu d’instruire. Il est difficile de garder devant un auditoire, même de qualité, assez de sang-froid pour ne pas se transformer en orateur politique. Ou en animateur. Alors la pédagogie devient une sorte d’art de la séduction, une rhétorique au sens le plus péjoratif du terme, la rhétorique des passions : il faut plaire aux élèves, il faut jouer sur ce qu’on appelle leurs motivations pour capter leur attention. Lorsque cette pédagogie (celle-ci et non toute pédagogie) est érigée en principe, même avec les meilleures intentions du monde, je veux dire sans volonté démagogique de domination, on a le pédagogisme. J’ai eu moi-même des professeurs il y a plus de cinquante ans victimes de cette dérive. Subordonner et même réduire l’enseignement à la relation du maître et de l’élève, en oublier le contenu du savoir, c’est une dérive toujours possible de l’enseignement. Et depuis toujours !
Si je pouvais opposer plus longuement l’instruction proprement dite et le pédagogisme ainsi défini, je reprendrais la critique platonicienne de la sophistique – de la grande sophistique antique, car c’est une grande chose. Mais il faut choisir. Choisir entre le savoir et le pouvoir, entre le jugement et la violence. Car la séduction ici est violence.
Pédagogie et communication
Qu’on fonde comme aujourd’hui cette dérive sur ce qu’on appelle les sciences de l’éducation ne change rien à sa nature. Ce que j’appelle le pédagogisme n’est pas la pédagogie entendue comme prise en compte de son auditoire par celui qui sait, mais la subordination du contenu du savoir et de ses méthodes à l’auditoire, ou plutôt à l’idée qu’on s’en fait. La démarche intellectuelle constitutive du savoir passe au second plan. De là l’existence de spécialistes de la pédagogie qui ne sont pas mathématiciens ou historiens, etc., et qui prétendent pouvoir dire comment enseigner les mathématiques ou l’histoire. Ils sont à l’enseignement ce que les communicants sont à la politique. L’idéologie de la communication est un des plus grands maux. Certes, la vraie communication est une belle chose et n’a rien de commun avec la propagande, la publicité, et toutes les formes de rhétorique de la séduction, mais elle suppose qu’on ait quelque chose à communiquer : par exemple dans une communication scientifique, ce n’est pas la manière qui compte mais le contenu. Or il arrive qu’on dise d’un gouvernement que sa communication est mauvaise ou qu’il manque de pédagogie, assimilation qui montre clairement ce qu’on entend aujourd’hui par pédagogie. C’est admettre que sa politique est bonne, mais que le peuple est incapable de la comprendre et qu’il a besoin qu’on le flatte pour la lui faire admettre. Je soutiens que le pédagogisme et la démagogie sont rigoureusement de même nature. D’où inévitablement une école où l’on ne va pas pour comprendre. Et comme je l’ai dit, je ne suppose pas des pédagogues mal intentionnés : il suffit que l’instruction passe au second plan pour que la relation du maître à l’élève, n’étant plus médiatisée par le savoir, ne soit plus qu’un rapport de force.
3 – L’obsession de la « motivation » – le respect, seule pédagogie
Cette inversion des priorités entraîne la subordination du contenu de l’enseignement à la motivation des élèves. On s’étonne en effet que l’intérêt des élèves ne se porte pas spontanément vers ce qu’on doit leur apprendre, comme s’ils pouvaient avoir un intérêt pour un savoir qu’ils n’ont pas encore appris ! Celui qui n’a encore pas compris une démonstration ne peut pas s’y intéresser, quand même on chercherait à le motiver par ailleurs. Il faut avoir commencé à comprendre pour commencer à s’intéresser. Le mal inhérent à l’enseignement n’est pas qu’on manque de pédagogie au sens du pédagogisme, mais qu’on oublie que les élèves ne savent pas ce qu’on va leur apprendre. Celui qui sait et pour qui le contenu de son savoir est devenu familier doit donc faire l’effort de penser que rien de ce qui va de soi pour lui ne va de soi pour l’ignorant, y compris son amour de la poésie s’il fait lire un poème. C’est dire qu’une fois devenu savant, il ne peut enseigner que s’il n’a aucun mépris pour celui qui d’abord ne voit pas ce qui est évident (mépris particulièrement fort chez les mathématiciens, parce qu’en effet ils n’ont jamais affaire qu’à de l’évident). Ainsi la vraie pédagogie, celle qui est fondée sur le dessein d’instruire, consiste dans le respect de l’homme en l’ignorant qu’on veut aider à s’élever, comme le dit le mot d’élève. Il faut le même respect pour admettre qu’un poème qu’on admire ne touche pas à première lecture des enfants ou des adolescents qui ne sont pas « tombés » dans une bibliothèque quand ils étaient petits. La pédagogie n’est pas une affaire de psychologie ou de sociologie ; elle ne relève pas d’une science ; elle est la morale de l’enseignement, l’éthique ou la déontologie du professeur : ne pas s’en prendre à celui qui ne sait pas encore ou qui va moins vite que les autres – ou plus vite. La relation du maître à l’élève est une relation humaine au sens le plus fort du terme, c’est-à-dire entre deux esprits. Je m’oppose au pédagogisme pour sauver la pédagogie qu’il rend prisonnière du jeu des passions : je veux la sauver d’une psychologisation qui transforme le savoir en moyen « d’interagir », comme on dit, c’est-à-dire en pouvoir.
Pédagogisme et mépris
Partout et toujours précepteurs et professeurs ont fait jouer les motivations que sont récompenses et punitions, honneur et honte ; ou par exemple on vante l’utilité des mathématiques pour la vie professionnelle, etc. Mais tous les mobiles qui peuvent « motiver », qui peuvent inciter à apprendre en dehors du dessein d’apprendre lui-même, même utilisés à bon escient, ne sont que des auxiliaires. Ils sont sans doute inévitables, mais s’ils envahissent l’école, comme cela a souvent été le cas au cours de l’histoire, ils rendent impossible toute véritable instruction. On sait qu’il y a une manière de jouer sur la honte qui est dégradante. Mais c’est aussi mépriser ses élèves que croire qu’ils sont incapables d’apprendre sans le sucre ou la carotte des motivations qui sont les leurs avant qu’ils aient appris. Et c’est à coup sûr attirer leur mépris.
« Motivation » et aberration des programmes
Voici un autre exemple de conséquence du primat de la motivation sur l’intérêt qu’il y a à apprendre pour apprendre, priorité qui fait prévaloir en chacun, maître et élève, des considérations psychologiques et sociales sur le contenu du savoir, au détriment de la discipline intellectuelle. En physique, je ne sais pas si c’est encore le cas, il y a une trentaine d’années, il fallait parler des avions et des fusées supposés intéresser les élèves. Le programme mettait avions et fusées dans la même catégorie, ce qui physiquement est absurde, car les fusées ne volent pas : il y a là deux principes de fonctionnement totalement opposés ! Que dans les deux cas il y ait un moteur et que les machines aillent vers le haut n’y change rien. Cet exemple montre que le souci de la motivation peut amener à dénaturer le contenu scientifique d’un enseignement. Et en fin de compte, oublier ainsi le principal, l’intelligibilité, la démarche intellectuelle, c’est à coup sûr subordonner les programmes aux intérêts du marché ou du prince, aux vœux des parents qui veulent seulement que leurs enfants fassent carrière dans la société. Kant note que la société et les parents ne veulent pas élever les hommes au-dessus de ce qu’ils sont.
4 – Le multicolore de l’interdisciplinarité et de la « recherche ». Discipline ou ordre des raisons
Autre conséquence nécessaire de l’inversion des priorités : la disparition des disciplines au profit de ce qu’on appelle l’interdisciplinarité. Une fois le contenu et donc les démarches dont il est inséparable passés au second plan, on oublie que les rigueurs d’une discipline sont ce qui la rend intelligible, j’oserais dire « apprenable » – ce qui se disait en grec mathématique. Le terme de discipline lui-même vient de disco qui veut dire apprendre : c’est le même mot qu’on retrouve dans disciple. Il désigne aussi l’ordre – la discipline militaire. Cela ne fait pas du savoir une affaire policière, comme un certain gauchisme l’a soutenu, et ce préjugé gauchiste n’a pas disparu. C’est le point le plus mal compris en effet par mes lecteurs sur Mezetulle, comme l’a montré leur correspondance. Il y a un sens de l’ordre, le vrai, qui n’est ni policier, ni militaire : ce que Descartes appelait l’ordre des raisons ou la méthode. Car penser n’est pas sauter d’une opinion à l’autre au gré des circonstances et des passions. Descartes allait jusqu’à dire qu’il vaut mieux ignorer une vérité que la trouver par hasard, c’est-à-dire sans comprendre ce qui permet de la tenir pour vraie. Vouloir suivre les motivations diverses qui agitent les élèves, c’est renoncer à instruire.
Une façon absurde de mimer la recherche
Je suis parti de l’idée qu’il y a une intelligibilité du savoir qui le rend accessible à tout esprit, d’où j’ai conclu que subordonner l’enseignement à des impératifs d’un autre ordre le dénature inévitablement. Voici un autre exemple qui n’a en apparence rien à voir avec les précédents. Des chercheurs de haut vol, véritables savants, se sont émus – à juste titre – de l’ignorance de nos enfants au sortir de l’école et de ce que trop peu d’entre eux se dirigent vers les carrières scientifiques. Pour y remédier ils ont voulu qu’on initie les élèves très tôt à la recherche. C’est une nouvelle façon de renverser l’ordre et de mettre la charrue avant les bœufs. Je n’ai jamais oublié ce que Ferdinand Alquié, grand spécialiste de Descartes et de la philosophie moderne, et aussi grand professeur, a dit aux étudiants de son séminaire, à la Sorbonne en 1968-1969, lorsque le terme de recherche a été introduit dans le libellé du diplôme qu’on appelle aujourd’hui master : il y a, nous dit-il, des choses qui ont déjà été trouvées, et qu’il est inutile de chercher. Et comme il faisait toujours de la provocation, c’était son côté pédagogue, il a ajouté, avec un accent de Montpellier qu’il cultivait : par exemple, que Descartes est né en 1596 à la Haye en Touraine, cela a déjà été trouvé, ce n’est pas la peine de le chercher. Alquié devinait ainsi ce qui allait se passer dans les écoles : j’ai vu des enfants chercher tout seuls des dates qu’il aurait suffi de leur donner, comme si cela avait un rapport avec le travail de recherche d’un historien ! On demande aux élèves de chercher sur internet ou dans des encyclopédies des choses de ce genre, au lieu de leur donner à apprendre tout simplement. Lorsqu’il s’agit de sciences expérimentales, singer la recherche est encore plus absurde, puisqu’une expérience n’a rien de scientifique si elle est coupée des principes théoriques de la science dans laquelle elle s’inscrit. Faire mimer la recherche scientifique à des élèves qui n’ont encore acquis aucune base et en particulier aucune base mathématique suffisante, c’est se moquer. Ce que d’excellents chercheurs ne voient pas, parce qu’ils possèdent ces bases théoriques sans se souvenir qu’il leur a fallu les acquérir : ils ont oublié qu’il faut s’instruire avant de se lancer dans la recherche, ils n’ont pas vu que si les carrières scientifiques n’attirent pas assez, c’est qu’il n’y a plus de véritable instruction dans les écoles. Au lieu d’y développer l’esprit critique et scientifique, on développe une curiosité irrationnelle qui fait de chacun une sorte de touche-à-tout, amateur éclairé seulement en apparence, qui confond information et savoir. Il n’y a plus alors de différence entre une classe et un salon où l’on cause, mal ancien dénoncé par Gaston Bachelard : ainsi les travaux pratiques de chimie sont souvent moins l’occasion de s’instruire et de comprendre que de jouer à produire des transformations miraculeuses, où comptent surtout le bruit et la couleur. Au bout de quelques années d’études dites scientifiques on ne sait donc pas distinguer science et opinion, comme le philodoxe que Platon décrit au livre V de sa République.
Ainsi s’allient le pédagogisme et la volonté sincère d’initier aux sciences, l’oubli du savoir et de ses méthodes d’un côté, et la volonté de préparer à la recherche scientifique de l’autre. D’où l’un des paradoxes de notre école : d’un côté on renonce à la rigueur, de l’autre on a une ambition démesurée et toute discipline intellectuelle est bannie.
Spécialisation dispersive
Le progrès même des sciences a fait oublier l’idée d’instruction, ce qui explique aussi l’illusion des chercheurs dont je viens de parler. La recherche en effet est de plus en plus spécialisée. La connaissance scientifique a éclaté en une multitude de savoirs. Fonder une école sur cette dispersion interdit tout cursus réellement cohérent et progressif, c’est-à-dire l’instruction élémentaire, ce qui touche aussi bien les disciplines dites littéraires qui ne veulent pas être en reste. Le mal de l’école tient essentiellement à ce qu’on y a oublié qu’instruire, c’est suivre un certain ordre, celui qui commence par le b a ba : l’instruction est élémentaire ou n’est rien, aussi loin qu’elle puisse aller.
Sans discipline intellectuelle, pas de discipline tout court
S’instruire requiert qu’on suive un ordre qui va du plus simple au plus complexe et qu’on ne marche pas à l’aventure, au gré de sa fantaisie, bref qu’on apprenne ce qu’on apprend parce qu’on le comprend, ce qui suppose donc discipline et travail. Quand, avec l’idée même d’instruction, cette discipline de l’esprit est oubliée, la discipline la plus ordinaire disparaît. Conséquence inévitable, au point, je l’ai dit, que personne ne comprend plus le terme de discipline, l’idée d’une discipline qui force à être attentif, d’une discipline de travail. Que dirait-on aujourd’hui d’un professeur qui se plaindrait qu’on ne peut passer dans un couloir parce que les élèves le bouchent dans le plus grand désordre, désordre sympathique au demeurant, et j’ai dû moi-même m’imposer dans un lycée en marchant sur des corps étendus : ils se sont levés la fois suivante avant mon passage. Je raconte cette histoire parce qu’il y a prescription : aujourd’hui je serais sans doute traîné devant les tribunaux. Par ce plat apologue, je veux simplement faire comprendre ceci, que je ne développerai pas : la violence dite scolaire vient de ce qu’on a renoncé à l’idée même d’instruction : pourquoi ? Parce que par là même on a renoncé à la discipline, si bien que l’école n’est pas à l’abri de la violence sociale – laquelle n’est pas nouvelle. Autre façon de formuler cette conséquence nécessaire de la mise au second plan, de l’instruction : l’ouverture de l’école sur la vie, qui signifie qu’on renonce à l’ordre et à la méthode, à la rigueur intellectuelle. Rien en effet n’est plus confus que la vie dans cela même qu’elle a de plus plaisant.
5 – La fin du travail
Avec la discipline intellectuelle, la nécessité de travailler a disparu, la nécessité de vaincre sa paresse naturelle et de ne pas s’écouter. Le mal de l’école qui dérive inévitablement de la mise au second plan de l’instruction est qu’on n’y travaille plus. Voici des exemples.
Travail à la maison
D’abord un serpent de mer : l’interdiction dans le primaire de donner ce qu’on appelle des « devoirs à la maison ». Qu’il faille les limiter parce que la plus grande part du travail doit être faite à l’école, et que les jeunes enfants ne doivent pas être harcelés jour et nuit par un travail scolaire, je n’en doute pas. Mais on refuse de donner le moindre exercice à faire chez soi pour ne pas favoriser ceux des élèves que leurs parents peuvent aider. Conséquence : leurs parents ou telle ou telle officine spécialisée payante (c’est pour les plus aisés une niche fiscale) leur proposent des exercices qui leur permettent d’aller beaucoup plus loin que les autres. Mais il vaut mieux se donner une bonne conscience idéologique qu’organiser des études pour les plus démunis. J’entends des études où ils soient pris en main et non pas amusés par des animateurs. Ainsi, oubliant l’instruction parce qu’on fait prévaloir des considérations sociopolitiques, on accroît inévitablement l’inégalité qu’on voulait pallier. Voilà comment une médecine moliéresque tue le malade.
Apprendre à écrire chez soi
L’interdiction du travail à la maison dans le primaire a des conséquences dans toute la scolarité : mes khâgneux n’avaient pratiquement jamais eu à rédiger des dissertations chez eux avant le baccalauréat. Or si on n’a pas eu à rédiger chez soi d’abord de petits travaux, puis par exemple en seconde des travaux de quatre pages, puis en terminale de huit ou plus, et cela régulièrement, on ne peut pas savoir écrire. Pourquoi chez soi ? À la fois parce qu’il faut laisser un sujet trotter comme on dit dans sa tête pendant longtemps pour arriver à le maîtriser et parce qu’il faut une corbeille à papiers pour faire et refaire des brouillons, se relire à plusieurs jours d’intervalle, etc. Mes étudiants étaient sidérés lorsque je leur disais que j’avais rédigé avant le baccalauréat plus de cinq cents pages, sans compter ce qui est passé à la poubelle, et à la fin je savais écrire à peu près convenablement. Aujourd’hui, on ne fait plus que des travaux en classe, pour éviter cette fois internet ! Représentez-vous en outre le temps perdu : car le temps des travaux faits en classe est pris sur celui des cours.
Discipline et « fascisme » de la langue
Parler de discipline ou de travail, c’est prendre le risque de passer pour une brute qui veut que le maître règne par la force. Roland Barthes, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, en 1977, a soutenu que la langue est fasciste. Allant dans le même sens que Bourdieu, il avait raison de dire que la langue classique n’est pas naturelle, et que la considérer comme naturelle (je comprends : donc ne pas l’enseigner) était une manière de la réserver à une élite sociale qui assurait ainsi sa reproduction. Oui, l’enseignement des lycées était trop souvent implicite, et c’est encore le cas. Mais on s’est bien gardé de conclure à la nécessité d’un enseignement explicite, c’est-à-dire de l’instruction élémentaire. On a considéré avec de pseudo-arguments linguistiques que la langue ne doit pas reposer sur une grammaire normative, que chacun doit s’abandonner à la spontanéité de ses émotions et ne pas être bridé par la nécessité d’écrire selon des règles, que l’oral seul compte, etc. On a même préféré le journal aux grands auteurs. Il est vrai que j’ai vu qu’on revenait parfois aux Fables de La Fontaine et à Hugo. Mais enfin, sait-on que dans les années soixante les élèves de sixième avaient 8 heures de cours de français, et qu’ils n’en ont aujourd’hui que 4 heures et demie ?
Musique et entraînement
Autre exemple. L’instruction suppose qu’on fasse régulièrement des exercices, comme apprendre à jouer d’un instrument requiert qu’on fasse tous les jours ses gammes. Mes enfants, il y a plus de vingt ans, ont découvert le travail non pas au collège mais au conservatoire de musique. Un ami directeur de conservatoire me dit qu’aujourd’hui il est difficile de faire comprendre aux familles et aux enfants ce que c’est que travailler son instrument : l’entraînement en effet n’est plus admis que dans le sport où il va jusqu’à ruiner le corps humain. Qu’un enfant chez lui fasse un travail régulier, quotidien, cela dérange toute la famille. Et l’on s’étonne après cela, à grand renfort de statistiques, que les enfants de professeurs réussissent mieux que les autres ! Certains prétendent même que cela est dû, je cite, à la « culture scolaire » qu’il faudrait abolir.
Bruno Julliard, adjoint au Maire de Paris chargé de la culture, a fait part en décembre 2012 aux professeurs des conservatoires de Paris de son hostilité envers leurs établissements qu’il dit « élitistes ». Je traduis : ils exigent trop des élèves et donc ceux qui ne travaillent pas sont laissés sur le bord de la route, et ceux qui travaillent le doivent à leur milieu social. Là encore, la bonne conscience idéologique coûte moins cher que de doubler la capacité des conservatoires ! J’ai appris aussi qu’on y refusait maintenant de renvoyer les élèves qui ne travaillent pas leur instrument, qui sont absents et qui prennent la place de ceux qui voudraient y entrer pour travailler.
Moins on en fait plus on est débordé
Nos élèves sont désorientés moins pour des raisons sociologiques ou psychologiques, car ces raisons ont toujours existé d’une certaine façon, que parce qu’on ne leur a jamais imposé de travailler. Jean Robelin, qui était professeur à l’université de Nice, a écrit une Tribune le 10 Mars 2013, La gauche et l’éducation, que vous trouverez sur le site de l’Humanité et qui dit tout ce qu’il faut dire sur l’état de notre école et sa destruction par la gauche (comme moi il n’attend rigoureusement rien de la droite en la matière). Jean Robelin écrit qu’un étudiant de vingt ans est généralement affolé lorsqu’on lui demande de lire vingt pages. Les parents eux-mêmes ont l’impression que leurs enfants sont harcelés par leurs études parce que plus personne ne sait ce que c’est que travailler à l’école. Moins on en fait et plus on se croit surchargé de travail.
6 – Comment refonder l’école ?
Ce que je dis du désastre de l’école paraît trop gros, incroyable, même à mes meilleurs amis, même en famille. Mes principes paraissent simplistes et l’école que je propose vieillotte. Il m’est toutefois arrivé récemment d’être conforté par une jeune cousine qui termine ses études d’infirmière par un stage dans un grand hôpital. Un de ses collègues lui disant qu’il allait devoir pour une perfusion prendre mille millilitres de je ne sais plus quel liquide, elle lui a dit : « tu veux dire un litre », et celui-ci lui a alors demandé comment elle l’avait calculé… Bon nombre de ses collègues, me dit-elle, par ailleurs de qualité, ne peuvent pas calculer sans machine la dose d’un médicament ou d’une injection, et du coup ils n’ont pas la moindre idée de ce que peut être un ordre de grandeur, de sorte qu’une erreur de trois zéros est possible : on en meurt parfois. Elle-même a peur d’être hospitalisée un jour. Marguerite Yourcenar se plaignait déjà de la serveuse du supermarché, incapable de rendre la monnaie sans la machine, et elle mettait cela sur le compte de l’école américaine… Nous l’avons égalée.
C’est que l’instruction est, pour nos contemporains, d’un autre temps, peut-être mythique. Tout se passe en effet comme si, parce qu’on va dans la Lune, il fallait aujourd’hui apprendre à marcher aux enfants d’une nouvelle manière : comme si à cause de ces changements la marche devait suivre d’autres principes qu’autrefois. Or l’éducation physique, lorsqu’il y en a une, suit les principes que suivaient les Grecs dont en effet l’éducation était d’abord physique parce qu’il fallait que les citoyens soient de bons soldats. De là, j’aime le rappeler, les épreuves des Jeux Olympiques qui correspondent d’abord aux jeux donnés lors des funérailles de Patrocle au chant XXIII de l’Iliade. Faudrait-il aujourd’hui interdire la course à pied et commencer par apprendre à piloter les avions ? Faudrait-il considérer l’idée républicaine comme obsolète parce qu’elle a été formulée il y a deux mille cinq cents ans et qu’il y a eu depuis lors de grands changements dans la société ? Le drame de l’école vient de ce qu’on y improvise sans cesse des réformes comme si on n’avait jamais su enseigner avant nous, et l’idée même d’instruction élémentaire devient totalement inintelligible. Ainsi, pourquoi se presser d’informer les élèves des dernières découvertes sans leur faire suivre les étapes nécessaires à leur compréhension ? Par exemple, à quoi bon parler de big-bang à des élèves qui n’ont jamais regardé le ciel, ou d’ADN s’ils ne savent pas distinguer un animal et un végétal et n’ont jamais pu faire de chimie ? Pourquoi ne pas commencer par faire observer et décrire, ce qui apprend en même temps le français ? Par faire de la botanique et de la zoologie et non pas par parler de molécules ? Théodore Monod regrettait la disparition de l’histoire naturelle. Ce que je demande pour l’école ne trouvera pas d’obstacle du côté des élèves mais de leurs parents qui contrairement aux paysans de la troisième République s’imaginent savoir et donc pouvoir juger de l’enseignement que reçoivent leurs enfants. Il est vrai aussi que ce que je dis implique une révolution dans la formation des maîtres.
Que faut-il et que suffit-il de faire pour avoir une véritable école ? Habituer les enfants à la classe progressivement dès la maternelle : les philosophes qui ont fait l’expérience du préceptorat au XVIIIe siècle (je l’ai déjà dit sur Mezetulle) considéraient la classe comme salutaire parce qu’elle apprend à l’enfant à n’être plus le seul roi du lieu. Cela suppose évidemment que les parents d’élèves cessent de jouer le même rôle à l’école que les aristocrates qui harcelaient les précepteurs. Entraînons assez tôt les élèves à écouter en silence (discipline dont on est aujourd’hui dispensé à l’école et même à l’université), puis à suivre le cours d’une pensée organisée conduite par un maître, au lieu de les laisser à leurs préjugés ; donc ne considérons pas le cours magistral comme une aberration. Habituons-les à faire des exercices, à apprendre des leçons, à travailler – un travail intelligent et non pas des punitions vexatoires et sans intérêt. Ou encore donnons une grande place à la récitation de poèmes – j’ai vu un jeune homme ébahi au théâtre demander à l’acteur comment il pouvait savoir tant de vers par cœur ! Et dès le plus jeune âge, lisons de belles pages de la littérature française, sans quoi on ne peut pas apprendre vraiment sa propre langue, et la langue alors reste un privilège de classe – d’où, en effet, le terme de classique qui vient de classicii, la haute, par opposition aux proletarii. Ce programme ne ruinerait pas les finances publiques, il n’exige pas des moyens considérables, sinon la détection, le plus tôt possible, des 12%, je crois, de dyslexiques, et la prise en compte des élèves que des raisons particulières empêchent de suivre la voie commune et qui sont aujourd’hui noyés dans la masse, et surtout la mise en place systématique, je dis bien systématique, d’un enseignement du français pour les étrangers quels qu’ils soient, pas seulement les fils d’ambassadeurs des lycées internationaux.
Une telle refondation réelle de l’enseignement primaire pourrait au bout de cinq ans permettre la refondation des collèges et plus tard des lycées. Car il faut du temps dans ce domaine comme dans les eaux et forêts. Et les élèves seraient préparés par l’esprit de l’instruction publique et par la discipline ordinaire qui lui est liée à exercer leur fonction de citoyen. Par-dessus le marché, une instruction élémentaire étant nécessairement générale à tous les niveaux, elle leur permettrait d’affronter la vie professionnelle pour laquelle très souvent aucune formation spéciale préalable n’est possible étant donné la transformation incessante des compétences exigées. Alors on cessera de voir dans l’école un fournisseur de compétences soumis au marché du travail.
7 – Quels sont les présupposés de mon propos ?
Je l’ai dit, mes propos passent pour simplistes. Ils irritent parce qu’ils signifient que depuis cinquante ans au moins, au lieu de corriger les défauts d’un enseignement qui reposait sur une tradition de plus de deux mille ans, puisqu’elle venait des Grecs par l’intermédiaire des Romains et des chrétiens, puis de l’école laïque, on a rompu avec cette tradition.
Quels sont mes présupposés ? Ceux-là même qui m’ont déterminé à enseigner la philosophie. Et d’abord celui-ci : l’homme pense ! Hegel disait qu’il faut répéter sans cesse que l’homme pense. Que l’homme pense signifie que sa vie dépend de ses représentations et donc que la maîtrise de ses représentations est essentielle, qu’elle seule peut lui permettre de prendre pour sa vie les décisions qui conviennent. Les orateurs politiques l’ont toujours su, nos communicants le savent, eux qui gouvernent le monde en fabriquant les opinions et les désirs des hommes. Celui donc qui ne veut pas être le jouet de ses représentations illusoires, d’où qu’elles viennent, doit apprendre, c’est-à-dire apprendre à distinguer le vrai du faux. La philosophie est la volonté de comprendre, de vivre selon ce qu’on comprend et non selon des opinions qui s’imposent sans qu’on les ait jugées. Certes, s’être élevé à une telle idée de la philosophie interdit qu’on se dise soi-même ou même qu’on tolère d’être dit philosophe..
Cet idéal philosophique est-il donc trop élevé pour une école publique ? Je ne suis moi-même ni Platon, ni Descartes ; je n’ai jamais imaginé m’adresser seulement aux futurs Platon et Descartes. Une instruction élémentaire réelle suffit à élever un homme assez haut pour qu’il mène une vie d’homme et qu’il exerce sa citoyenneté : cette instruction peut s’adresser au plus grand nombre. Il le faut, parce qu’il y a une relation nécessaire entre le savoir et la liberté. Condorcet l’a dit une fois pour toutes. Relisons ce que j’ai déjà cité sur Mezetulle : « Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à la raison seule, qui recevront leurs opinions d’une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées, en vain ces opinions de commande seraient d’utiles vérités ; le genre humain n’en resterait pas moins partagé en deux classes : celle des hommes qui raisonnent, et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. » (Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique 1792) Tout est dit. Pour que le savoir ne soit pas un instrument de pouvoir, il faut une instruction publique. Attention ! Le maître qui opprime des esclaves se dit en latin dominus, et non pas magister, il n’est pas maître dans le même sens que le magister, maître d’école, qui au contraire apprend à se libérer de toute domination.
8 – École et république
Tout à l’école doit être subordonné au dessein d’instruire, tout sans exception, ou bien il n’y a plus d’école. Mais du seul fait qu’elle instruit, l’école est l’école du citoyen. Et notez ce point essentiel : si elle est l’école du citoyen, si elle doit être l’école de la République, ce n’est pas parce qu’elle est subordonnée à un dessein politique. Il y aurait certes dans cette école, si elle existait, une instruction civique, qui rendrait compte des institutions et de ses lois, mais sans leçons de morale, puisque la discipline intellectuelle et la discipline de travail liées à la nature de l’instruction, ainsi que la nécessaire discipline de la classe, comportent déjà l’essentiel de la morale. Alain se moquait des cours de morale, parce qu’il jugeait que l’instruction suffit à former le jugement et l’esprit critique. Là encore, subordonner l’enseignement à l’inculcation de ce qu’on appelle les valeurs de la République, c’est oublier l’instruction, nécessairement. Au fond, c’est concevoir l’école publique sur le modèle de certaines écoles privées où les exigences confessionnelles et idéologiques l’emportent sur le dessein d’instruire et déterminent le choix des parents. On peut pardonner à Jules Ferry qui avait à lutter contre la domination du clergé catholique sur l’enseignement d’avoir institué une morale laïque, d’autant qu’il tenait aussi à l’instruction. Mais dans une école qui ne remplit pas sa fonction propre d’instruction, à quoi bon des cours de morale ? Et comment, étant donné l’état d’esprit de la société et des parents d’élèves, comment, quand l’autorité des maîtres n’est pas reconnue, et cela non pas accident mais pour les raisons de principe que je viens de formuler, parce que l’instruction n’est pas la fin de l’école, comment éviter qu’on impose, en guise de morale, l’idéologie régnante, celle du marché ? Instruisons donc les élèves, et l’on verra ensuite s’ils ont besoin de leçons de morale.
L’obligation scolaire
On objectera à coup sûr à ce que j’ai dit de la motivation, que je la remplace par une discipline qui est une contrainte du même ordre, puisqu’elle s’impose aux enfants le cas échéant malgré eux. Mais contraindre à apprendre, est-ce opprimer ? Dans une vraie classe, ce qui suppose en effet discipline, l’enfant prend conscience de l’obligation pour tout homme de s’instruire s’il ne veut pas demeurer esclave. En un premier sens l’obligation scolaire s’adresse aux parents, en un second, aux enfants : elle est vécue par eux comme une contrainte quand l’intérêt du savoir s’éveille tard ou trop faiblement. Ainsi une exigence morale dans son fond – libérer l’homme – appelle une politique de l’école, une politique d’instruction publique : il faut choisir entre la contrainte du milieu, origine des motivations, et un ordre d’artifices et de contraintes qui se revendique comme tel, à savoir l’institution scolaire : la fonction institutionnelle de l’école est de délivrer l’homme de la société. Entre subordonner l’école à la société, donc la détruire, et instituer une véritable école, il faut choisir.
Républicains et pédagogistes
Avant de conclure, une remarque. Je ne me contente pas d’opposer républicains et pédagogistes. Opposer républicains et pédagogistes peut en effet s’entendre en plusieurs sens. D’un côté il y a de sincères républicains parmi ceux qui sont pédagogistes au sens péjoratif que j’ai donné à ce terme. Mais ils ne voient pas la contradiction qu’il y a entre le pédagogisme et l’exigence républicaine. De l’autre côté des républicains veulent, comme je viens de l’indiquer, un catéchisme des valeurs qui n’est pas une véritable instruction : or l’instruction, si du moins la laïcité n’est pas un vain mot, ne saurait par exemple interdire à un élève d’être monarchiste pourvu qu’il respecte dans sa conduite les lois de son pays. Il y a donc une façon très pédagogiste d’être républicain !
Conclusion
L’exigence d’une école de la République repose sur une idée du rapport de la liberté et du savoir qui n’est pas d’abord « politique ». Et en effet, la philosophie a formulé l’idée de république, mais ce n’est pas en tant qu’elle serait une philosophie politique d’abord, c’est parce qu’elle est la philosophie tout court, la volonté de comprendre, de penser. Je veux bien qu’on me dise républicain par opposition aux pédagogistes, mais ce n’est pas mon républicanisme qui détermine ce que j’ai dit de l’enseignement, c’est rigoureusement l’inverse. Et celui qui aime le savoir (comme le dit en grec le mot de philosophie), s’il l’aime réellement, est pédagogue : la vraie pédagogie consiste pour un professeur à refaire sans cesse son cours pour le rendre plus intelligible, ce qui revient pour lui à réapprendre ce qu’il sait. Et cela est vrai de l’instituteur qui retrouve devant sa classe les règles de la soustraction, aussi bien que de Kant qui disait qu’il faut faire cours pour s’assurer que ce qu’on pense est intelligible, c’est-à-dire qu’on se comprend soi-même. Car apprendre vraiment est toujours réapprendre, comme l’a montré Platon.
Appendice
J’ai lu le 28 mai sur le Nouvelobs en ligne une interview d’un sociologue, François Dubet, présenté comme un fin connaisseur des questions scolaires, et interrogé sur le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des enseignants (gestion qui, je sais, est catastrophique). Tout ce que disait Dubet n’est pas faux, loin de là. Mais sur le principe, sur la cause et la nature du mal présent, qu’il reconnaît, il soutient très exactement le contraire de ce que l’on vient de lire : le mal viendrait selon lui de ce que les professeurs du second degré continuent de se considérer comme des savants [sic] alors que le public a changé puisque aujourd’hui on accueille tout le monde dans les collèges contrairement à ce qui se passait auparavant. Je soutiens au contraire que c’est cette façon de penser qui est la cause du mal.
Cette étiologie est aberrante à plus d’un titre.
1/ Ce qu’elle prétend n’est pas vrai du primaire qui accueille tout le monde depuis longtemps et dont la situation est devenue très mauvaise selon Dubet lui-même.
2/ Ce bouleversement date du baby boom, et il ne reste plus aucun professeur en place ayant connu les lycées d’antan. Certes, cela ne prouve pas que l’ancienne mentalité n’a pas laissé des traces, mais il ne semble pas qu’aujourd’hui les professeurs dans leur grande masse se prennent pour des savants !
3/ Pourquoi les fils de bourgeois auraient-ils pu avoir pour professeurs des savants, mais pas le tout venant ? Et pourquoi ceux-ci auraient-ils besoin d’une pédagogie spéciale ne reposant pas sur le savoir ?
C’est ce que j’appelle le mépris des élèves. Ce mépris peut venir de la nostalgie du lycée bourgeois, qui était en réalité le lycée des chahuts et de la violence, lycée dénoncé par Alain avant 1914, mais il peut venir aussi de considérations sociologiques bien intentionnées. Où l’on voit que les plus réactionnaires et la gauche présente s’entendent fort bien, et le rapport de la Cour des comptes en est une preuve de plus.
Notes