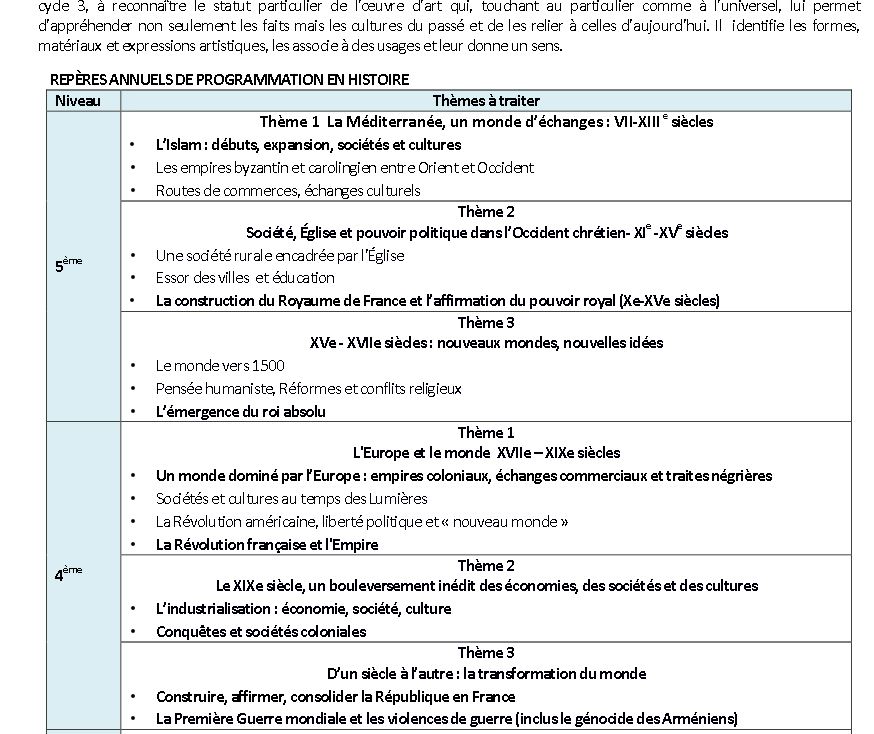Jeanne Favret-Saada a bien voulu confier à Mezetulle les « bonnes feuilles » de son livre à paraître chez Fayard Les christianismes contre le blasphème. Cinéma et liberté d’expression, 1965-2006, avec l’aimable autorisation de l’éditeur1. Elle nous convie ici à une passionnante plongée dans l’histoire moderne du délit de blasphème et des « habits neufs » dont il se revêt inlassablement. La période que nous vivons n’est pas en reste : un siècle après sa disparition, en s’engouffrant paradoxalement dans les virtualités d’une loi de 1972 contre le racisme, le délit d’opinion religieuse a fait sa réapparition dans nos prétoires. Il diffère de l’ancien délit de blasphème en ce qu’il ne sanctionne plus les offenses à Dieu mais celles à la « sensibilité de ses fidèles ».
Depuis les années 1980, des associations de défense des intérêts religieux – catholiques dans un premier temps, puis également musulmanes – ont intenté des poursuites en justice pour atteinte grave aux « sentiments religieux d’un groupe de personnes ». Ces plaintes concernent, par exemple, des films (Je vous salue, Marie, ou La dernière tentation du Christ), des affiches publicitaires de films (Ave Maria, Amen) ou de produits commerciaux (des voitures, ou des vêtements portés par les participants à La Cène), des tracts (Sainte-Capote), etc. Ce qui, dans un Royaume de France uniconfessionnel, avait été jadis un crime de « blasphème » s’est ainsi mué, dans une République laïque et pluraliste, en un délit contre un supposé droit universel de l’homme, celui au « respect des convictions religieuses » d’une fraction des citoyens.
Pendant une vingtaine d’années, il s’est trouvé des juges pour cautionner leurs arguments, jusqu’à ce que la Cour de cassation, après la Cour européenne des droits de l’homme, rende normalement impossibles de tels verdicts. Toutefois, ces rappels à l’ordre n’ont pas tari les demandes de poursuites judiciaires, comme si les associations dévotes, parmi lesquelles celle de l’Épiscopat français, attendaient simplement que les juges recouvrent la raison. Ces phénomènes, joints aux exhortations récurrentes à trouver des « accommodements raisonnables » avec les demandes religieuses, incitent à s’informer sur l’histoire du délit de blasphème au temps des monarchies, et à préciser les modalités de sa réapparition cent ans après le fondation d’une République laïque.
Nous considérons aujourd’hui toute accusation de blasphème comme un empiètement insupportable des institutions religieuses sur le domaine de l’État et du citoyen, d’autant que les religions entendent encore régir en détail la vie des sociétés, et qu’elles ne ménagent guère leurs efforts en ce sens. Toutefois, l’histoire judiciaire du blasphème montre aussi l’autre partie du complexe politico-religieux, le fait que l’État, pour sa part, a longtemps exploité l’atout maître que la sacralité religieuse lui apportait : en le haussant infiniment au-dessus des citoyens, assurer leur discipline au moindre coût. Il convient donc de décrire ce phénomène, en insistant particulièrement sur la période finale de la répression du blasphème, quand, après la chute de la monarchie absolue, la France essaie l’une après l’autre plusieurs modalités d’autocratie ou de monarchie limitée : pendant près de soixante ans, toutes les religions reconnues par l’État sont supposées être égales – mais une seule d’entre elles constitue une force politique décisive -, tandis que les proclamations publiques d’athéisme sont interdites, réputées qu’elles sont de menacer l’ordre public.
Le texte qui suit propose donc le parcours historique suivant :
- I – Alors que l’Ancien Régime (période où le catholicisme, fondement de l’ordre politique et social, est protégé par un roi de droit divin) a puni le crime de blasphème avec une dureté croissante, la chute de la monarchie absolue, en 1791, a entraîné son abolition.
- II – Au début de la Restauration, un bref épisode libéral a permis de rétablir la liberté de la presse et d’abolir les délits d’opinion à l’exception d’un seul, sur la religion, pour lequel on a créé l’expression équivoque d’outrage à « la morale publique et religieuse ».
- III – Dès que la droite ultraroyaliste amorce la spirale du triomphe, et que la censure de la presse reparaît, un second délit d’opinion religieuse vient s’ajouter au précédent, l’outrage à « la religion de l’État ».
- IV – Sur ces deux fondements, la Monarchie de Juillet et le Second Empire incriminent surtout les atteintes aux valeurs bourgeoises – la famille, la propriété privée, l’autorité de l’État -, que le catholicisme est supposé sanctifier.
- V – L’outrage à la morale publique et religieuse, et celui au catholicisme sont enfin abolis par les lois sur la presse de 1881. D’une façon plus générale, l’arrangement politico-religieux qui a si longtemps rendu possible la criminalisation du blasphème se défait, sa suppression devenant pérenne en 1905 avec la séparation des Églises et de l’État.
I. Le crime de blasphème et son abolition
À partir du XIIe siècle, à mesure que la monarchie se renforce et qu’elle développe l’idéologie du droit divin, le péché religieux de blasphème se mue en un crime politique, poursuivi comme tel par la justice laïque : mal parler de Dieu, c’est insulter le pouvoir royal. Certains historiens du droit notent l’existence d’un contraste saisissant entre, d’une part, l’abondance et la sévérité de la législation, et, d’autre part, la rareté des poursuites (les magistrats détestant se charger d’une infraction aussi flasque) et l’indifférence des populations envers des conduites que le pouvoir royal ne cesse pourtant pas de vitupérer2. Au XVIe siècle, quand le succès des idées protestantes menace l’unité confessionnelle de la nation, le crime de blasphème s’étend aux propos hérétiques, dont la sanction ne peut plus être une simple peine de prison assortie d’une amende. Le juge requiert alors des peines corporelles de plus en plus sévères : bientôt la mort, mais après le percement de la langue et un arsenal d’humiliations et de tortures dignes de Daesh. Signalons que l’Église catholique n’approuve pas toujours l’extrême cruauté des sanctions, et que plusieurs papes incitent leurs champions royaux à la mansuétude. Toutefois, l’accession au trône ou bien la survenue d’une crise politique susceptible d’affecter la sacralité royale s’accompagnent désormais d’un nouvel édit contre le crime de lèse-divinité.
Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle européen, sous l’influence, notamment, de Montesquieu et de Beccaria, la classe cultivée – dont on sait qu’elle découvre alors ce qu’on appellera, pour faire court, l’État de droit – devient de plus en plus hostile à cet absolutisme judiciaire, qui n’a pas d’autre fin que l’apologie de l’institution royale. Des centaines de lettrés, surtout des juristes, reprennent à leur compte les thèses de Montesquieu et de Beccaria, certains d’entre eux ébauchant déjà les fondements d’un nouvel ordre politique. Deux principes des Lumières préparent l’abolition du délit de blasphème. D’une part, l’exigence d’une ferme séparation entre la morale, le droit et la religion : « On ne doit point statuer par les lois divines ce qui doit l’être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l’être par les lois divines » (Esprit des Lois, Livre XXVI, 2). D’autre part, la conviction nouvelle que la religion n’est éventuellement avantageuse que pour sa contribution à l’ordre public : autrement dit, pour son utilité sociale et non plus pour sa sainteté intrinsèque. Enfin, Montesquieu ridiculise la principale justification des poursuites pour le crime de lèse-majesté divine qu’est devenu le blasphème : « Le mal est venu de cette idée, qu’il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se règleront sur son infinité, et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine » (Esprit des Lois, XII, 4).
Tout au long du XVIIIe siècle, les juges ont beau appliquer les ordonnances de Louis XIV avec une tiédeur croissante, elles n’en figurent pas moins dans la législation. En 1766, un extraordinaire concours de circonstances – tant locales que nationales, à Abbeville et à Paris – aboutit à l’exécution du chevalier de La Barre : avec l’assentiment du roi et du parlement de Paris, un jeune provincial de vingt ans est condamné à avoir la langue coupée, puis à être décapité et brûlé avec un livre trouvé en sa possession, le dangereux Dictionnaire philosophique de Voltaire. Celui-ci s’est déjà signalé dans deux affaires d’abus de justice concernant des protestants, Calas et Sirven. Quelques jours après, il publie une Relation de la mort du chevalier de La Barre à Monsieur le marquis de Beccaria ; en 1769, il introduit un rappel de l’affaire dans l’article « Torture » de son Dictionnaire philosophique ; enfin, en 1775, il publie Le Cri du sang innocent. Grâce à quoi, en moins de dix ans, l’Europe éclairée rejette avec horreur l’indicible cruauté avec laquelle la justice royale a cru devoir, une fois de trop, venger Dieu.
La Révolution française abolit le crime de blasphème sans même avoir besoin d’en faire une mention explicite : il est tout simplement incompatible avec le nouvel ordre politique et juridique. Cette abrogation exige toutefois deux années d’intense radicalisation politique : le 6 août 1789, l’Assemblée Constituante vote le préambule de la Constitution à venir, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; au terme de la journée insurrectionnelle du 5 octobre 1789, Louis XVI accepte enfin de ratifier la Déclaration ; le 13 septembre 1791, il reconnaît une Constitution qui comporte la Déclaration des droits. Or celle-ci transfère la souveraineté du roi à la Nation, soumet le monarque à la loi commune (« Il n’y a pas, en France, d’autorités supérieures à celle de la loi » , « le roi ne règne que par elle »), et fait de lui le chef de l’exécutif, le « roi des Français ». Enfin, le 25 septembre 1791, le nouveau Code pénal est adopté.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose les trois principes fondamentaux de liberté, de liberté d’opinion, et de liberté de communication. Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi »3. Article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. » Deux conséquences s’ensuivent. D’une part, les droits naturels des citoyens – eux-mêmes libres et égaux par principe -, ne sont limités que par la loi, c’est-à-dire par des règlements explicites consignés dans un Code avant toute infraction. D’autre part, la liberté d’opinion, notamment en matière de religion, a pour prolongement nécessaire la liberté d’expression. Cela nous paraît aller de soi, mais un tel lien est loin d’être reconnu de façon universelle : le droit islamique, par exemple, accorde une totale liberté de pensée à l’individu à la seule condition qu’elle ne franchisse jamais les bornes de son for intérieur.
Le Code pénal de 1791 se situe dans la filiation directe de la Déclaration des droits de l’homme. Son rédacteur, le constituant Le Peletier de Saint-Fargeau, souligne dans le Rapport sur le projet de code pénal (1791) qu’il a voulu rendre hommage aux « idées du siècle de Montesquieu et de Beccaria », tous deux ennemis jurés de « cette foule de crimes imaginaires qui grossissaient nos anciens recueils de lois. Dont ceux – hérésie, lèse-majesté divine, sortilège, magie – pour lesquels, au nom du ciel, tant de sang a souillé la terre »4. D’une façon plus générale, le Code pénal ne sanctionne que les « vrais crimes », ceux qui concernent les personnes envisagées du point de vue du droit naturel, elles-mêmes et leurs biens matériels : les délits d’expression, ainsi que tous les « délits factices, créés par la superstition, la féodalité, la fiscalité et le despotisme » sont donc abrogés5. La France devient ainsi le premier État au monde dont la législation ignore le blasphème : les États-Unis d’Amérique l’ont aboli en 1787, mais la mesure ne concernait que la Fédération et non les États, qui ont refusé de s’en priver.
L’on sait qu’en France, les délits de presse sont rétablis dès la chute de la monarchie constitutionnelle en 1792, et qu’ils ne tardent pas à viser, au-delà des journaux royalistes, « empoisonneurs de l’opinion publique », toute opinion hostile au pouvoir en place. À l’exception d’une courte période allant de la chute de Robespierre au coup d’État du 18 fructidor an V, la presse française est invariablement censurée entre l’été 1792 et la fin du Premier Empire en 1814. Notons pourtant qu’au cours de cette longue période, le délit d’opinion religieuse n’est jamais poursuivi : la Convention montagnarde réhabilite même le chevalier de La Barre en 1793. Le Consulat et le Premier Empire ne rétablissent pas le crime de blasphème, malgré le Concordat de 1801 avec le Vatican et le Code pénal de 1810, qui protège l’exercice du culte par un nombre infini de dispositions : c’est que Napoléon Bonaparte, soucieux de faire bénéficier l’État de l’utilité de la religion – cette inégalable usine à produire des sujets disciplinés -, est indifférent à sa sainteté supposée, demeurant en cela un homme du XVIIIe siècle.
II. Presque un pléonasme : l’outrage à la morale publique et religieuse
La Charte constitutionnelle que Louis XVIII a octroyée à son peuple lors de son retour d’émigration, prend effet en juillet 1815 après l’intermède des Cent-Jours. D’un côté, elle ancre la monarchie des Bourbons dans la volonté divine et elle adjuge à la personne du roi, « inviolable et sacrée », « l’autorité tout entière » ainsi que les pleins pouvoirs législatif et exécutif6 ; de l’autre, elle concède aux Français une représentation bicamérale (visant à informer le souverain de l’état de l’opinion), et le bénéfice des principaux acquis de la Révolution : l’égalité civile, la liberté individuelle, la liberté de religion, et la liberté de la presse7. (Néanmoins, la « religion catholique, apostolique et romaine » devient « la religion de l’État », et non plus celle de « la majorité des Français ».)
Mais la liberté de la presse, instaurée dès les Cent-Jours, succombe à la première confrontation entre Louis XVIII et les ultraroyalistes, partisans d’un retour pur et simple à la monarchie absolue d’Ancien régime. Ils ont été des adversaires déterminés de la Charte et du projet politique du roi, qu’ils jugent complaisant avec les idéaux des Lumières et l’héritage de la Révolution. En août 1815, la première élection législative du nouveau régime se fait sur la base du cens impérial, qui avait réduit l’électorat à cinquante mille propriétaires fortunés. S’en dégage une Assemblée composée à 88% d’ultras, « une Chambre introuvable » selon le mot du roi, qui n’y trouve pas d’alliés, et qui refuse de lui confier la direction des affaires. Il désigne comme président du Conseil des ministres un aristocrate libéral au nom illustre, du Plessis de Richelieu, qui a émigré en Russie pendant la Révolution mais qui adhère pleinement à la Charte, et qui se situe au centre droit. Un an plus tard, Richelieu a fait voter assez de lois répressives pour que les ultras soient à peu près calmés : le roi peut alors dissoudre la Chambre et conserver son chef du gouvernement. Il lui ordonne d’abaisser le cens électoral (pas trop, tout de même), et de rétablir un degré approprié de censure : une loi sur la presse, le 22 février 1817, rétablit l’autorisation préalable pour les journaux et périodiques, au grand dam des ultras qui clament leur attachement à cette liberté nouvelle – dont bien sûr chacun sait qu’elle ne survivrait pas à leur accession au pouvoir.
Le calme étant rétabli à la fin de l’année 1818, le gouvernement, avec l’appui du roi, peut enfin s’offrir la politique libérale dont il rêvait. L’inspirateur en est le petit groupe des Doctrinaires, conduit par Royer-Collard8 et son élève, le jeune historien François Guizot9. Ils ont appelé de leur vœux l’instauration d’une monarchie qui s’appuierait sur une élite du talent (les « capacités »), et qui serait attentive à l’opinion d’une nation de citoyens libres. Jusqu’ici, ils ne se sont pas montrés spécialement attachés à la liberté de la presse, ayant approuvé sans états d’âme les mesures de censure prises par les ministères précédents. Toutefois, désormais proches du pouvoir en place, ils saisissent l’occasion d’ouvrir plus grand l’espace du débat public, de compléter la Charte, et de poursuivre l’édification de l’État de droit : selon Guizot, ces multiples intentions convergent dans le projet de « fonder légalement la liberté de la presse »10. Il conçoit alors un règlement simultané des différents aspects du droit de la presse dans un ensemble de trois lois : la première, sur les délits commis par voie de presse, la deuxième, sur leur poursuite et leur jugement, et la troisième, sur les conditions de publication des journaux et écrits périodiques.
En mars 1819, le comte de Serre11, garde des Sceaux et proche du parti des Doctrinaires, propose à la Chambre des députés ces lois qui se veulent exemplairement libérales. Elles suppriment en effet toute autorisation préalable, toute censure, et toute entrave sauf un cautionnement onéreux visant à responsabiliser le directeurs de journaux12 ; les délits de presse cessent d’être punis de la déportation, mais seulement de la prison et de l’amende ; enfin, les délits sont réduits à quatre, la provocation directe aux crimes et délits, l’outrage à la « morale publique », l’offense au roi et la diffamation. L’idée centrale est de rendre désormais impossible toute poursuite pour délit d’opinion, notamment en confiant à des jurys de citoyens dans des cours d’assises – et non à des tribunaux correctionnels – le soin d’apprécier et de juger les contraventions.
Ces lois de 1819 auraient en effet presque rétabli la liberté proclamée en 1791 si la première d’entre elles, une fois votée, n’avait comporté un certain article 8 sur l' »outrage à la morale publique et religieuse« 13 : deux petits mots censés préciser la notion apparemment neutre de « morale publique », et qui rétablissent de façon explicite le délit d’opinion en matière de religion. Il convient d’examiner avec soin les circonstances dans lesquelles cette nouvelle formulation du délit de blasphème apparaît, car elle subsistera dans la loi française jusqu’en 188114.
La Charte de 1814 avait posé le principe de la liberté de religion (art. 5. « Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection ») avant même de définir la place du catholicisme (art. 6. « Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État ») et celle des religions reconnues, protestantisme et judaïsme, qu’elle évoquait seulement de manière indirecte. L’article 8 sur la liberté d’expression (« Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté ») avait abandonné à la loi le choix des moyens destinés à protéger les religions : c’est précisément l’objet de celle de 1819 sur les délits de presse.
Lors du débat à la Chambre des députés, Hercule de Serre, le rapporteur, présente un article 8 sur la punition de l' »outrage à la morale publique ou aux bonnes mœurs ». La référence aux « bonnes mœurs » est inévitable, puisque ce délit est déjà puni par le Code pénal de 1810 encore en vigueur. Par contre, la notion de « morale publique » est une innovation juridique. De Serre la justifie par « le besoin de rétablir les principes moraux sur leurs fondements » après « les bouleversements qui ont agité, non seulement l’ordre politique, mais l’ordre moral sur lequel repose l’existence même de la société »15. Il dit avoir délibérément évité le terme de « religion », et lui avoir préféré celui de « morale », afin de garantir le droit constitutionnel à la liberté de religion, ainsi que ses inévitables conséquences, l’égalité des cultes et la liberté de controverse entre fidèles de confessions différentes. Le pluralisme religieux et la tolérance, en effet, supposent que chacun soit libre d’exposer ses propres « dogmes et ses principes », et de critiquer – voire même de combattre – les autres religions, puisque leurs idées sont autant d’hérésies et d’outrages à la divinité ; et que leurs pratiques paraissent idolâtres ou superstitieuses. D’ailleurs, la Charte a entériné l’existence d’un désaccord fondamental entre les Français sur leurs principes ultimes. Aussi les conflits religieux n’ont-ils pas leur place dans les tribunaux : leur lieu naturel doit demeurer l’espace public de la controverse, c’est-à-dire la presse.
Le délit de presse qui va tomber sous le coup de la loi est dénommé « outrage à la morale publique » pour deux raisons : d’une part, on l’a vu, sa désignation ne doit pas comporter de référence à la religion ; et d’autre part, elle doit contribuer à instaurer un espace civil commun à tous les Français. Selon le Hercule de Serre, en effet, une religion se compose d’idées (le « dogme »), de pratiques (le « culte »), et de préceptes (la « morale »). Mais alors que les « dogmes » et les « cultes » diffèrent et se combattent, la « morale », fondation commune de toutes les religions, est immuable. Les humains – et parmi eux, les Français, catholiques, protestants ou juifs – partagent donc une même morale religieuse, qui préexiste aux religions positives, et qui leur survivra. À l’aube de l’humanité, elle fut celle des peuples primitifs ; et en 1819, elle réunit tous les Français. Écoutons de Serre :
« La morale publique est celle que la conscience et la raison révèlent à tous les peuples comme à tous les hommes, parce qu’ils l’ont reçue de leur divin auteur, en même temps que l’existence ; morale contemporaine de toutes les sociétés, que sans elle nous ne pouvons pas comprendre ; parce que nous ne saurions les comprendre sans les notions d’un Dieu vengeur et rémunérateur du juste et de l’injuste, du vice et de la vertu, sans le respect pour les auteurs de ses jours et pour la vieillesse, sans la tendresse pour les enfants, sans le dévouement au prince, sans l’amour de la patrie, sans toutes les vertus enfin que l’on trouve chez tous les peuples, et sans lesquelles tous les peuples sont condamnés à périr »16.
L’examen des éclaircissements apportés par de Serre montre qu’en réalité, cette « morale publique » inclut trois composants religieux : des « vérités » ontologiques (l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme), des « vérités » morales (Dieu, juge suprême des comportements humains) et des préceptes moraux, avec leurs inévitables prolongements politiques (le respect envers Dieu, la famille, la patrie et le souverain)17. On aperçoit d’emblée la difficulté à laquelle vont être confrontés les juges chargés de statuer sur de possibles outrages à la « morale publique » : le Dieu postulé par cette loi – transcendant, justicier, et fournisseur de préceptes universels – n’est ni catholique, ni juif, ni protestant, ni celui d’aucune tradition religieuse particulière, car il est une forme vide, l’abstraction qui permet d’instaurer un régime de toleration18.
À l’annonce de ce concept politico-religieux qui ne dit pas son nom – « morale publique » -, deux députés de l’opposition royaliste s’insurgent contre le fait que le gouvernement veut élargir la liberté d’expression sans avoir pris la précaution de protéger formellement la religion, et ils proposent des amendements en ce sens. Le plus radical est celui du représentant de la Haute-Loire, Chabron de Solhilac, un ancien officier chouan de l’Armée catholique et royale des Côtes-du-Nord : il demande que la loi remplace l’outrage « à la morale publique » par celui « à la religion et aux cultes reconnus par l’État ». Or c’est précisément ce que le gouvernement voulait éviter de faire, et que la grande majorité de l’Assemblée refuse d’une même voix : les ultras eux-mêmes – une puissante minorité – verraient certes un immense intérêt à protéger le catholicisme (« la religion de l’État »), mais pas au prix de secourir les protestantismes. L’amendement est donc aisément rejeté.
Au contraire, le député du Calvados, Texier d’Hautefeuille se contente d’ajouter une précision minuscule au texte de l’article 8, en proposant qu’il sanctionne l’outrage « à la morale publique et religieuse… »19. Cette modification minime va susciter un débat dont nous avons, aujourd’hui, quelque difficulté à nous représenter les enjeux parce qu’il oppose des députés également monarchistes, élitistes, et chrétiens. Parmi les libéraux, Royer-Collard, proche des concepteurs du projet de loi, objecte immédiatement que cette adjonction est inutile puisque la « morale publique » est, par définition, inséparable de la religion. Certains ultras formulent aussi la même objection, mais avec d’autres arrière-pensées. Ainsi, le vieux catholique traditionaliste Louis de Bonald, souligne à plaisir les équivoques du gouvernement :
« On ne peut pas plus dire morale religieuse qu’on ne peut dire religion morale, puisqu’une religion qui ne serait pas morale ne serait pas une religion, comme une morale qui ne serait pas religieuse ne serait pas une morale, mais un simple code de bienséances. En un mot, un devoir sans pouvoir »20.
Au banc du gouvernement, l’amendement proposé paraît tout bonnement superflu. Le garde des Sceaux ne comprend pas pourquoi il faudrait préciser « et religieuse », puisque sa définition de la « morale publique » contient déjà tout ce que le député de droite voudrait protéger : en faisant silence sur le caractère religieux de cette morale, de Serre a voulu empêcher que les juges ne la confondent avec la leur propre (ou celle de telle religion positive), que cet article 8 n’a pas vocation à protéger.
Toutefois, en raison de la confusion générale des esprits sur les relations exactes que le gouvernement souhaite établir entre morale et religion, l’amendement de Texier d’Hautefeuille gagne peu à peu des partisans. Aussi le garde des Sceaux finit-il par y consentir : « et religieuse » constitue une « répétition inutile, mais non dangereuse », qui signale « ce qui est commun à tout homme moral, indépendemment du culte qu’il professe »21. La Chambre des députés adopte alors, à la quasi-unanimité, un amendement qui passera longtemps pour une concession inoffensive aux ultras.
À la Chambre des pairs, l’amendement de Texier d’Hautefeuille suscite d’ailleurs le même malentendu, au point que le rapporteur de la loi, le jeune duc de Broglie22 – un libéral très fervent qui, en 1817, a refusé de voter le rétablissement de l’autorisation préalable -, accepte sans difficulté l’idée d’un outrage « à la morale publique et religieuse ». Pour une bien étrange raison, toutefois, si l’on considère que l’établissement d’une loi vise à donner aux juges une méthode simple pour distinguer le licite de l’illicite : car selon de Broglie, « morale publique et religieuse » a l’avantage « de ne rien exclure et de ne rien désigner », si bien que les jurys de citoyens pourront l’adapter à leur perception spontanée des situations, et qu’ils disposeront ainsi, au nom de « la société », d' »une arme pour la défendre précisément au point où elle se sentirait blessée »23.
Les trois lois sur la presse sont promulguées en mai et juin 1819. Envisagées ensemble, elles constituent une formidable rupture avec deux décennies d’entraves à la liberté d’expression, qui a permis, entre autres, l’extraordinaire essor de la librairie au XIXe siècle24. Toutefois, l’article 8 de la première d’entre elles, en créant le délit spécifique d' »outrage à la morale publique et religieuse », permet, pour la première fois depuis 1791, qu’une opinion soit sanctionnée au prétexte qu’elle menacerait le fondement moral c’est-à-dire religieux de la société. Au surplus, les magistrats, comme les jurys, conviés à se prononcer sur les cas d’espèce, vont se révéler incapables de distinguer entre les trois dimensions de ce nouveau délit : ce qui relève du religieux en général (la morale « publique », « ce qui est commun à tout homme moral, indépendamment du culte qu’il professe ») ; ce qui relève du religieux pluriconfessionnel défini par la Charte (la « religion d’État » et celles reconnues) ; et enfin, ce qui relève de la religion positive que la plupart d’entre eux pratiquent spontanément, et sur laquelle ils fondent leurs jugements moraux, à savoir le catholicisme romain. Sans se poser la moindre question, ils ne vont sanctionner que les outrages au catholicisme.
III. Un second délit d’opinion religieuse : l’outrage à la religion de l’État
Les lois sur la presse de 1819 ont pu être votées pour trois raisons : d’abord, grâce à l’abaissement du cens électoral, la Chambre des députés a soudain enregistré un afflux de députés du centre ; ensuite, usant de son droit de nomination, Louis XVIII a nommé de nouveaux pairs qu’il a choisis parmi les libéraux, en nombre suffisant pour paralyser les ultras ; enfin, le souverain a insufflé une énergie suffisante à sa volonté de gouverner au centre. Outre leur libéralisme, les lois « de Serre » étaient remarquables par leur ambition d’inclure dans un seul bloc toutes les mesures concernant la presse : les conditions de publication, les délits et leur poursuite. Or les événements ne vont pas tarder à disloquer cet ensemble, et à démontrer aux promoteurs de ces lois, comme au souverain, la fragilité de leur dessein politique : l’affrontement structurel des deux France empêche que le pays soit, de façon durable, gouverné au centre.
Le 13 février 1820, le duc de Berry, neveu du roi, est assassiné devant l’Opéra par un napoléonien radical, l’ouvrier sellier Louvel, qui veut mettre fin à la dynastie des Bourbons : en effet, ni Louis XVIII ni son frère, le comte d’Artois (et futur Charles X), n’ont de fils. L’enquête de police démontrera bientôt qu’il s’agit d’un acte isolé, mais la droite s’empare prestement de l’affaire, et met en accusation la politique de libéralisation de la vie publique : Louvel n’est-il pas un ouvrier qui sait lire, un ouvrier dont la presse libérale aura infecté l’esprit ? Charles Nodier ne craint pas d’affirmer dans le Journal des Débats : » J’ai vu le poignard de Louvel, c’était une idée libérale »25. (En réalité, Louvel a peu lu, et surtout pas la presse libérale.) Huit jours suffisent pour que le président du Conseil, pourtant le favori bien-aimé du roi, soit contraint de démissionner. Le duc de Richelieu – lui aussi un centriste, mais de droite – est rappelé. Il n’accepte le ministère qu’après s’être assuré du soutien du comte d’Artois, depuis toujours opposé à la Charte et à toute politique de conciliation avec les tenants de la Révolution et de l’Empire26. Le nouveau chef du gouvernement réalisera trop tard qu’il a conclu un marché de dupes : si la droite soutient un ministère modéré, c’est juste le temps d’en obtenir le vote des lois qui vont bouleverser le jeu politique. Hercule de Serre, le hardi promoteur des fameuses « lois de Serre », accepte d’être une fois encore garde des Sceaux : depuis peu, la crainte du désordre l’entraîne vers la droite, au moment où ses amis Doctrinaires basculent à gauche.
En mars 1820 sont ainsi votées, dans l’urgence, une loi qui suspend la liberté individuelle en cas de soupçon de complot contre le roi, et une autre qui rétablit l’autorisation préalable de publier et la censure. En juin, une loi dite du « double vote » permet que les électeurs les plus fortunés votent deux fois lors d’une même élection ; aussi, dès l’automne, la Chambre des députés comporte-t-elle plus d’ultras que de libéraux. L’année suivante, le clergé obtient le contrôle de l’Université (les étudiants ayant beaucoup manifesté contre ces lois) et, pour faire bonne mesure, celui des collèges : en quelques mois, l’alliance du Trône et de l’Autel, si caractéristique du XIXe siècle monarchique, se met en place.
Dans cette atmosphère de retour aux valeurs de l’Ancien Régime, les procès intentés au romancier Victor Ducange et au chansonnier Béranger montrent que les magistrats et les jurys interprètent toute critique du catholicisme comme un outrage à la « morale publique et religieuse ». En juin 1821, Ducange est inculpé à ce titre pour Valentine ou le pasteur d’Uzès, un roman qui dénonce les excès de l’aristocratie catholique pendant la Terreur blanche de 1815 dans le Midi. L’arrêt de renvoi note que, tout au long du récit, « l’impiété le dispute à la licence et [… que son] but évident est de traîner en ridicule la religion de l’État, ses cérémonies et ses ministères ; et de décrier le gouvernement du Roi »27 : la « licence » pointe vers l’outrage aux bonnes mœurs, et « l’impiété », vers la « morale publique et religieuse », mais la loi n’est en principe pas chargée de protéger la « religion de l’État ». L’auteur est néanmoins condamné à six mois de prison et cinq cents francs d’amende.
Quatre mois plus tard, c’est au tour de Pierre-Jean de Béranger, le déjà célèbre chansonnier populaire28. Longtemps auteur de chansons à boire, il s’est tourné depuis la fin de l’Empire vers des compositions plus politiques et poétiques. Le patronage de Lucien Bonaparte, protecteur des lettres et des arts, lui a valu une bourse, puis un emploi d’expéditionnaire à l’Université. Depuis la Seconde Restauration, la presse libérale a publié ses chansons engagées, qu’il définit d’ailleurs comme « morales » et non pas politiques : elles tapent dur sur l’Ancien Régime, sur ses aristocrates et sa prêtraille, et célèbrent le peuple héroïque de l’épopée napoléonienne, sa gaieté et sa passion pour la liberté29. À la fin octobre 1821, Firmin-Didot publie deux volumes de ses chansons, dont l’un a déjà été édité en 1815 sans éveiller l’attention de la censure. En quelques jours, les dix mille exemplaires sont épuisés, l’éditeur annonce déjà un nouveau tirage, la nouvelle fait scandale à droite : le poète est immédiatement privé de son emploi administratif et cité en justice.
Or il comparaît le 8 décembre 1821, cinq jours après qu’Hercule de Serre, encore garde des Sceaux, eut déposé sur le bureau de la Chambre des députés un projet de loi sur la répression et la poursuite des délits de presse : contredisant ce qu’il avait âprement défendu quelques mois plus tôt, le ministre propose de développer l’article 8 de sa loi, afin d’y introduire l’outrage à la religion de l’État30. Le projet n’aboutit pas, mais il est révélateur du moment politique : Louis XVIII abandonne à présent la direction des affaires à son frère, le comte d’Artois, dont il a pourtant toujours détesté les idées ; les ultra-royalistes viennent de remporter une victoire électorale supplémentaire et, dans la classe politique comme dans la presse, chacun sait que Richelieu va devoir démissionner, et que la période libérale s’achève.
Devant l’entrée de la cour d’assises de Paris, une foule compacte de curieux et de partisans du chansonnier bloque l’entrée, si bien que l’audience commence en retard31. Dans la salle, un public choisi de deux cents personnes a réussi à se caser : des libéraux de premier plan (le pair Victor de Broglie et son beau-frère Auguste de Staël), des femmes du monde, des avocats et des journalistes. Quatre chefs d’accusation ont motivé le renvoi de l’affaire devant le tribunal : l’outrage aux bonnes mœurs, l’outrage à la morale publique et religieuse, l’offense à la personne du roi, et la provocation au port d’un signe de ralliement prohibé. Bien que certains d’entre eux soient interdépendants, je m’en tiendrai à l’outrage à la morale publique et religieuse, qui vise huit chansons32.
Aucune d’entre elles ne professe l’athéisme, car Béranger est un spiritualiste et il vénère le « Dieu des bonnes gens » (c’est le titre d’une chanson qui ne fait pas l’objet d’une incrimination), miséricordieux envers les petits, et courroucé par les puissants qui se sont emparés de son nom. Par contre, les textes mis en cause célèbrent les plaisirs simples – le vin, la bonne chère, l’amour – et moquent leurs contempteurs. Ainsi, dans « Deo gratias d’un épicurien », un jouisseur ponctue chacun de ses plaisirs par une action de grâces, pratique considérée comme une provocation « en ce siècle d’impiété » où « l’on rit du Benedicite« . Et, puisque l’enfer est peuplé d’épicuriens et de jolies filles, chaque strophe de « La descente aux enfers » se conclut par « Tant qu’on pourra, larirette, On se damnera, larira ». Enfin, dans « Mon curé », un aimable ecclésiastique, buveur et jouisseur, comprend trop bien les faiblesses de ses ouailles, et il redit à sa très jeune nièce, un refrain après l’autre, « Baise-moi, Suzanne, Et ne damnons personne ».
« Le Bon Dieu » exprime la philosophie générale de Béranger : le Créateur, navré par l’état moral de la planète, désavoue en bloc la manière dont son nom est exploité par les prêtres (des « nains tout noirs Dont mon nez craint les encensoirs »), les rois (« ces nains si bien parés, Sur des trônes à clous dorés »), et les généraux (des « pygmées M’appelant le Dieu des armées »), et il conclut chaque refrain : « Je veux, mes enfants, que le diable m’emporte, Je veux bien que le diable m’emporte. » « Les missionnaires » moque la politique cléricale en général : Satan, devenu commerçant en prières, répand sur la planète des missionnaires porteurs de son message : « Par Ravaillac et Jean Chatel (deux régicides, des fanatiques du catholicisme) Plaçons dans chaque prône, Non point le trône sur l’autel, Mais l’autel sur le trône. Que les rois soient nos bedeaux. » Enfin, « Les capucins » et « Les chantres de la paroisse » raillent l’innovation politique du moment, l’alliance du Trône et de l’Autel. Le refrain du premier, « Bénis soient la Vierge et les saints, On rétablit les capucins » fait mine de se réjouir du retour annoncé de l’ordre des capucins, chassés de France depuis la Révolution. Le couplet suivant a particulièrement indigné l’avocat général33 : « L’église est l’asile des cuistres, Mais les rois en sont les piliers ; Et bientôt le banc des ministres Sera le banc des marguilliers ». « Les chantres de la paroisse », sous-titré « le Concordat de 1817, chanson à boire » est une charge contre les négociations sans lendemain entreprises par le gouvernement français pour le retour au Concordat de 1516 : « Gloria tibi, Domine, Que tout chantre boive à plein ventre, Gloria tibi, Domine, Le Concordat nous est donné ».
On le voit, le procureur tient pour nulle et non avenue la subtile explication de l’article 8 que de Serre avait exposée à la Chambre des députés. L’avocat de Béranger ne cesse de rappeler à la Cour qu’en ce 8 décembre 1821, son client n’est passible que de la loi sur l’outrage à la morale publique et religieuse, puisque la nouvelle loi sur l’outrage à la religion d’État n’est pas votée. Or, selon la loi en vigueur,
« La morale religieuse n’est pas […] la morale de telle ou telle secte. Ce n’est pas plus celle de l’Alcoran que celle des rabbins ; celle des catholiques que celle des luthériens, des calvinistes, ou des anglicans… », c’est l’idée universelle de religion, nécessaire à tous les hommes. « Vous vous rappelez qu’on voulait y introduire les mots religion chrétienne, afin de faire un délit spécial des offenses dirigées contre cette religion » et que le rapporteur de la loi avait rejeté cet amendement « comme pouvant rappeler des querelles de religion entre les différentes sectes »34.
Toutefois, rien n’y fait : le procureur maintient que « la morale religieuse n’est autre que la morale enseignée par la religion » (le catholicisme), que l’article 8 combat l’impiété « des esprits contre l’existence d’un Dieu et l’authenticité de son culte » (celui qu’il pratique) ; et qu’enfin, cet article protège « tout ce qui est inviolable et sacré », et notamment les ordres religieux catholiques, y compris ceux qui sont encore interdits en France.
À l’instant où le pouvoir rétablit l’idéologie de l’Ancien Régime, il n’est pas étonnant qu’un magistrat important tienne ce genre de propos. Toutefois, l’avocat général a été suivi par un jury, auquel le législateur de 1819 avait attribué un discernement spécial sous prétexte qu’il serait issu du « peuple » : deux propriétaires électeurs, un écuyer, un marchand de cristaux, un fabricant de porcelaine, deux notaires, un chef de division au ministère de l’Intérieur, etc… condamnent Béranger à trois mois de prison et dix mille francs d’amende – que ses admirateurs se cotiseront pour régler35. Interné à la prison de Sainte-Pélagie, il y occupera la cellule que vient de quitter le pamphlétaire Paul-Louis Courier, lui aussi victime de l’article 8, mais pour outrage à la morale publique, et non à la morale religieuse36.
Dès sa prise de fonctions, Joseph de Villèle, le nouvel homme fort du régime, réalise que la droite, malgré ses constantes victoires électorales, est encore entravée par la presse libérale, « un dissolvant auquel aucun gouvernement ne saurait résister »37. Il entreprend donc de faire voter plusieurs lois sur la presse, qui sont toutes promulguées en mars 1822, et qui comportent, entre autres, un étonnant délit « de tendance », et une loi supplémentaire contre l’outrage à la religion, celle-là même que de Serre avait envisagée l’année précédente38. Au surplus, les délits de presse sont désormais transférés des jurys d’assises aux tribunaux correctionnels puis aux cours royales.
Grâce au « délit de tendance », un journal peut être poursuivi sans qu’aucun de ses articles ne tombe sous le coup d’un délit de presse, au cas « où son esprit résultant d’une succession d’articles serait de nature à porter atteinte à la paix publique, au respect dû à la religion de l’État et aux autres religions légalement reconnues en France, à l’autorité du roi, à la stabilité des institutions constitutionnelles… »39. La cour peut suspendre ce périodique pour un mois, puis, en cas de récidive, pour trois mois, et enfin, l’interdire de façon définitive. C’est, en somme, une systématisation du délit d’opinion sur la politique ou les idées du gouvernement : un retour caractérisé à l’arbitraire judiciaire.
L’exposé des motifs de la nouvelle loi sur le délit d’opinion religieuse reconnaît que la précédente, celle de 1819 sur la « morale publique et religieuse », n’exprimait pas de façon explicite ce que « tout le monde avouait (y) exister ». C’est qu’elle protégeait, en réalité, la religion en général, c’est-à-dire une abstraction assez vague : au contraire, la loi du 25 mars 1822 concerne certaines religions positives en particulier. Elle condamne à une peine de prison de trois mois à cinq ans et d’une amende de trois cent à six mille francs « quiconque […] aura outragé ou tourné en dérision la religion de l’État » ; et elle prévoit « les mêmes peines […] contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l’établissement est légalement reconnu en France ». Puisque la Charte a proclamé le pluralisme confessionnel, la loi ne peut faire autrement que d’étendre la protection des religions aux protestantismes et au judaïsme, mais chacun sait que leurs représentants ne porteront jamais plainte sous ce prétexte. Aussi faut-il comprendre que la sévérité des sanctions vise à décourager les seule attaques contre le catholicisme. Les peines se sont considérablement aggravées en dix mois, puisque l’article 8 de la loi de 1819, qui d’ailleurs reste en vigueur, prévoyait seulement un mois à un an de prison, et une amende de seize à cent francs40. Que s’est-il passé ? Peut-être le législateur aura-t-il enfin compris comment donner à « la société » les moyens de « se défendre elle-même ».
L’assimilation des intérêts de « la société » à ceux du seul catholicisme trouve son aboutissement dans la loi de 1825 sur le sacrilège. Bien qu’elle ne concerne pas un délit de presse, il convient d’en parler ici, car elle consacre la volonté de protéger le catholicisme, qui redevient donc pendant le règne de Charles X, comme au temps de l’Ancien Régime, le principal support de la sacralité de l’État41. Le titre de la loi – « sur la répression des Crimes et délits
commis dans les Édifices ou sur les Objets
consacrés à la Religion catholique
ou aux autres Cultes légalement établis en France » – conserve la fiction d’un État pluriconfessionnel, mais les actes sacrilèges visés – le vol ou la dégradation des hosties ou des vases consacrés dans les églises – concernent exclusivement le catholicisme, car ils reposent sur la doctrine de la transsubstanciation. Les peines encourues sont draconiennes (la mort ou les travaux forcés à perpétuité), et elles renouent avec la cruelle mise en scène autrefois imaginée pour le crime de blasphème. Toutefois, l’appareil judiciaire et les jurys refuseront de suivre, et ils acquitteront les accusés de manière systématique42. En 1830, la Révolution de Juillet abrogera la loi sur le sacrilège sans qu’elle ait été appliquée, ainsi que l’article 6 de la Charte sur le catholicisme, « religion de l’État » : il redevient celle « professée par la majorité des Français ».
IV. Le blasphème contre la famille, la propriété, et l’autorité de l’État
Réaction libérale contre la politique droitiste de la Restauration, la Monarchie de Juillet a tôt fait de liquider les symboles de l’alliance entre le Trône et l’Autel : dès la déposition de l’héritier de la branche aînée des Bourbons, le sacre et l’idée même d’une monarchie absolue garantie par l’Église deviennent des vieilleries, le drapeau tricolore réapparaît, l’aristocratie et le clergé sont contraints d’adopter des comportements plus modestes, les hiérarchies se modifient, et de nouveaux groupes sociaux commencent à peser sur la décision politique. Celle-ci, pourtant, demeure entre les mains du « roi des Français », assisté par une élite censitaire un peu plus large qu’auparavant, mais néanmoins réduite à la notabilité. À l’exception de quelques franc-tireurs, personne n’exige encore le suffrage universel, ni un véritable régime parlementaire, car les dix-huit années de la Monarchie de Juillet constituent une transition où toutes sortes de compromis sont tentés. Ainsi, bien que le souverain se révèle particulièrement enclin à dissoudre la Chambre des députés dès qu’elle lui résiste, elle n’en devient pas moins le cœur battant de la vie politique, appuyée sur une presse libre, nombreuse, et qui commence à rencontrer un lectorat populaire.
Néanmoins, l’attentat manqué de Giuseppe Fieschi contre Louis-Philippe, en 1835 entraîne un durcissement des lois sur la presse. Et, bien que l’Église et l’État ne soient plus dans la même familiarité qu’au temps de la Restauration, les magistrats redécouvrent la loi de 1819 et son article 8, que le nouveau régime n’avait pas pensé à abroger. La conception de la « morale publique et religieuse » revêt alors une interprétation plus conforme à l’orientation bourgeoise du nouveau régime : la famille, fondement d’un ordre social inégalitaire qui entend se maintenir, devient un composant essentiel de la religion. Par exemple, le 10 mars 1842, Auguste Luchet, un auteur de romans sociaux, comparaît avec son éditeur sur le fondement de l’article 8. Le Nom de famille rapporte les mésaventures d’un bâtard, engendré par une marquise qui l’a conçu avec le fils d’un homme qu’elle avait fait guillotiner pendant la Révolution : cette naissance mélodramatique a fait de l’enfant illégitime la proie d’une passion homicide envers tout ce qui ressemble à un père. Le roman ne paraît ni très convaincant ni promis à un grand succès, mais le procureur se sent tenu de le poursuivre. Non pas, précise-t-il, pour des raisons politiques, mais au nom « des règles éternelles de la morale publique, les préceptes essentiels de la religion, ce lien sacré entre l’homme et la divinité, les principes conservateurs de la famille, qui unissent les hommes entre eux »43.
Toutefois, c’est surtout après l’échec de la Révolution de 1848 et le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte – la presse est alors frappée, une fois de plus, par une législation draconienne – que l’outrage à la « morale publique et religieuse » devient un chef d’inculpation favori : il justifie environ la moitié des procès de presse au Second Empire, au lieu d’un dixième sous la Monarchie de Juillet. Ce fait empirique – en soi, de médiocre importance – requiert, pour être compris, le recours à des considérations plus générales.
On sait en effet que la Deuxième République, de 1848 à 1852, a révélé à la France conservatrice l’innocuité politique du suffrage universel : d’une part, les trois quarts de la population sont des ruraux que leurs curés encadrent encore assez solidement (c’est pourquoi un chef d’État comme Louis-Napoléon Bonaparte, malgré son désintérêt pour la pratique religieuse, leur confie la surveillance des écoles communales et favorise avec opiniâtreté l’essor de l’enseignement catholique) ; d’autre part, en raison du Concordat, tout le personnel clérical, de l’évêque au curé, est à la merci du gouvernement44. Aussi, même après la fin des Bourbons, après celle des Orléans, et le retour des Bonaparte sur un coup d’État, l’autorité publique trouve-t-elle encore un immense avantage à coopérer avec une Église dont les institutions irriguent opportunément la société, et qui génère, au moindre coût politique, des sujets obéissants.
Concernant la vigueur nouvelle des accusations d’outrage à la « morale publique et religieuse », les cas de Gustave Flaubert pour Madame Bovary, et Charles Baudelaire pour Les Fleurs du Mal, inculpés en 1857 par le procureur Pinard avec leurs éditeurs et imprimeurs, sont trop connus pour qu’il soit nécessaire de s’appesantir. Tout a été dit sur l’obstination du magistrat à attribuer aux auteurs la responsabilité morale des actions, des pensées et des sentiments de leurs personnages, et, d’une façon plus générale, à refuser de percevoir ce qu’est le travail littéraire. L’important pour notre propos est qu’en 1857, la « morale publique » – fondée, comme toujours, sur la volonté divine – interdit aux écrivains de défaire le lien qui souderait les trois valeurs sacrées, le Vrai, le Beau, le Bien : l’amoralisme littéraire devient un délit passible de sanctions pénales. Cela n’empêche pas le procureur impérial d’incriminer séparément, comme un outrage à la « morale religieuse », tous les passages dans lesquels un quelconque élément du culte catholique est associé à de la volupté, et de ressusciter ainsi, inchangé mais érigé en délit, l’ancien péché religieux de blasphème. Flaubert est finalement relaxé par le tribunal avec un blâme, sans doute parce qu’il a réussi à faire jouer ses relations mondaines ; et Baudelaire, moins favorisé, est condamné à une amende et à la suppression de six poèmes de son recueil.
Au cours du Second Empire, régime singulièrement autoritaire, d’autres écrivains sont condamnés sur le même fondement à des peines autrement plus lourdes. Ainsi, toujours en 1857 et à l’instigation du procureur Pinard, les éditeurs et l’imprimeur d’Eugène Sue. L’auteur n’y échappe que parce qu’il décède au cours de l’instruction. C’est un feuilletoniste immensément célèbre – tous les Français connaissent Les Mystères de Paris ou Le Juif errant -, qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice. Pour exorciser le désespoir où l’avait plongé le détournement de la Révolution de 1848 par le rejeton des Bonaparte, il a commencé à publier dès après, sans être poursuivi, Les Mystères du Peuple, « l’épopée d’une famille de prolétaires à travers les âges ». Au moment où sort le seizième et dernier volume, le procureur Pinard, furieux de n’avoir pas réussi à faire condamner Flaubert, s’en prend à Eugène Sue. Le roman et les responsables de sa diffusion sont condamnés pour six délits : outrage à la « morale publique » et aux « bonnes mœurs », outrage à la « religion catholique », excitation à « la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres », apologie de « faits qualifiés de crimes par la loi pénale », attaques contre « le principe de la propriété », et enfin, « excitation à la haine et au mépris du gouvernement établi par la Constitution ». Les exemplaires et les clichés sont détruits, les éditeurs et imprimeurs sont emprisonnés et condamnés à des amendes exorbitantes.
Or le procureur Pinard n’est pas le seul magistrat du Second Empire qui assigne des auteurs au nom de la « morale publique et religieuse ». En 1858, par exemple, Proudhon (déjà familier des tribunaux) est poursuivi pour un essai anti-religieux, De la justice dans la Révolution et dans l’Église. Le tribunal correctionnel de la Seine le condamne à trois ans de prison au motif que ses propos ont pour « résultat de froisser de la façon la plus douloureuse les croyances religieuses dont la loi commande le respect »45. Même pendant la période dite libérale du Second Empire, les procès ne cessent pas. En 1869, Alfred Naquet, alors un socialiste radical proche de Bakounine, est condamné à quatre mois de prison et cinq cents francs d’amende pour outrage à la « morale publique et religieuse » et pour attaque contre la famille et la propriété : Religion, propriété, famille ne s’en prend pourtant qu’au mariage et à sa sanctification religieuse. (Devenu sénateur de la Troisième République, il rétablira le divorce en 1884).
V. La fin du délit d’opinion religieuse
Le 2 septembre 1870, la défaite militaire devant l’Allemagne et la capture de Napoléon III à Sedan mettent fin au Second Empire sans que la classe politique ait pu le prévoir. Quand, deux jours plus tard, Gambetta proclame la République depuis le balcon de l’Hôtel de ville de Paris, le pays est loin d’en avoir adopté l’idée. La France ne s’interroge alors que sur la poursuite ou non de la guerre : rassurée, en février 1871, par la politique de paix que proposent les monarchistes, elle élit une Assemblée massivement royaliste qui approuve l’armistice. Les problèmes sérieux sont abordés après l’écrasement de la Commune de Paris : pendant plusieurs années, les monarchistes se montrent incapables d’arbitrer entre leurs deux dynasties, Bourbon et Orléans, alors que le camp républicain se transforme en profondeur. Il s’adjoint quelques conservateurs éminents issus du bonapartisme (Thiers, le massacreur de la Commune), et certains de ses leaders radicaux se convertissent à la modération (Gambetta). Au surplus, de nombreux militants entreprennent de sillonner la province pour y propager la bonne parole : en quelques années, ils remportent une adhésion suffisante pour faire élire une Assemblée républicaine et modérée, c’est-à-dire conservatrice. La dernière hypothèque sur le régime républicain est levée le 30 janvier 1879 par la démission du président Mac Mahon, un légitimiste qui n’aura su ni rétablir la monarchie, ni gouverner contre la volonté des Assemblées. L’échec de sa politique d’Ordre moral, violemment anti-républicaine et cléricale, signifie surtout que la France est enfin capable d’une démocratie parlementaire, neuf ans après avoir proclamé la République.
En 1881, trois républicains modérés occupent la présidence de la République (Jules Grévy), celle du Conseil des ministres (Jules Ferry), et celle de la Chambre (Léon Gambetta) : le pouvoir de ces « opportunistes » – selon le sobriquet de leurs concurrents plus radicaux – repose sur une alliance provisoire entre les deux partis situés au centre gauche de l’Assemblée46. Ils se distinguent surtout des courants les plus radicaux par le rythme des réformes qu’ils envisagent : en particulier, ils repoussent d’emblée la fin du Concordat et la séparation des Églises et de l’État, deux exigences traditionnelles du mouvement47. Par contre, de 1881 à 1885, ils entreprennent, avec une entière détermination, de faire voter plusieurs lois destinées à républicaniser la société. Celle sur la presse, du 29 juillet 1881, qui nous intéresse ici, doit être comprise comme un élément de cette politique, au même titre que les autres lois qui organisent les grandes libertés et l’École laïque.
Son article 1er, d’une brièveté stupéfiante – « L’imprimerie et la librairie sont libres » -, efface quatre-vingt-dix années de tutelle de la presse : plus de déclaration de l’imprimeur, plus de contraintes autres pour le colporteur que d’avoir un catalogue, plus d’autorisation préalable, plus de censure, plus de signature obligatoire, plus de timbre, plus de cautionnement pour les journaux48. Eugène Lisbonne, rapporteur de la loi devant la Chambre des députés, souligne que sa grande, son unique nouveauté consiste en ce que, désormais, la liberté de la presse n’est plus limitée que par la sanction a posteriori d’actes délictueux relevant du droit commun49 :
« Nous avons affirmé que le projet ne range dans cette catégorie la manifestation d’aucune opinion, quelle qu’elle soit. Nous avons dit : plus de délit d’opinion, de doctrine, de tendance »50.
De nombreuses incriminations disparaissent ainsi de la législation sur la presse, que nous avons pu voir infligées au cours des décennies antérieures : provocation à la désobéissance aux lois ; attaques contre le principe de la propriété, contre les droits de la famille, contre la Constitution ; excitation à la haine et au mépris du gouvernement, ou des citoyens les uns contre les autres51, et, bien sûr, les deux outrages à la « morale publique et religieuse », ainsi qu’aux « religions reconnues par l’État ». Eugène Lisbonne commente ainsi leur abrogation :
« Tout a été dit, et merveilleusement dit sur ces deux prétendues infractions qui existent encore dans nos lois spéciales. Délits d’opinion s’il en fût, délits insaisissables au point de vue de l’intention, délits stériles au niveau de l’effet qu’ils peuvent produire »52.
Selon Lisbonne, en effet, depuis les avocats des accusés célèbres (Béranger et Paul-Louis Courier) jusqu’à l’ultime garde des Sceaux du Second Empire, trop de juristes ont souligné l’insupportable imprécision de ces délits :
« Il suffit que tel ou tel délit soit vague pour qu’il soit aboli. Nous ne conservons que les délits qui ont un caractère défini, une précision suffisante, ceux qu’incrimine, d’accord avec le droit commun, la conscience universelle. (…) Il n’y a pas de juge possible pour les délits qui résistent à la définition. C’est ce qu’a pensé votre commission. La réforme absolue que nous vous proposons ne pouvait pas s’adapter à l’Empire, quelque libéral qu’il prétendît être devenu. Elle s’adapte à la République »53.
Les temps ont manifestement changé : le retrait des deux délits soulève fort peu d’objections. À la Chambre des députés, l’opposant le plus vigoureux est Charles Freppel, évêque d’Angers, un monarchiste dont l’éloquence est d’ordinaire redoutée. Ce jour-là, il ne trouve que des paroles convenues, trop souvent ressassées : la fin de ces infractions constituerait « une véritable abomination », la Chambre aurait-elle programmé de « sacrifier Dieu » – « tout ce qu’il y a de plus sacré dans le monde » -, ce que, précisément, la loi a mission de protéger ? À l’extrême-gauche, Georges Clémenceau répète le mot de Montesquieu : « Dieu se défendra bien lui-même ! », puis, citant Jules Simon, il réclame « sans ambages, le droit d’outrager une religion »54. Au Sénat, c’est encore un monarchiste qui s’y oppose, Henri de Gavardie, dont la niaiserie provoque souvent l’hilarité de la Chambre. Ces délits doivent être maintenus parce qu’il serait affligeant « de voir qu’une société qui doit toute sa grandeur au christianisme s’efforce de chasser Dieu des institutions ». Devant les commentaires goguenards (« Allons donc ! »), il se rabat sur l’idée qu’ils protègent les fondements même de la « morale universelle ». Les exclamations de la gauche le mettent en rage :
« Vous contestez cela ? Qui le conteste ? Je voudrais bien savoir qui pourrait contester ici, comme vérités devant être sanctionnées par la loi, l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme, et la nécessité d’un culte d’une façon générale ? Personne ne peut contester cela »55.
Un sénateur fait savoir que, justement, il le conteste : « Ah, réplique de Gavardie, vous êtes bien le seul ! » Deux, puis trois autres se signalent alors, et lui conseillent de proposer plutôt un amendement. Il demande le maintien de l’outrage à la « morale religieuse », sans faire référence à la « morale publique » : l’amendement est rejeté dans la gaieté générale, et de la sorte, les deux délits contre la religion sortent de la législation française après avoir protégé l’État pendant une soixantaine d’années.
Lors des débats parlementaires, l’inconsistance des objections cléricales est le fait le plus nouveau, ainsi que le plus stupéfiant : les locuteurs réalisent au moment même où ils parlent qu’ils ont cessé d’être crédibles, alors qu’ils l’étaient encore quelques mois plus tôt, au temps de l’Ordre moral. L’arrangement politico-religieux qui a rendu possible, durant tant de siècles, la criminalisation du blasphème, est soudain périmé, et il l’est une fois pour toutes. Car le jeune régime républicain, alors même qu’il est politiquement incapable de mettre fin au Concordat ou de proclamer la séparation des Églises et de l’État, s’est déjà engagé – et avec quelle énergie, si l’on considère l’œuvre scolaire de ces années-là – dans la voie de la laïcité. Le régime de laïcité proprement dit ne sera véritablement établi qu’en 1905, mais, dès 1881, il est désormais impossible, de poursuivre un écrit au seul prétexte qu’il porterait atteinte à la religion.
En 1819, Hercule de Serre avait prétendu abolir pour toujours les délits d’opinion, sans voir que son anthropologie limitait de deux manières l’ordre de l’opinable. D’une part, l’opinion était assujettie à des vérités indiscutables, prétendument proférées par Dieu, créateur et législateur suprême du monde. D’autre part, la créature était scindée en deux paquets de facultés désaccordées : d’un côté, la raison, vouée à un travail, lent et serein, la construction critique de vérités provisoires ; de l’autre, le chaos de l’irréflexion, fait d’opinions injustifiées, d’émotions, de passions, et d’actions irraisonnées – parmi lesquels des actes de parole injurieux. Aussi, les lois de Serre ont-elles autorisé en principe la critique des religions particulières, comme de toute opinion, à condition qu’elle s’inscrive dans une conception théiste du monde, et qu’elle s’énonce sur un ton modéré56.
À son tour, la loi sur la presse de 1881 a voulu abolir les délits d’opinion légués par les monarchies autoritaires du XIXe siècle, le législateur étant, cette fois, laïque, républicain et positiviste. La nouvelle loi a donc refusé de sanctionner aucune opinion – qu’elle porte sur Dieu, la propriété, la famille, l’État ou sur tout autre sujet -, ni aucun sentiment – qu’il concerne les institutions ou les personnes. Elle n’a reconnu comme délits que certains actes préalablement spécifiés par le Code pénal, ainsi que trois autres, spécifiques à la presse : les offenses aux autorités publiques, l’injure et la diffamation envers le particuliers. Dans sa pratique, la jeune République s’est vite révélée incapable de laisser libres les opinions relatives à l’autorité publique et aux mœurs, mais elle a sans conteste aboli le délit d’opinion religieuse.
Nul n’aurait pu imaginer le spectaculaire retournement de situation que nous vivons depuis le début des années 1980. Exploitant les virtualités ouvertes par une loi de 1972 contre le racisme, des associations dévotes issues de l’extrême-droite catholique – bientôt rejointes par une association ad hoc de l’Episcopat – obtiennent des condamnations pour « injure au sentiment religieux », « diffamation religieuse », ou « provocation à la discrimination, à la violence et à la haine religieuse ». Des juristes, parfois réputés, invoquent désormais un « droit au respect des croyances », élevé à la dignité d’un « droit fondamental de la personnalité », et, tant qu’à faire, d’une « norme constitutionnelle d’égale valeur à celle de la liberté d’expression ». Un siècle après sa disparition, le délit d’opinion religieuse a donc fait sa réapparition dans nos prétoires, sinon dans nos lois. Il diffère de l’ancien délit de blasphème en ce qu’il ne sanctionne plus les offenses à Dieu mais celles à la sensibilité de ses fidèles : car si l’on parle encore de « blasphème », ce n’est plus dans les prétoires, où le terme n’a pas cours, mais dans le débat public ou entre dévots.
Cette volte-face n’était pas prévisible pour une raison simple : l’incrimination du nouveau délit, qui se fonde sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a été inaugurée par deux activistes qui la vomissaient, ainsi que toutes les idées responsables de la chute de la monarchie. En 1984, Mgr Lefebvre, un prélat intégriste qui s’était distingué au concile Vatican II par son refus de voter la liberté de conscience, et qui avait fondé une Association Saint-Pie X pour la restauration du catholicisme authentique, assigne en justice l’affiche du film Ave Maria : l’image d’une jeune fille appétissante, les seins nus et attachée à une croix, constituerait un « outrage aux sentiments des catholiques ». Le président du Tribunal d’instance de Paris lui donne raison, et l’affiche est immédiatement retirée. Bernard Antony, directeur d’un journal traditionaliste et député européen du Front National, n’a pu se joindre au procès parce qu’il vient à peine de fonder l’association qui lui ouvrirait le droit de se porter partie civile. Mais dès 1985, son Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l’Identité Française et chrétienne (AGRIF), assigne Jean-Luc Godard, réalisateur de Je vous salue, Marie et son producteur pour « diffamation raciste envers les catholiques ». L’AGRIF perd son procès, mais elle inaugure brillamment une politique d’occupation perpétuelle des tribunaux, à seule fin de défendre les « sensibilités catholiques » contre toute production susceptible de les « blesser ».
Il aura donc fallu douze ans à ces deux réactionnaires pour qu’ils acceptent de troquer l’habit du bourreau contre celui de la victime, et le discours intransigeant de la vérité contre celui, larmoyant, de la tolérance. Car la loi Pleven, modificatrice en 1972 de la loi sur la presse de 1881, n’avait voulu que conformer la législation française avec les conventions internationales en matière de lutte contre le racisme et la discrimination57 : si longtemps après la fin de la Deuxième guerre mondiale et dix ans après la fin de la guerre d’Algérie, la France se résolvait enfin, comme tous les États démocratiques, à reconnaître un droit à la non-discrimination aux groupes qui avaient expérimenté l’esclavage, la colonisation, et le racisme. L’enjeu politique était d’ailleurs si dérisoire que la loi fut votée à l’unanimité. Trois dispositions de cette loi vont permettre la réapparition d’un délit d’opinion religieuse.
D’abord, le comportement délictueux (discriminatoire, diffamatoire ou injurieux) peut viser non seulement l’appartenance ethnique, nationale, ou « raciale », mais aussi la religion des personnes. Certes, il n’y a délit que si les adeptes d’une certaine religion sont mis en cause en tant que personnes ; et certes, il n’est pas question d’abolir la liberté d’expression et la liberté de conscience, qui autorisent depuis longtemps la contestation des idées, des symboles et des pratiques religieuses. Toutefois, les magistrats se révéleront rapidement incapables de distinguer entre les fidèles (qu’ils dotent d’une « sensibilité » devant être protégée) et leur religion : ainsi, par exemple, quand sont en cause une déclaration pontificale (qu’il s’agisse de l’antisémitisme chrétien ou du préservatif), ou un épisode fâcheux de l’histoire de l’Église.
Ensuite, la loi de 1972 considère que ces comportements sont discriminatoires, diffamatoires ou injurieux quand ils visent non seulement un individu, mais des « groupes de personnes », sans préciser ce qui délimite ces groupes58 : la Convention européenne des droits de l’homme elle-même – encline depuis peu à protéger les « sensibilités religieuses » – a veillé à n’évoquer dans son traité que des individus. Dans la nouvelle loi française, au contraire, il est difficile de désigner avec certitude la cible (individuelle ou collective) que le prévenu est supposé viser : « tous les baptisés de l’Église catholique » (y compris les « progressistes » et ceux qui sont détachés de la pratique) ? les pratiquants ordinaires ? ou un très petit nombre d’entre les fidèles, les dévots qui se disent blessés dans leurs convictions ? Au surplus, quand cette critique s’exprime dans une affiche, le magistrat peut-il la condamner du seul fait qu’elle est placardée dans les rues, c’est-à-dire imposée à tous (celle, par exemple, de Amen, le film de Costa-Gavras) ? Et dans ce cas, veut-on dire que cette imposition constitue une « offense à la liberté religieuse », et donc que la critique des religions doit être exclue des lieux publics ? (La loi sur la presse de 1881 protège en effet, la liberté des affiches et des images exactement au même titre que celle des articles de presse ou des livres).
Enfin, le législateur de 1972 offre à des associations qui auront inscrit dans leurs statuts la lutte contre le racisme le droit de se substituer au ministère public et de se porter partie civile. Or les magistrats auront tendance à considérer les associations confessionnelles comme représentatives de la « sensibilité blessée » des « groupes de personnes » protégés par la loi. L’on peut tout de même se demander si le scandale ressenti par l’Association Saint-Pie X – et même par l’Episcopat – est celui d’un groupe particulier de fidèles ou de tous les « groupes de personnes » catholiques ? Le croisement de ces deux dispositions (l’atteinte à des « groupes de personnes » et le statut des associations admises à agir en justice) contribue évidemment à communautariser la défense des religions.
Les magistrats français n’étaient nullement préparés à faire face à une inflation de procès en défense de la religion, surtout dans le cadre d’une loi antiraciste. Pendant une vingtaine d’années, ils prononcèrent les verdicts qu’ils purent : tantôt favorables à la liberté d’expression, bien qu’avec une motivation souvent fautive, tantôt privilégiant le « droit au respect des croyances », avec une argumentation non moins fragile. En 2002, l’arrivée dans les prétoires des associations musulmanes – pour une déclaration de Michel Houellebecq sur l’islam -, ont prestement remis les pendules à l’heure : s’il faut reconnaître un statut égal à toutes les demandes religieuses, la magistrature française préfère se résoudre à la laïcité. Le jugement rendu en 2007 au procès intenté à Charlie Hebdo pour avoir publié des caricatures du Prophète Mahomet marque, on l’espère, la fin du chaos judiciaire – sinon des procès en défense de la religion.
Références
- Béranger (1828), Chansons nouvelles et dernières, t. 3, Paris, H. Fournier aîné.
- Démier, Francis (2012), La France de la Restauration (1814-1830), Paris, Gallimard.
- Démier (2014), La France du XIXe siècle, 1814-1914, Le Seuil.
- Desmons, Eric et Paveau, Marie-Anne (2008), Outrages, insultes, blasphèmes et injures : violences du langage et polices du discours, Paris, L’Harmattan.
- Droin, Nathalie (2011), Les limitations à la liberté d’expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Disparitions, permanence et résurgence du délit d’opinion, Paris, L. G. D. J.
- Kintzler Catherine (2014), Penser la laïcité, Paris, Minerve.
- Leveleux, Corinne (2001), La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIIIe-XVIe siècles) : du péché au crime, Paris, De Boccard.
- Legicom (n° 55, 2015/2), « Liberté d’expression et religion ».
- Saint-Victor, Jacques de (2016), Blasphème, Brève histoire d’un « crime imaginaire », Paris, Gallimard.
- Sapiro, Gisèle (2011), La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe siècle-XXIe siècle), Paris, Seuil.
- Waresquiel, de, Emmanuel, et Yvert, Benoît (2002), Histoire de la Restauration, 1814-1830, Paris, Perrin.
- Waresquiel, de, Emmanuel (2015), C’est la Révolution qui continue ! La Restauration, 1814-1830, Paris, Tallandier.
Notes