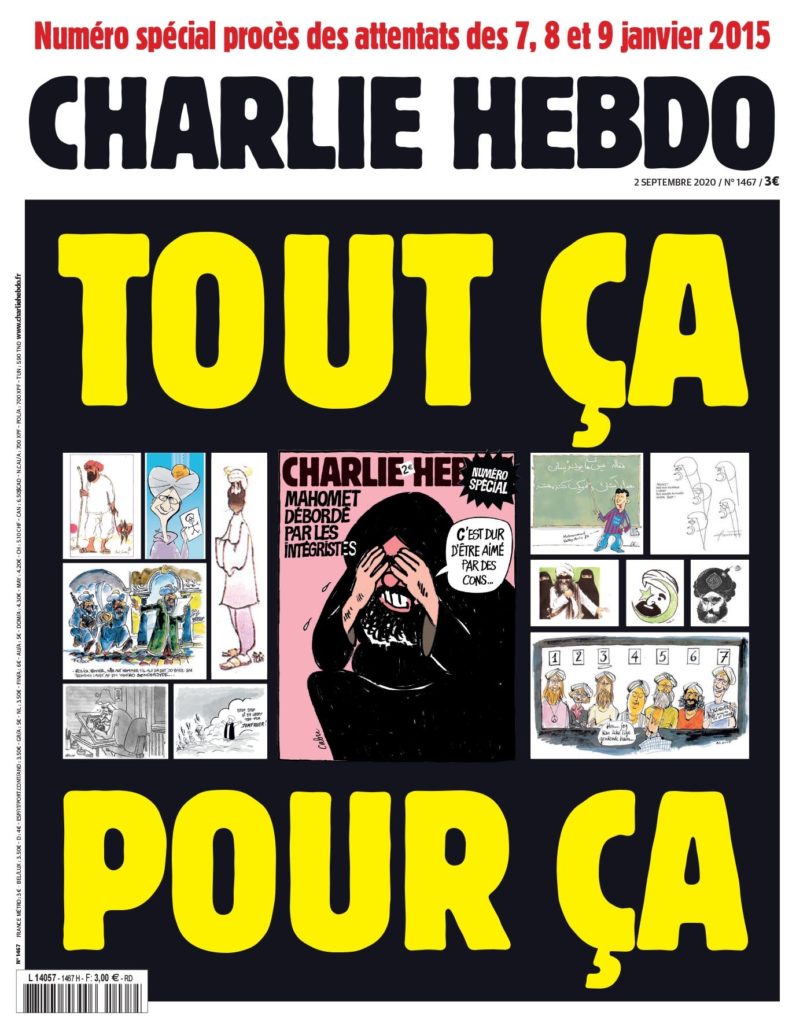La date de reprise éventuelle des rassemblements cultuels, fixée initialement au 11 juin puis ramenée au 2 juin, a soulevé les protestations de l’Église catholique, au point que le Premier ministre a évoqué, dans une de ses récentes déclarations, la possibilité de l’avancer au 29 mai1. On remarque depuis quelques jours une multiplication de déclarations mi-plaintives mi-indignées de la part de responsables catholiques2 (soutenus par des responsables politiques) qui semblent décidés à revendiquer un statut d’exception, prétendument « vital », sinon pour leur religion, du moins pour les religions en général. En quoi ils sont surclassés par l’outrance offensive d’un appel catholique international qui, pour revendiquer une liberté exclusive, n’hésite pas à recourir au complotisme3.
Les religions sont-elles d’intérêt public ?
Qualifier les rassemblements religieux de « nécessité vitale », c’est, sur un plan général, méconnaître (ou feindre de méconnaître) le minimalisme républicain laïque en matière de non-reconnaissance des cultes.
Dans un récent article4, Henri Pena-Ruiz rappelle que les religions n’ont pas le monopole de ce qu’on appelle (un peu trop restrictivement à mes yeux) « la spiritualité » et que l’exercice de celle-ci n’a pas à être apprécié (et encore moins hiérarchisé) par la puissance publique. Mais parler de « nécessité vitale », c’est, au-delà même du contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire que nous aborderons plus loin, supposer que les religions pourraient relever d’une forme d’intérêt public. Cet intérêt demanderait plus que la jouissance ordinaire de la liberté (comme c’est le cas pour la liberté de culte) : une reconnaissance et donc un soutien positif de la part du pouvoir civil. Le raisonnement a été maintes fois utilisé pour réclamer un financement public des cultes.
Il arrive que l’autorité publique soutienne des activités particulières telles que des associations culturelles ou sportives, par exemple en les subventionnant. Naguère, un commentateur me faisait remarquer qu’on subventionne des stades et des clubs de rugby, alors que nombreux sont les citoyens et contribuables qui ne s’intéressent pas à ce sport ou même qui lui sont hostiles : alors pourquoi ne pas reconnaître et soutenir les religions ?
Tentons d’éclaircir la question en faisant varier les exemples en ordre décroissant.
Il est de l’intérêt de tous que la loi existe, qu’elle soit la même partout et appliquée de la même manière. Il est de l’intérêt de tous que la force publique soit la seule habilitée aux tâches de maintien de l’ordre. Il est de l’intérêt de tous que chacun ait une retraite et une couverture sociale décentes. Il est de l’intérêt de tous que la maternité soit protégée (et pourtant seules les femmes accouchent…). Il est de l’intérêt de tous qu’on étudie à l’école des disciplines que tous n’étudieront pourtant pas. Il est de l’intérêt de tous que la recherche fondamentale (« qui ne sert à rien » dans l’immédiat) soit promue et encouragée. On voit bien, sur cette première série d’exemples, que le mot « tous » ne désigne pas (dans l’expression que j’ai employée : « intérêt de tous ») un ensemble empirique, mais un universel. Même si je sais que je n’apprendrai jamais l’astrophysique, il est de mon intérêt de citoyen en général que cette discipline soit développée.
Poursuivons la série en la compliquant. Il est de l’intérêt de tous que la culture soit soutenue et développée. Par exemple il y a des théâtres, des orchestres entièrement subventionnés. Il y a aussi et ensuite des zones intermédiaires, que la puissance publique encourage mais qu’elle ne prend pas entièrement à sa charge : on peut prendre l’exemple de certains musées, de certains théâtres – et généralement des établissements à financement mixte. L’exemple des installations sportives peut prendre place ici et montre que le soutien public peut s’investir dans des domaines qui n’allaient pas de soi autrefois ; la question n’est jamais définitivement close et c’est le rôle des assemblées d’en décider. Amateur de rugby, je trouve qu’il est acceptable et normal de soutenir d’autres sports. Oui, mais alors on insistera : pourquoi, sur cette voie, ne pas soutenir des associations cultuelles ?
Cultuel et culturel
L’exemple de la rénovation d’une cathédrale mobilisant des moyens puisés dans les impôts des contribuables nous amènera au plus près du point litigieux. Il illustre la distinction entre le culturel et le cultuel. Une cathédrale est rénovée grâce à mes impôts : mais ce n’est pas pour y prier que le bâtiment est ainsi rénové. Il se trouve qu’on y prie aussi (il est mis à la disposition d’un culte), mais, et cela en vertu de la loi de 1905 dite « de séparation », c’est un monument public. Le caractère religieux de l’édifice n’est pas aboli pour autant, mais il est ici traité sous son aspect culturel qui s’adresse à tous : on ne m’impose aucun acte de foi en rénovant des statues ou des vitraux, on ne s’introduit pas dans ma conscience. On me fait savoir que la puissance publique s’intéresse à sauvegarder un monument faisant partie du patrimoine commun5.
Voilà une des raisons pour lesquelles aucune religion en tant que telle, c’est-à-dire en tant que système de croyance (ni aucun ensemble de religions), ne peut entrer dans le domaine de l’utilité publique, ni même dans celui des choses culturelles que la puissance publique peut soutenir. Car soutenir un culte c’est soutenir une croyance, et l’État ne doit ni imposer ni accréditer aucune croyance. Soutenir l’athéisme serait du même ordre : ce serait financer l’imposition d’une incroyance. En revanche l’étude des religions fait partie du domaine culturel, et entre dans le champ des sciences humaines, lequel est produit et enseigné dans des établissements payés ou soutenus par la puissance publique.
Toute religion est par nature exclusive
Un autre angle permettra de préciser le sujet. Qui est bénéficiaire des décisions publiques ? Tous ! Alors là, laissez-moi rire, m’objectera-t-on : il y a bien des postes publics réservés à ceux qui ont tel ou tel diplôme, postes pourvus sur titres ou sur concours ? C’est exact, mais personne a priori n’est exclu en vertu de ce qu’il est ou de ce qu’il croit. L’accès est a priori et en droit ouvert, quelle que soit l’origine, la croyance, etc. On n’est pas admis (ou refusé) à un concours de la fonction publique parce qu’on croit à la résurrection des corps mais parce qu’on satisfait (ou non) à des conditions techniques ou scientifiques que tous peuvent viser et remplir en droit.
Et le stade de rugby ? Tous n’y vont pas, mais tous peuvent y aller en droit. On ne fait pas le tri entre les spectateurs sur des critères a priori comme leur appartenance, leur lieu de naissance, leur couleur, leur croyance. Quand on rénove les vitraux d’une cathédrale avec une partie de l’argent public, la jouissance de cette rénovation est proposée et accessible à tous. Lorsque j’entre dans la cathédrale de Rouen, personne ne s’inquiète de savoir si je me signe, personne n’exige de ma part un acte d’appartenance.
On voit à nouveau et sous cet angle pourquoi les religions ne peuvent entrer dans cette sphère accessible en droit à tous : c’est que par définition elles sont réservées à ceux qui les embrassent. Une religion exclut a priori tous ceux qui n’y adhèrent pas ; et quand elle les accepte c’est en vue de les convertir. Le « nous » des croyants est communautaire : sa capacité d’exclusion est corrélative de sa capacité d’inclusion. Une grande idée du catholicisme, comme son nom l’indique, est de prétendre à l’universalité, mais cette universalité ne peut s’effectuer qu’en excluant la liberté de ne pas croire ou de croire autre chose.
L’inclusion dans l’association civile ne s’accompagne pas d’une telle injonction : l’association civile, quand elle est laïque, est indifférente aux appartenances. C’est ainsi que raisonnent (ou devraient raisonner) les élus lorsqu’ils s’interrogent sur l’opportunité de voter une subvention : ne pas seulement se demander si telle association est utile, mais se demander aussi si sa nature exclut a priori une partie des administrés en fonction de ce qu’ils sont, de ce qu’ils croient. Des critères d’admissibilité peuvent être décidés, mais ils ne peuvent discriminer les bénéficiaires en fonction de leurs appartenances. On aura donc des motifs valables pour soutenir telle association de charité notoirement gérée par une confession religieuse, à condition qu’elle ne réserve pas ses secours aux seuls fidèles de cette religion et qu’elle ne se livre pas au prosélytisme dans ce cadre. Mais on ne pourra pas subventionner ou reconnaître par tout autre moyen un culte en tant que tel, qui ne peut pas, par sa nature, satisfaire à cette condition.
Et pour la même raison, on ne peut pas non plus soustraire un ou des cultes à la règle commune qui s’exerce au nom de tous et dans l’intérêt de tous.
L’état d’urgence sanitaire actuel s’en prend-il plus aux rassemblements cultuels qu’à d’autres ?
Ce qui vient d’être dit est un cadre général, qui vaut dans une situation ordinaire. Or nous sommes dans une situation extra-ordinaire, une situation d’urgence qui appelle des mesures particulières – une loi d’urgence sanitaire restreignant notamment certaines libertés. On peut certes critiquer ces restrictions, s’interroger sur leur bien-fondé juridique, en demander la levée ou l’assouplissement, mais cette critique doit-elle prendre la forme d’une revendication d’exception ? Or c’est dans ce cadre que les plaintes des responsables religieux interviennent : à les entendre, les cultes seraient particulièrement maltraités par la décision d’interdiction des rassemblements et il faudrait faire exception pour eux en les exemptant de cette interdiction.
Dans le contexte particulier actuel et temporaire de l’état d’urgence sanitaire, peut-on soutenir que les cultes sont privés de liberté plus que ne le sont d’autres activités de type culturel ? Rappelons que l’application de l’état d’urgence sanitaire n’interdit pas les cultes, mais les rassemblements tels que représentations théâtrales, festivals, cinémas, réunions, cérémonies collectives… « On ouvre les écoles et les bibliothèques mais on interdit les réunions religieuses !» : tel est le raisonnement appuyant la revendication d’ouverture de ces réunions. Oui, mais les écoles et les bibliothèques sont d’intérêt public au sens où nous l’avons exposé, et les dispositions particulières actuelles leur imposent d’éviter la forme du rassemblement.
Faisons, encore une fois, varier la proposition.
« On ouvre les écoles et les bibliothèques mais les réunions maçonniques ne peuvent pas non plus avoir lieu ! » : le dispositif frappe d’autres formes de « vie spirituelle » que les rassemblements cultuels. À ma connaissance, aucune obédience maçonnique n’est venue déposer sa larme victimaire et revendicative à l’Élysée ou à Matignon. Il est vrai que, pour beaucoup des responsables religieux revendicatifs, l’activité maçonnique, hum, ce n’est pas vraiment une nourriture spirituelle « vitale »…
« On ouvre les écoles, mais on interdit les représentations théâtrales, les concerts, les conférences, etc. » : oui, et c’est pour la même raison qu’on interdit les rassemblements religieux. Le motif de l’interdiction tient à leur forme et à leur nombre, et non à une volonté de persécution antireligieuse, à une volonté de s’en prendre à leur contenu ou à leur objet. Une décision laïque, en l’occurrence, consiste à rester aveugle au contenu et à l’objet même des rassemblements et à les traiter de manière égale.
C’est là qu’apparaît le fond de la question, car c’est précisément ce qui blesse. Cette décision temporaire de restriction de liberté est prise sans considération du contenu des activités, en ne tenant compte que de leur forme et de leur nombre, lesquels sont en l’occurrence pertinents en matière de transmission du virus. La décision s’apprécie en relation avec la situation et, comme le dit la loi d’urgence, « aux seules fins de garantir la santé publique ». Elle montre que, aux yeux d’une association politique laïque soucieuse de l’ordre public et en ces circonstances, les rassemblements cultuels n’ont pas en soi plus de valeur que d’autres rassemblements présentant les mêmes propriétés et qu’ils doivent être traités de la même manière.
Aller à la messe, aller au cinéma, aller au concert…
Voilà le point visé par les reproches de matérialisme, de méconnaissance de l’anthropologie élémentaire – laquelle, selon Mgr Aupetit, requiert la pratique d’une religion parce que « c’est vital » . « Aller à la messe ce n’est pas la même chose que d’aller au cinéma ! » ajoute-t-il6. Ce n’est pas non plus la même chose d’aller au cinéma que d’aller au concert, d’assister à une conférence ou de se réunir dans un temple maçonnique : ces rassemblements ayant des objets et des contenus différents, chacun d’entre eux est spécifique ! Mais la messe, quand même, c’est autre chose, c’est plus important, ça demande quelques égards, non ? Non. Dans sa forme, la messe est un rassemblement tout comme le cinéma, le concert ou la tenue maçonnique : de ce point de vue, elle ne saurait faire exception. Oui mais, nous dit-on, les prêtres sont « responsables » et sauraient faire respecter des mesures sanitaires de protection des fidèles ! On n’en doute pas. Mais on ne doute pas non plus que les directeurs de salles de cinéma, de théâtre, les organisateurs de concerts, etc., soient tout autant responsables et capables…
Les responsables religieux devraient plutôt se féliciter que la puissance publique se détermine ici sans avoir égard au contenu, qu’elle ne professe aucune position « anthropologique », qu’elle ne décide pas s’il est meilleur d’aller à la messe plutôt qu’au cinéma ou dans une réunion maçonnique, s’il est meilleur d’embrasser telle ou telle religion plutôt qu’une autre ou plutôt qu’aucune.
En ces circonstances particulières (où, comme on l’a dit, les dispositions en question ont pour fin « de garantir la santé publique »), si la puissance publique accordait à la messe – ou à tout autre rassemblement religieux – une attention spéciale en fonction de son contenu et de son objet spécifiques, attention qui la placerait en position d’exception, cette puissance publique s’engagerait sur la voie de la reconnaissance d’une « utilité spirituelle ». Outre que cela, comme on le voit déjà, déclencherait une concurrence entre instances autoproclamées se réclamant d’une telle utilité, cela pose une question fondamentale. Que serait une association politique qui s’occuperait (comme le dit Locke pour récuser cette idée) du « soin des âmes » en accordant à un ou des cultes un statut d’exception ? Ne pratiquerait-elle pas une ingérence dans la conscience des citoyens et ne romprait-elle pas la liberté des cultes, qui suppose leur égalité ? Ne faut-il pas s’en tenir ici au minimalisme laïque, qui laisse un tel « soin de son âme » à la conscience de chacun et qui laisse les cultes s’organiser librement dans le respect du droit commun ? Paraphrasons Locke encore une fois : l’association politique n’a pas à assurer le « salut des âmes », mais la sauvegarde des droits et biens civils – en l’occurrence la « santé publique ».
Du reste, en lâchant le grand mot de « liberté religieuse », certains politiques avouent qu’ils ont une piètre idée de ces biens civils et de la puissance libératrice de la laïcité7. Car cette expression, très restrictive, trahit une absence de souci pour l’irréligion. Or une association politique laïque assure tout autant la liberté irréligieuse, mais elle ne serait pas laïque si elle la qualifiait ainsi. Plus justement, la loi de 1905 parle de « liberté de conscience », dont la liberté de pratiquer un culte et celle de n’en pratiquer aucun sont des cas particuliers.
Une surenchère encombrante et outrancière
Une surenchère bien encombrante vient en outre submerger et surclasser tapageusement ces modestes plaidoyers. Le 7 mai, un remarquable « Appel pour l’Église et pour le monde aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté » est diffusé à l’initiative de Mgr Carlo Maria Viganò8.
Si Valeurs actuelles, en reprenant ce texte, parle élogieusement d’une « charge sans concession de plusieurs cardinaux »9, le journal La Croix en relève, avec un effarement non dissimulé, la « tonalité complotiste »10. Effectivement. En minimisant la gravité de la pandémie, en mettant en cause la recherche (prétendument mercantile) de vaccin, le texte, sans nommer un seul pays, s’alarme des restrictions de libertés produites par des mesures d’urgence sanitaire et les qualifie de « prétextes » politiques. Et il poursuit :
« Nous avons des raisons de croire – sur la base des données officielles relatives à l’incidence de l’épidémie, et sur celle du nombre de décès – qu’il existe des pouvoirs fort intéressés à créer la panique parmi la population dans le seul but d’imposer de façon permanente des formes de limitation inacceptables de la liberté, de contrôle des personnes, de suivi de leurs mouvements. Ces formes de limitations liberticides sont un prélude inquiétant à la création d’un gouvernement mondial hors de tout contrôle. »
Mais c’est à un autre moment du texte que je m’intéresserai pour finir. Ce vibrant appel à soutenir les libertés ne se contente pas d’évoquer un « ennemi invisible » contre lequel il appelle les fidèles à résister, il lui donne en réalité un visage, présenté comme tentaculaire et invasif : l’Autorité civile.
« L’État n’a pas le droit de s’ingérer, pour quelque raison que ce soit, dans la souveraineté de l’Église. La collaboration de l’autorité ecclésiastique, qui n’a jamais été refusée, ne peut impliquer de la part de l’Autorité civile des formes d’interdiction ou de limitation du culte public ou du ministère sacerdotal. Les droits de Dieu et des fidèles sont la loi suprême de l’Église à laquelle elle ne veut ni ne peut déroger. Nous demandons que les limitations à la célébration des fonctions publiques du culte soient supprimées. » [Le passage en italique est souligné dans le texte d’origine.]
L’État n’a pas à s’ingérer dans la souveraineté de l’Église : bien sûr, mais il n’est pas vrai que cette abstention doive être absolue et doive écarter « quelque raison que ce soit » – car il peut arriver que ladite « souveraineté » empiète sur le droit commun. La non-ingérence est une base de la loi de 1905 garantissant la liberté de culte « sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public »11. Personne, aucune association, ne peut revendiquer une liberté absolue, personne n’est au-dessus du droit commun. Par ailleurs, on fera remarquer qu’un régime concordataire est par définition une ingérence de l’État dans les affaires religieuses et cette fois en tant que telles (nomination des évêques par exemple). Il faudrait donc, dans cette logique revendicative, en réclamer l’abolition et s’en tenir à une stricte séparation.
D’autre part, cette non-ingérence est réciproque. Or c’est ce que semble oublier le texte, qui revendique (en le soulignant) un fonctionnement à sens unique : « Les droits de Dieu et des fidèles sont la loi suprême de l’Église à laquelle elle ne veut ni ne peut déroger ». Si les fidèles peuvent, au sein de l’association politique et en tant que citoyens, œuvrer en faveur de ce qu’ils estiment conforme à leur engagement religieux, s’ils doivent faire respecter leurs droits comme ceux de tout autre (qu’il soit ou non croyant), ils doivent faire tout cela dans le respect du droit commun, dont ils sont à la fois sujets et législateurs. Mais « les droits de Dieu » et ceux d’un « Roi et Seigneur de l’Histoire » s’étendent-ils jusqu’à s’élever au-dessus de l’autorité civile au nom d’une loi supérieure ? Croyant ou non, n’aura-t-on pas de bonnes raisons de craindre ceux qui se proclament les législateurs, les représentants et les exécutants d’une « loi suprême » ?
[Edit du 25 mai]. Sur le référé du Conseil d’État intervenu le 18 mai après publication de cet article
18 mai : le Conseil d’État statuant en référé ordonne au premier Ministre de « lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de déconfinement ». En lui accordant une importance plus grande qu’aux autres libertés fondamentales, il montre que la liberté de culte est traitée de manière exceptionnelle. On lira à ce sujet le communiqué du Collectif laïque national ci-dessous ou en ligne sur le site de l’UFAL.
Notes