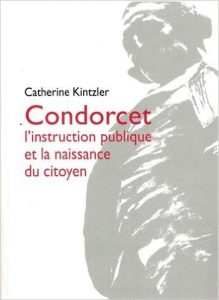Aline Girard1 examine une enquête réalisée par l’Ifop en octobre 2021 sur « Les Français et l’enseignement du fait religieux ». Mené en relation avec d’autres données également issues d’enquêtes, cet examen la conduit à des observations et des conclusions quelque peu différentes de celles du commanditaire de l’étude, l’Institut des religions et de la laïcité.
À la demande de l’Institut d’étude des religions et de la laïcité (IREL, ex-Institut européen en sciences des religions IESR)2, l’Ifop a réalisé en octobre 2021 une étude sur « Les Français et l’enseignement du fait religieux »3. Derrière les commentaires positifs et consensuels des résultats par l’IREL et par les promoteurs de l’enseignement du fait religieux, on peut mettre en évidence une autre réalité. L’enseignement du fait religieux est en effet loin de donner les résultats escomptés. Ce semi-échec n’empêche pas l’IREL de continuer, sans faiblir, à légitimer cet enseignement sur la base de convictions idéologiques et de travailler à la confusion des esprits4.
Pourquoi cette étude ? L’IESR5, un des trois instituts de l’École pratique des hautes études, a été le fer de lance de la mise en œuvre de « L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque »6, avec pour mission d’organiser des stages de formation initiale et continue, notamment pour les personnels de l’Éducation nationale7. Vingt ans après sa création, l’IREL/IESR a voulu dresser un bilan de cet enseignement et de son action sur la base d’une enquête commanditée à l’Ifop8. Ce bilan a été rendu public le 15 novembre à l’occasion d’une conférence-débat, dont les intervenants étaient, à l’exception de Jérôme Fourquet de l’Ifop, des responsables ou ex-responsables de l’IREL.
Les résultats de l’étude demandent à être interprétés avec soin, commentés avec précision et mis en relation avec d’autres données également issues d’enquêtes9, le tout avec un regard politique et sans le biais de confirmation privilégié par l’IREL10. Une attention particulière sera accordée aux réponses des plus jeunes (18-24 ans). Le clivage générationnel constaté dans d’autres enquêtes se trouve confirmé ici.
Quel intérêt les Français portent-ils aux questions de religion et de laïcité ?
Avec les quatre premières questions de portée générale, l’enquête Ifop/IREL dessine le paysage. Ces questions introductives permettent d’avoir un éclairage sur l’intérêt des Français pour les questions de religions et de laïcité. On notera le rapprochement tendancieux entre religion et laïcité dans la formulation des questions, comme si la laïcité ne se concevait que dans un rapport de dépendance par rapport aux religions et n’était pas un principe constitutionnel supérieur, englobant l’ensemble des questions de liberté de conscience, foi, agnosticisme, athéisme et autres points de vue philosophiques et moraux. Il s’agit ici de faire de la laïcité une forme de croyance à laquelle seraient opposées d’autres croyances. La laïcité devient en quelque sorte la religion des non-croyants, un peu comme elle fonctionne en Belgique. Ce rapprochement11 favorise la confusion, tout comme le fait le changement subtil de nom de l’IESR en IREL. Le binôme religion/laïcité devient progressivement indissociable et on glisse ainsi petit à petit vers une conception de la laïcité proche de la coexistence interreligieuse et de l’interconvictionnalité.
Première information : une majorité se dit intéressée par les questions de religion et de laïcité abordées dans les débats, mais…
53% des personnes interrogées déclarent être intéressées par les questions de religion et de laïcité abordées dans les débats en France aujourd’hui, et tout spécialement les seniors (64%) et les plus jeunes (66% des 18-24 ans). Un peu plus de la moitié des sondés manifeste donc un intérêt pour ces sujets. Comment pourrait-il en être autrement quand l’espace médiatique est constamment saturé d’informations et de polémiques liées aux religions ? On peut aussi conjecturer que les Français veulent comprendre ce qui arrive à leur République laïque, envahie comme jamais par les questions religieuses, tourmentée par le fondamentalisme et assaillie par les attaques islamistes. La laïcité, qui est le socle de la nation, leur paraît menacée12.
Il importe donc de ne pas confondre intérêt pour des débats (avec sans doute parfois le sentiment que « trop, c’est trop »), et affirmation d’une position religieuse personnelle. Une autre étude réalisée par l’Ifop, pour l’Association des journalistes d’information sur les religions (Ajir)13, permet de compléter et de confirmer notre approche. On observe qu’en 2021, une courte majorité de Français ne croit pas en Dieu (51%) alors qu’en 1947, 66% des interrogés se déclaraient croyants. Conséquence logique de ce recul de la croyance, les Français parlent de moins en moins de religion, que ce soit en famille (38% le font au moins de temps en temps, 20 points de moins qu’en 2009) ou avec leurs amis (29%, -20 points). Une autre étude, « Fractures sociétales : enquête auprès des 18-30 ans »14, réalisée en 2020 également par l’Ifop à la demande de l’hebdomadaire Marianne, le confirme. Même chez les jeunes, plus sensibles que leurs aînés aux religions, 78% d’entre eux estiment qu’« on parle trop de religion et des questions religieuses ».
Cette réalité n’empêche pas l’IREL de se réjouir de ces 53% de personnes intéressées, qu’il tend à interpréter comme un intérêt pour les religions. Sur ces 53%, un peu plus de la moitié des personnes interrogées estiment par ailleurs qu’elles sont assez autonomes pour s’informer par leurs propres moyens si elles en ont envie et qu’elles n’ont « pas besoin de formation supplémentaire dans ce domaine ». Rapportés aux 100% du panel, seuls 28% ont envie d’en savoir plus sur les questions de religions et de laïcité. Un intérêt limité donc pour un complément d’information et de formation sur ces sujets !
Deuxième information : dans leur connaissance des religions, les personnes interrogées sont autonomes et se sentent suffisamment informées
Quand les personnes interrogées veulent en savoir plus sur les religions, elles s’informent de leur propre chef. Parmi les sources d’information sur les religions, elles privilégient les médias, audiovisuels ou écrits, généralistes ou spécialisés. Elles mettent aussi leurs proches et connaissances à contribution. Ces choix sont très nettement affirmés15 et les autres possibilités sont relativement négligées (réseaux sociaux, communauté religieuse d’appartenance, école).
Dans un autre registre, les 2/3 des personnes interrogées déclarent qu’elles ne se sont jamais dit qu’une meilleure connaissance des religions leur aurait été utile dans certaines situations professionnelles et personnelles, et ce quel que soit leur niveau d’éducation.
On peut déduire de l’ensemble de ces informations que les Français, dans leur grande majorité, se sentent capables d’aborder seuls le sujet et de maîtriser les situations où la question des religions intervient.
« L’enseignement des religions » à l’école
L’enquête Ifop/IREL ayant comme questionnement central « Les Français et l’enseignement du fait religieux », quatre questions abordent le sujet des « religions à l’école ».
Remarquons d’emblée que dans la formulation des questions on évoque « les religions à l’école », et non pas le « fait religieux ». Fort probablement retenue pour que la question soit immédiatement comprise par les personnes interrogées (l’expression « fait religieux » demandant en effet à être explicitée), la formulation, dans son absence de filtre et de précaution, ouvre d’emblée la possibilité des religions à l’école. Vingt ans après la publication du rapport Debray et après plus de quinze ans d’enseignement du fait religieux à l’école publique, on ne prend même plus la peine de sauver les apparences, en posant la question de la légitimité de cet enseignement. Et pourtant il serait très utile de le faire.
L’analyse proposée dans le livre Enseigner le fait religieux à l’école : une erreur politique ? est sur ce point particulièrement éclairante. L’enseignement du fait religieux est en effet un événement idéologique majeur alors qu’il doit être considéré comme un événement pédagogique tout à fait mineur, puisque les programmes scolaires intégraient depuis toujours l’enseignement des religions en tant que « faits de civilisation ». L’introduction de l’enseignement du fait religieux n’est donc pas une question scolaire, mais une question politique. Une nouvelle matrice idéologique et politique a fait apparaître la notion d’enseignement du fait religieux et a permis que l’EFR contribue de manière non négligeable à la « cléricalisation » des esprits, en particulier ceux des élèves des collèges et lycées 16.
Après cette brève, mais indispensable mise au point, revenons aux résultats de l’enquête Ifop/IREL.
Une forte proportion des personnes interrogées (37%) estiment que la meilleure façon d’aborder les religions à l’école est la transmission de « connaissances sur les religions dans le cadre d’un enseignement laïque ». Pour la majorité – et puisque « les religions » sont abordées à l’école – les connaissances sur les religions doivent être dispensées prioritairement dans le cadre du cours d’enseignement moral et civique (E.M.C.), mais elles ont aussi leur place dans le cadre du cours d’histoire. Notons que 17% affirment néanmoins qu’il faut « passer cette question sous silence car elle n’a pas sa place à l’école laïque ». Les Français continuent à écarter avec vigueur l’idée d’un enseignement donné par un professeur de religion et une étude (même critique) des grands textes religieux. Ces résultats sont encourageants.
Autre point de vue encourageant : l’effet sociétal attendu d’une « étude laïque des religions à l’école » (ou dans le cadre de formations destinées à des adultes) est d’abord « un meilleur respect de la loi comme dimension qui s’impose à tout citoyen, qu’il soit croyant ou non croyant », puis la mise à disposition « d’outils pour lutter contre les extrémismes religieux (fanatisme, fondamentalisme, radicalisation). On constate dans ces résultats une volonté de faire respecter la loi par tous et de la rendre compréhensible à tous, avec une détermination à combattre les dérives religieuses radicales, très présentes sur notre territoire. Même si l’étude laïque des religions à l’école n’est certainement pas le meilleur mode d’explicitation de la loi, apprécions ces réponses. « L’argument de vente » principal quand il s’est agi d’installer l’enseignement du « fait religieux » dans les programmes scolaires, à savoir une « meilleure compréhension mutuelle entre élèves ou entre citoyens », ne recueille que 19% des réponses. L’objectif du fameux « vivre ensemble », mot magique et en réalité vide de sens, ne semble donc pas être du ressort de l’étude laïque des religions à l’école. Ce qui a été démontré dans le livre Enseigner le fait religieux à l’école : une erreur politique ?
Dernière source de satisfaction : quand on essaie de savoir ce que les personnes interrogées attendent pour elles-mêmes d’une étude laïque des religions, 37% répondent « mieux comprendre les enjeux, notamment géopolitiques, du monde contemporain, les conflits entre religions ou au sein d’une même religion ». On en revient donc aux observations formulées au début de cette analyse : les Français veulent interpréter, décoder, décrypter ce qui se passe chez eux et dans le monde autour des questions religieuses, mieux appréhender aussi les valeurs et les mœurs des croyants des différentes religions présentes en France, sources d’antagonismes et de conflits. On peut penser qu’il s’agit là d’une approche politico-sociale, assez caractéristique des Français. Notons pour terminer que 21% ne voient aucune utilité personnelle à l’étude laïque des religions. Ce qui rappelle que plus d’un cinquième des Français continuent à penser que l’on peut mener une vie morale et riche intellectuellement et spirituellement sans référence aux dogmes religieux.
L’enseignement de la laïcité à l’école
On a vu que le recours au binôme religion/laïcité, à l’empreinte cognitive forte, était privilégié dans le cadre de l’enquête commanditée par l’IREL, qui entretient par ce rapprochement une confusion au profit de la vision baubériste de la laïcité17. Deux questions traitent de la formation à la laïcité dans le cadre scolaire.
On constate à travers les réponses à la première de ces questions que, pour les personnes interrogées, le meilleur moyen de former à la laïcité est le cours d’enseignement moral et civique (39%). Remarquons néanmoins que 22% préféreraient un « cours spécifique, uniquement consacré à la laïcité », pour eux principe d’une importance telle qu’il mériterait un traitement particulier. Une deuxième question, habile de la part de l’IREL, rapproche à nouveau religions et laïcité : « Pour répondre à cette situation où l’école est interpellée par la question de la laïcité et des religions, qu’est-ce qui est le plus souhaitable pour vous ? ». Induites par la question, les réponses des sondés privilégient le point de vue selon lequel « une formation à la laïcité et un enseignement du fait religieux sont tous les deux nécessaires et complémentaires » (32%). Mais on retrouve juste derrière, à 24%, une demande de formation exclusive à la laïcité « car c’est un principe essentiel » 18, malgré la manipulation assez claire de la question, induisant une réponse tout en œcuménisme…
Ces dernières données sont caractéristiques de ce qui s’est passé avec l’enseignement du fait religieux. Le concept est entré comme par effraction dans l’école de la République et dans la société, par un coup de force clérical, largement inspiré par une Europe d’inspiration chrétienne-démocrate de plus en plus encline à étendre le champ d’intervention des religions. On a forcé et on continue de forcer la main des Français sur l’enseignement des religions à l’école, en instrumentalisant la laïcité, en créant la confusion dans les esprits avec des arguments d’une part philosophico-historiques (« universalité du sacré », « sens à la vie », « héritages collectifs », etc.), d’autre part sociétaux (« vivre ensemble », « cohabitation pacifique de populations multiculturelles », etc.).
Malgré des résultats qui plaident très modérément en faveur de l’étude des religions à l’école, les responsables de l’IREL, lors de la présentation des résultats de l’enquête Ifop le 15 novembre dernier, en ont tiré des conclusions qui apportent de l’eau à leur moulin et qui valorisent le lien à la religion. Pour Philippe Gaudin, actuel directeur de l’IREL, « on comprend mieux la laïcité si on comprend mieux les religions, et réciproquement ». Isabelle Saint-Martin, directrice de l’IESR de 2011 à 2018, considère dans ses écrits le « fait religieux » comme un « fait de civilisation », mais de la tribune elle observe qu’il faut « donner aux faits religieux une place pour eux-mêmes et non pas seulement comme repères historiques ou philosophiques ». Dans les années 2000, les concepteurs de l’enseignement du fait religieux témoignaient que le « fait religieux » n’était pas qu’un « fait de civilisation ». Pour Jean-Paul Willaime, directeur de l’IESR de 2005 à 2010, c’est un « fait symbolique, porteur des représentations du monde, de soi et des autres, un fait expérientiel » (2007). Pour Régis Debray, président de l’IESR de 2002 à 2004, « Ce n’est pas simplement un fait de pensée, c’est une réalité existentielle, communautaire et identifiante, donc crucifiante, mais constitutive » (2006). Pour René Nouillhat, « ces faits en tant qu’ils sont religieux, renvoient à autre chose que ce qu’ils donnent à voir, à lire ou à penser. C’est cette « autre chose » qui doit être pressentie. Il relève de ce que chacun est susceptible de ressentir à propos de l’infini, de l’absolu, du transcendant ou du plus intime » (2004). » Il est aisé de discerner des accents confessionnels chez les promoteurs de cet enseignement. Alors que l’objectif affiché est la transmission de connaissances, celui-ci est pourtant loin d’être exempt d’orientations religieuses : ne véhicule-t-il pas une valorisation de la croyance, une « incitation à croire » ? Ne fait-il pas primer la liberté religieuse sur la liberté de conscience, sous le prétexte d’une « transformation des appartenances religieuses » et d’une nouvelle « conjoncture civilisationnelle » (J.-P. Willaime) ? N’invite-t-il pas les élèves à se reconnaître dans la position religieuse et à croire que le rassemblement ne s’effectue que par la croyance (C. Kintzler) ? Cette approche, lucide et critique, est peu répandue et l’IREL se plaît à entretenir la confusion autour de l’enseignement du fait religieux.
Une fracture générationnelle
Pour terminer cette analyse, intéressons-nous aux divergences générationnelles qui s’observent dans l’enquête Ifop/IREL, et plus particulièrement aux réponses des jeunes (18-25 ans).
66% des jeunes se déclarent intéressés par les questions de laïcité et de religion dans les débats, taux bien supérieur à la moyenne de 53%. Par ailleurs, au sein de cette moyenne de 53% de personnes intéressées, les 18-24 sont les plus nombreux à déclarer ne pas s’informer par leurs propres moyens (ne pas pouvoir s’informer ? ne pas vouloir ?) et à laisser entendre qu’ils auraient besoin d’une formation complémentaire. Ils sont les plus intéressés par le recueil de témoignages de personnes s’exprimant sur leurs convictions religieuses ou non religieuses (31%, 14 points de plus que la moyenne).
Selon les Français, la meilleure façon d’aborder le fait religieux à l’école est par les connaissances sur les religions dans le cadre de l’enseignement laïque (37%). Des divergences générationnelles s’observent également sur ce point : seuls 22% des 18-24 ans le citent. Près d’un quart de cette jeune génération privilégierait plutôt un enseignement religieux donné par un professeur de religion (24% contre 13% pour l’ensemble des Français) ou des débats entre élèves de différentes religions ou sans religion arbitrés par un enseignant (23% contre 16% parmi l’ensemble des Français).
A contrario, la réponse des jeunes à la question concernant la formation à la laïcité et aux religions à l’école surprend. Ils privilégient (37% contre 24% pour l’ensemble des Français) une « formation à la laïcité » et ils sont moins convaincus que leurs aînés de la nécessité de combiner « une formation à la laïcité et un enseignement laïque sur les religions » (24% contre 32%).
Comment expliquer, dans cette enquête, ce balancement surprenant entre « plus d’informations sur les religions données par des spécialistes » et plus de « formation à la laïcité » ?
Le rapport des jeunes à la religion et à la laïcité a été maintes fois interrogé dans le cadre des sondages réalisés par l’Ifop et les résultats publiés ont tout pour inquiéter. Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop, tente une synthèse des informations obtenues dans son ouvrage La Fracture. Comment la jeunesse d’aujourd’hui fait sécession : ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs 19.
Sondage après sondage, les Français affirment massivement leur attachement à la laïcité : à la loi de 1905 séparant les Églises et l’État ; à la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux à l’école ; à la loi de 2010 interdisant le port du voile intégral couvrant le corps et le visage dans les espaces publics. La laïcité est considérée comme le socle de la cohésion nationale, mais près de neuf Français sur dix pensent qu’elle est aujourd’hui en danger. La laïcité est plébiscitée dans toutes les catégories de la population, mais deux ensembles se distinguent : les jeunes et ceux qui se déclarent musulmans, où les pourcentages des enquêtes sont souvent inversés.
Plusieurs études, parues entre 2018 et 2021, présentent à ce titre des résultats alarmants20. On y apprend notamment que les jeunes sont majoritairement favorables au port de signes religieux ostensibles dans les collèges et lycées et au port de tenues religieuses par les parents accompagnateurs. Pour de nombreux jeunes musulmans, les règles de vie prescrites par la religion sont plus importantes que les lois de la République. On observe aussi chez eux une ferme conviction que leur « religion est la seule vraie religion. Les lois « laïques » sont perçues par beaucoup de lycéens comme discriminatoires envers les musulmans (1905, 2004, 2010).
Très majoritairement (75%), les jeunes rejettent toutes formes d’irrévérence envers les dogmes religieux « afin de ne pas offenser les croyants ». « Touche pas à mon Dieu »… Les lycéens interrogés sont beaucoup plus orthodoxes que leurs aînés dans leur rapport à la religion. Un « droit au blasphème » n’est reconnu que par une courte majorité de lycéens. Pour eux, le « respect est érigé en principe » comme disait Charb21. Pour ces jeunes, prompts à s’indigner, l’irrespect et la moquerie envers les religions sont proprement inconcevables. Nous avons toutes les caractéristiques d’une américanisation des esprits et d’une « génération offensée » (C. Fourest).
« Ces représentations collectives dans la jeunesse, note Frédéric Dabi, se nourrissent à l’échelle individuelle d’un rapport à la religion particulier. Celui-ci est marqué par une forme de sacralisation du fait religieux qui va de pair avec une orthopraxie croissante chez les 18-30 ans. » La « religiosité touche tous les segments de la jeunesse », avec une intensité plus importante chez les moins de vingt ans.
La part des moins de trente ans appréhendant la laïcité comme un objet positif est inférieure de 20 points à celle mesurée auprès du grand public. Elle se limite à « mettre toutes les religions sur un pied d’égalité », en termes de représentation, de visibilité, voire d’influence. La majorité des moins de 18-30 ans en vient à délégitimer les défenseurs de ce principe républicain. Pour les jeunes la laïcité ne serait pas particulièrement en danger, alors que ce danger est massivement ressenti au sein du grand public
On observe désormais un véritable clivage entre les jeunes et le reste des Français, clivage qui s’accentue si l’on considère, parmi les jeunes, ceux qui s’affirment musulmans. Rappelons-nous ce qu’a dit Jean-Pierre Obin il y a quelques années : « Une partie de la jeunesse est en train de faire sécession par rapport à la nation française ».
La fracture sociétale entre les jeunes Français et leurs aînés est multifactorielle : « prolifération du croire » ; poussée du religieux ; exacerbation de l’identité, notamment religieuse ; offensive cléricale au niveau national comme au niveau européen, etc. L’enseignement du fait religieux est un des facteurs favorisants.
Depuis plus de quinze ans, l’enseignement du fait religieux joue en effet un rôle non négligeable dans la perméabilité des élèves à la religion, dans l’acceptation des dogmes et dans leur difficulté à distinguer le registre de la connaissance de celui de la croyance, alors que parallèlement, sous l’influence du pédagogisme, l’école renonce progressivement à être un lieu de transmission des savoirs et à former des esprits structurés et critiques pour faire place à la confusion conceptuelle. Les élèves de la fin des années 2000 sont pour certains d’entre eux aujourd’hui des enseignants, qui se trouvent dans la position de perpétuer la vision acquise dès le début de leur scolarité, renforcés en cela par la formation professionnelle qu’ils ont reçue et reçoivent encore dans les IUFM/ESPE/INSPE où intervient fréquemment l’IREL. « La présence de l’effet religieux piège désormais toute pensée », selon C. Kintzler. Nous n’en sommes effectivement pas loin… en partie grâce à l’IREL22.
[Edit du 26 août 2022.
À la demande de l’auteur, le passage suivant
Pour Philippe Gaudin, actuel directeur de l’IREL, « on comprend mieux la laïcité si on comprend mieux les religions, et réciproquement ». Isabelle Saint-Martin, directrice de l’IESR de 2011 à 2018, considère dans ses écrits le « fait religieux » comme un « fait de civilisation », mais de la tribune elle observe qu’il faut « donner aux faits religieux une place pour eux-mêmes et non pas seulement comme repères historiques ou philosophiques ». Dans les années 2000, les concepteurs de l’enseignement du fait religieux témoignaient que le « fait religieux » n’était pas qu’un « fait de civilisation ».
remplace ce passage de la version initiale du 2 février 2022 :
Pour Philippe Gaudin, actuel directeur de l’IREL, « on comprend mieux la laïcité si on comprend mieux les religions, et réciproquement ». Encore le fameux binôme ! Pour Isabelle Saint-Martin, directrice de l’IESR de 2011 à 2018, il faut « donner aux faits religieux une place pour eux-mêmes et non pas seulement comme repères historiques ou philosophiques ». On retrouve ici l’esprit qui animait dans les années 2000 les concepteurs de l’enseignement du fait religieux : le « fait religieux » n’est pas qu’un « fait de civilisation ».]
Notes